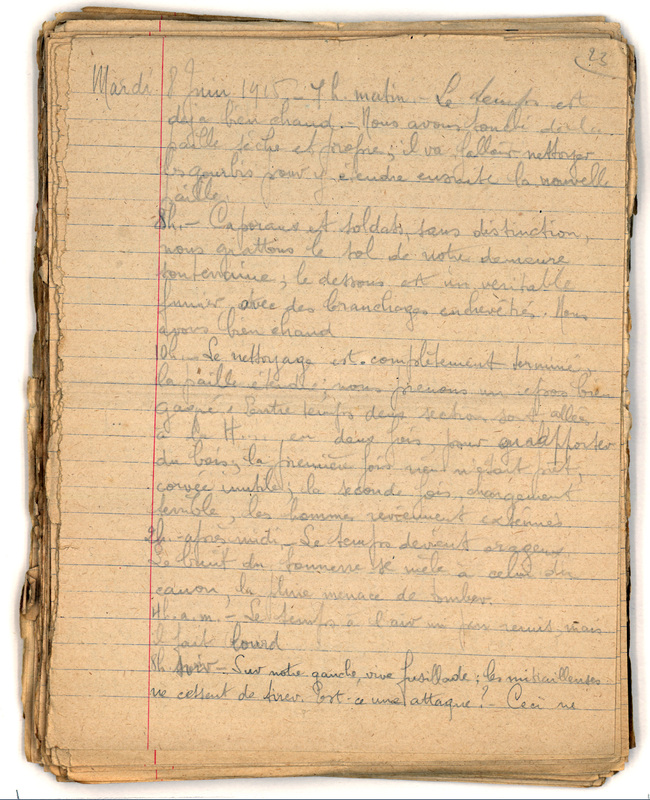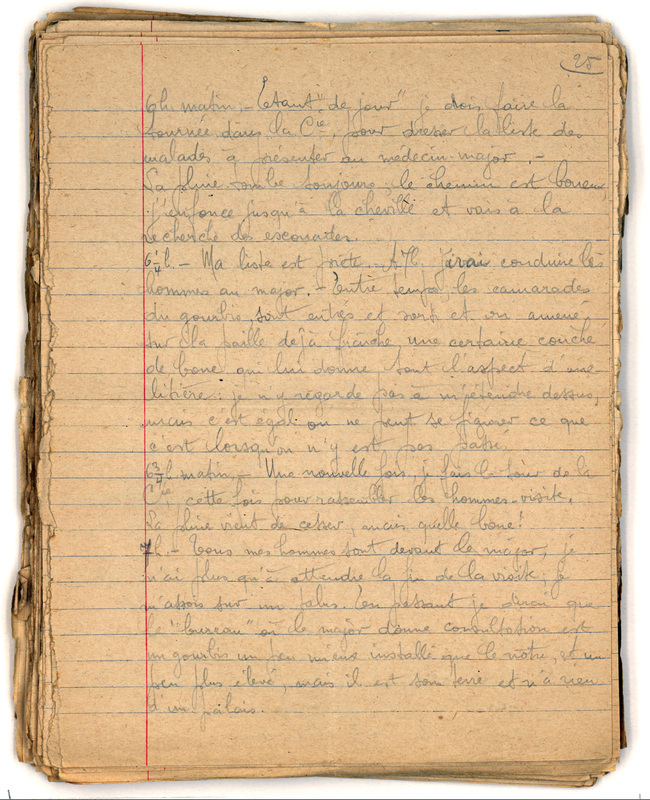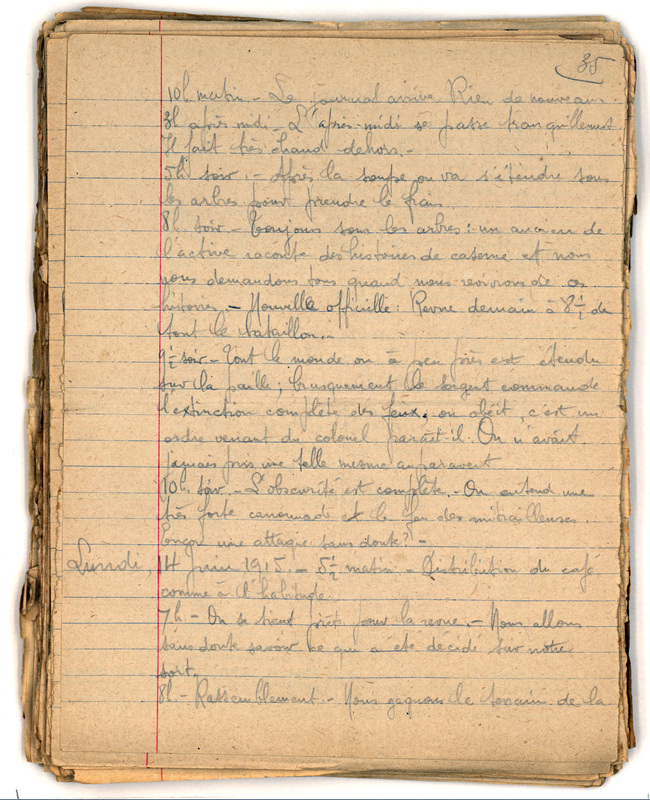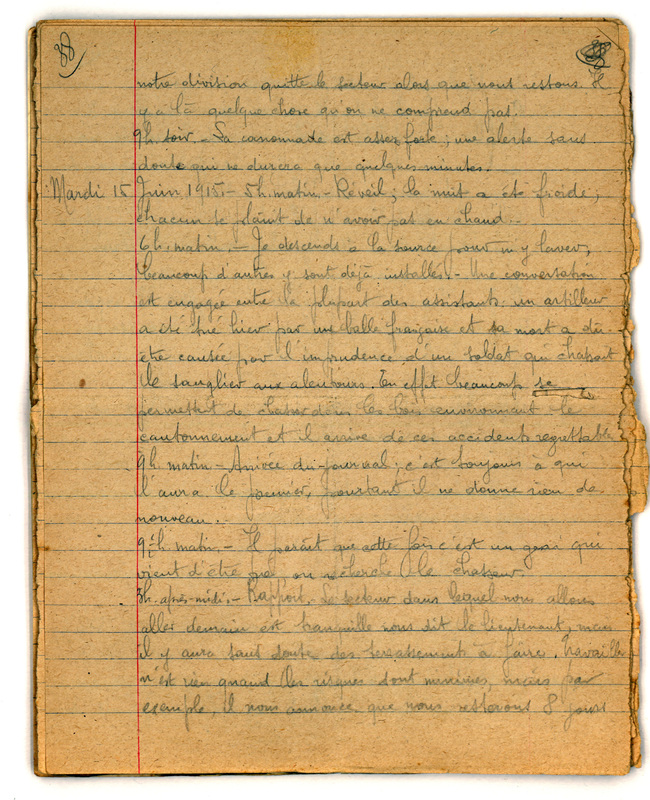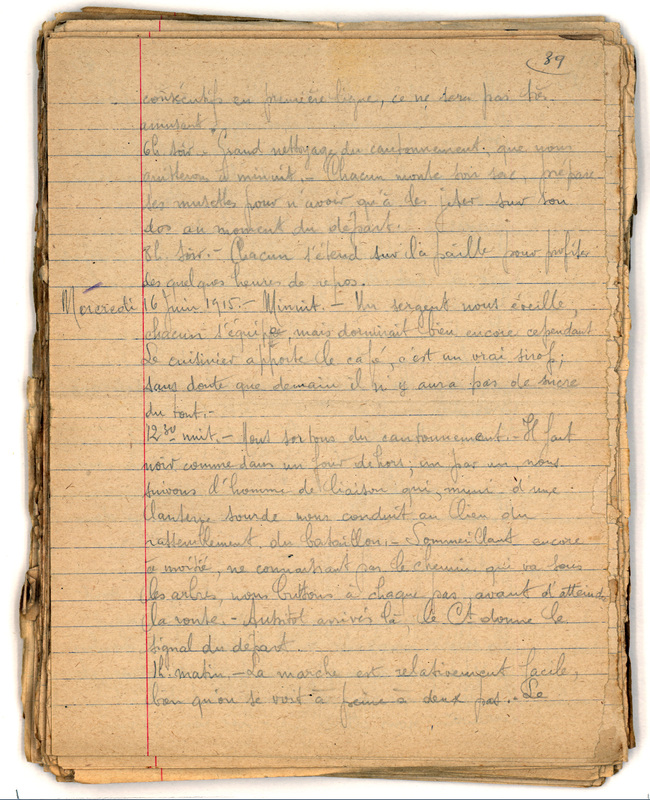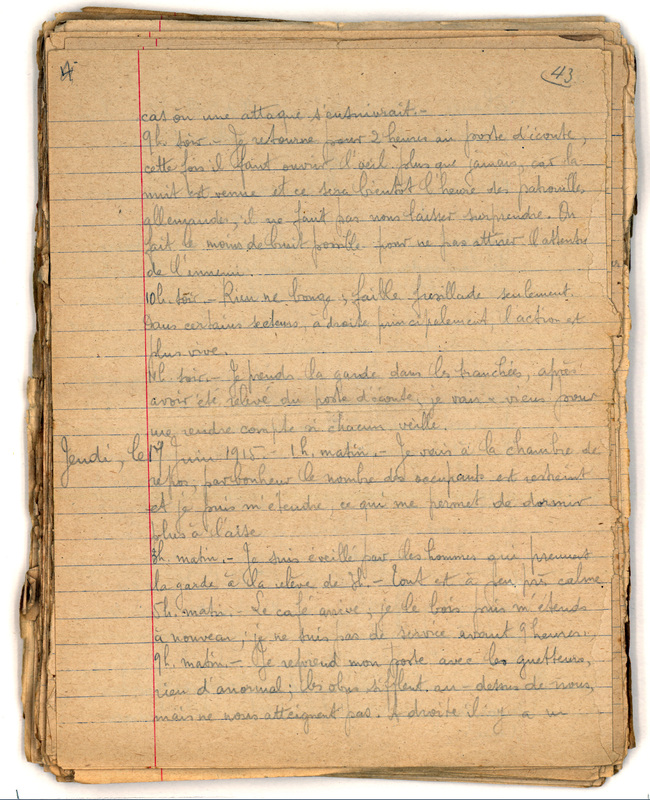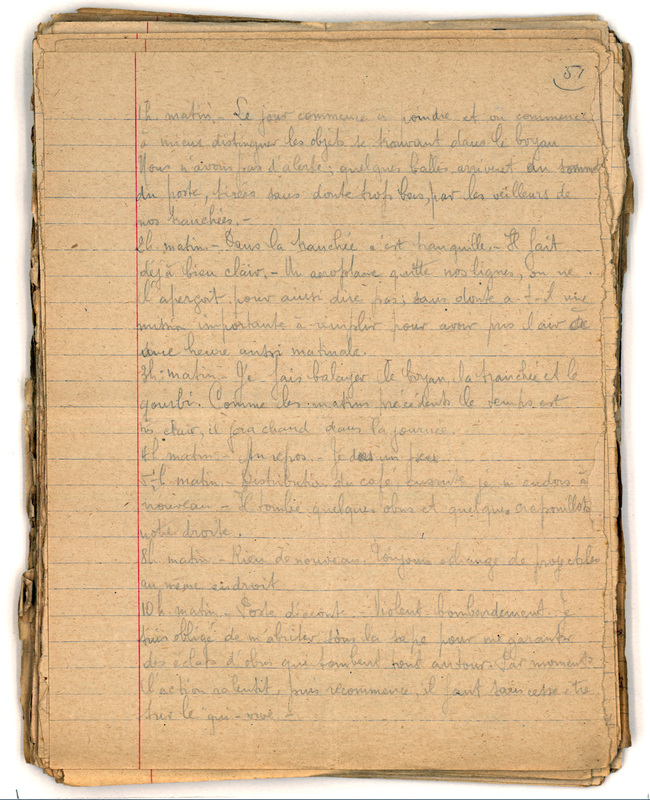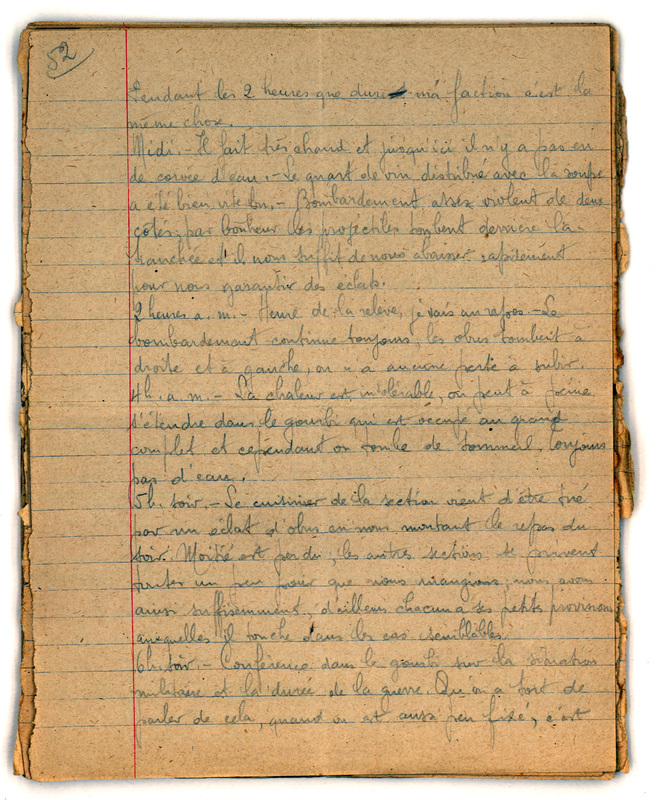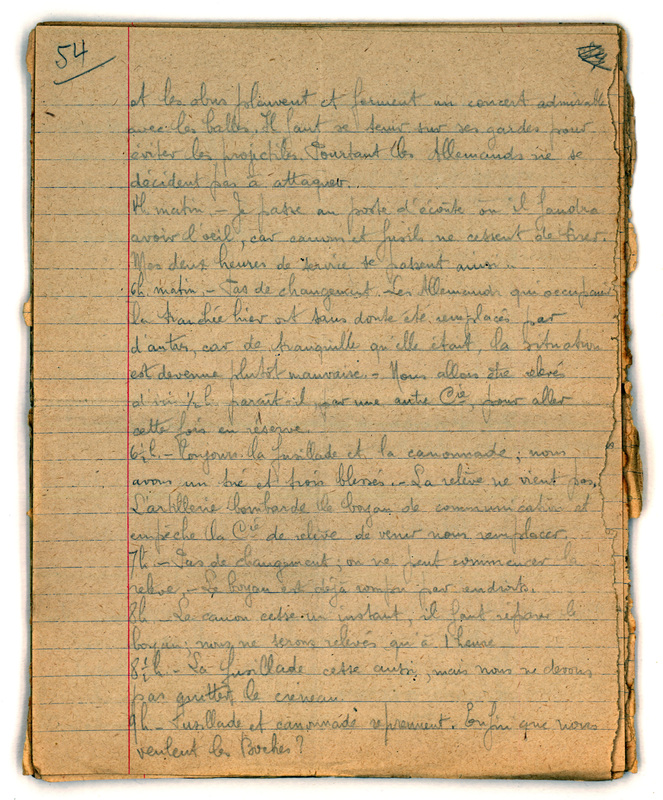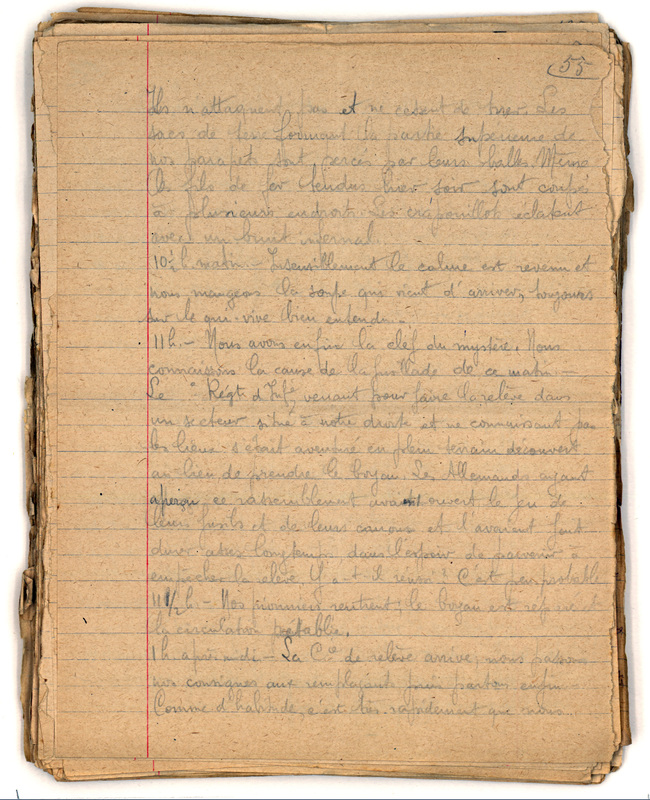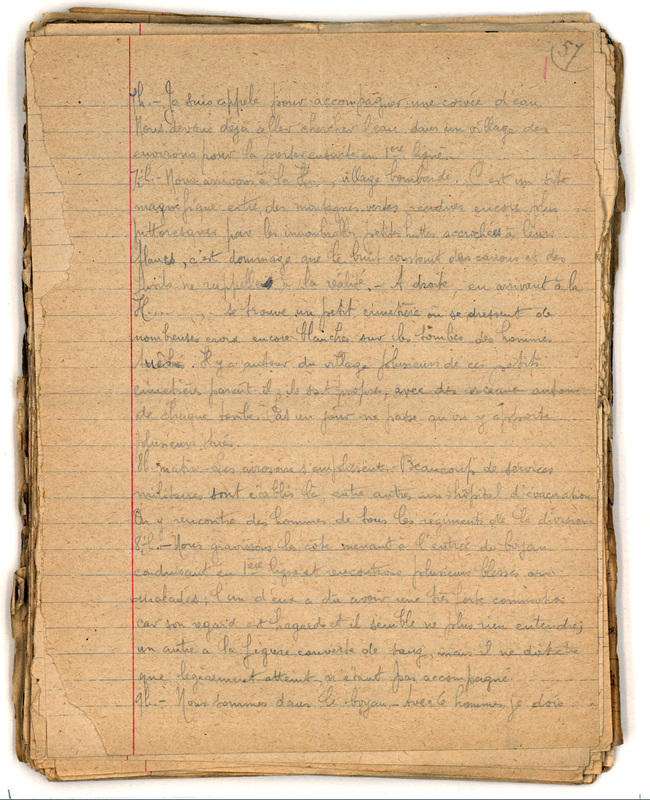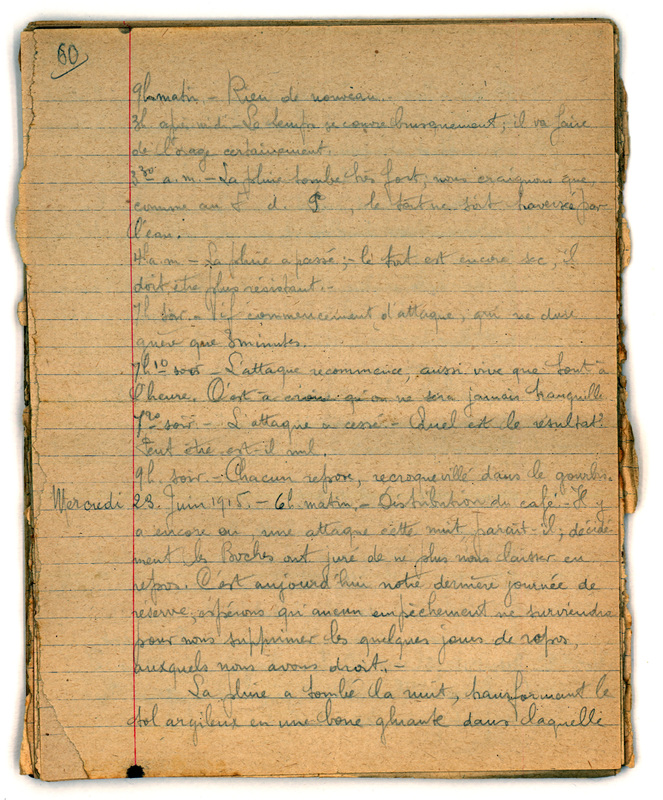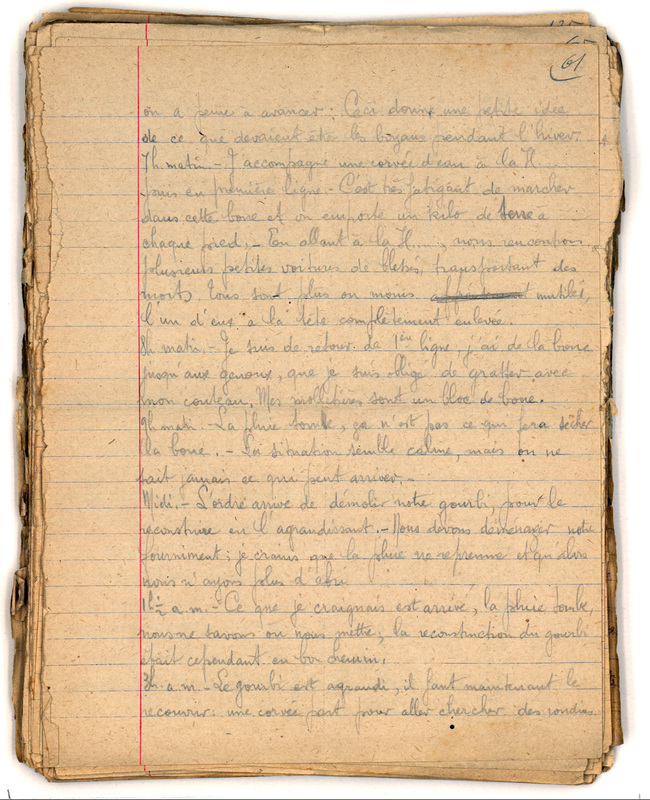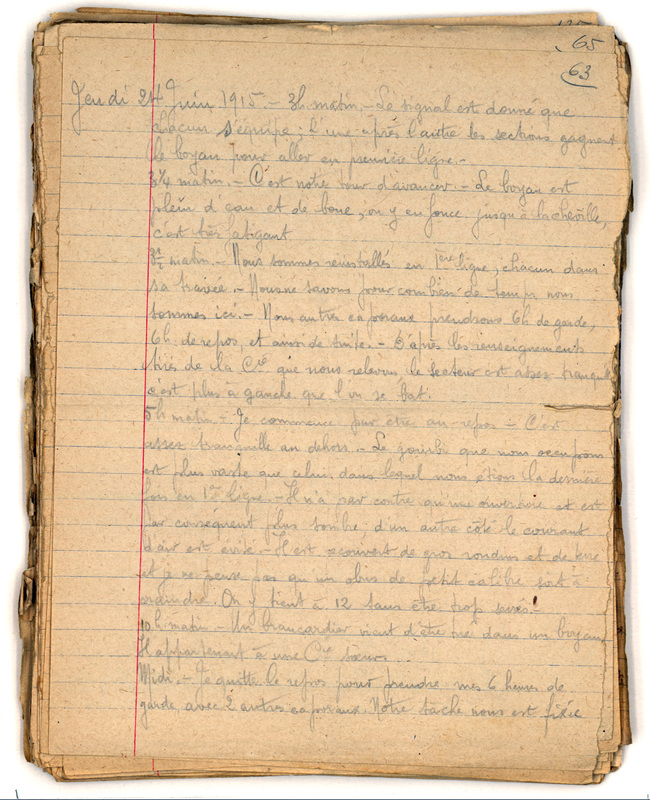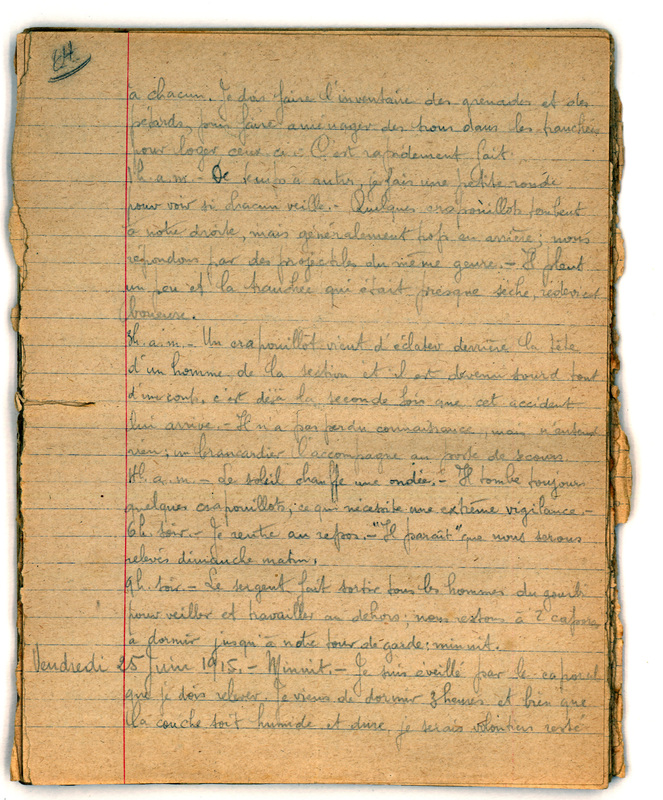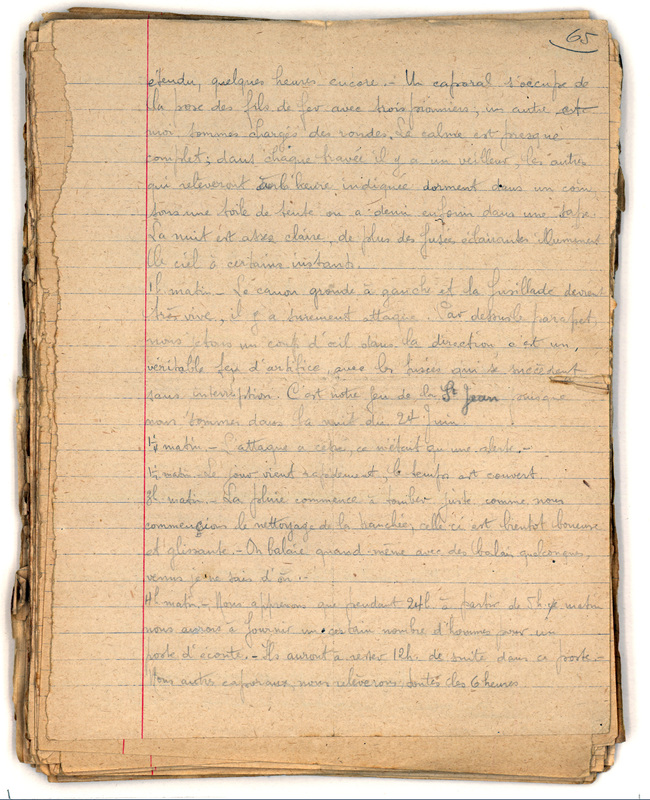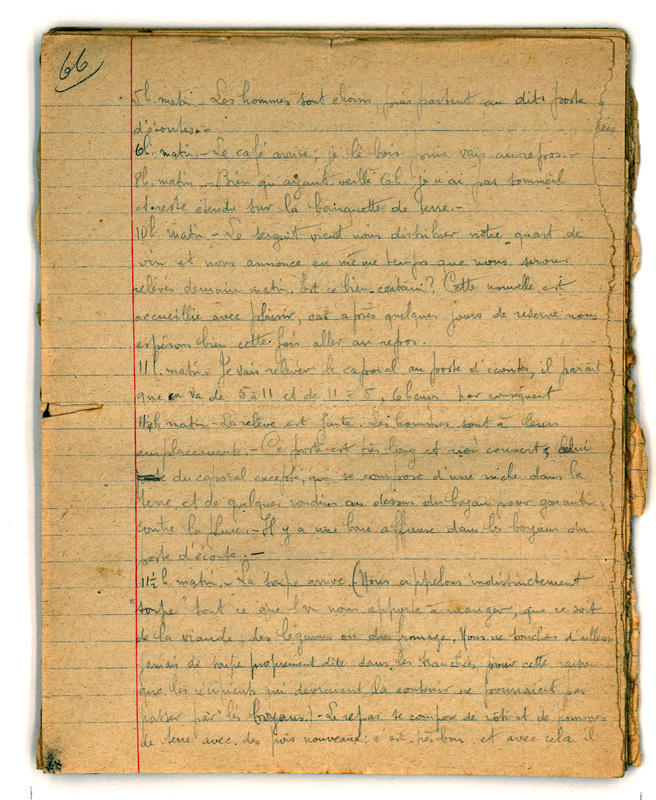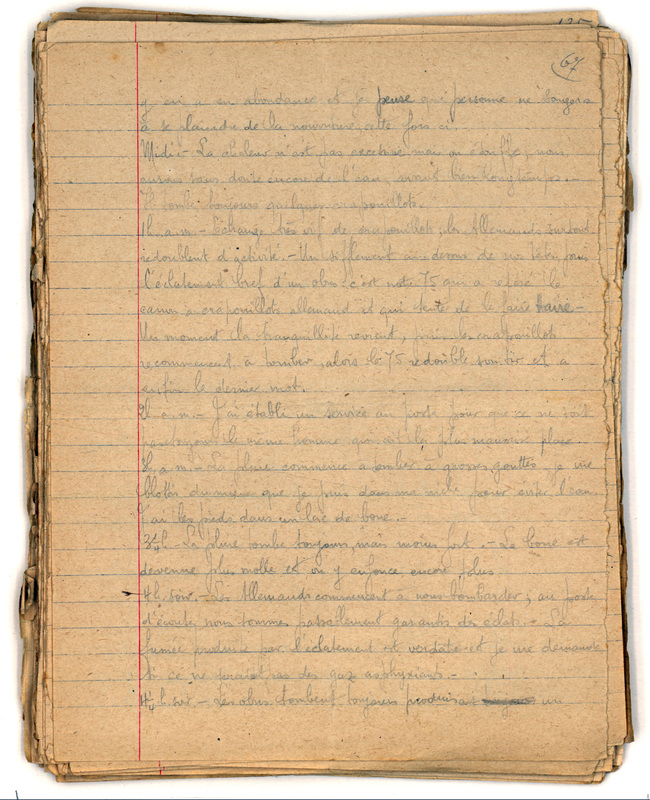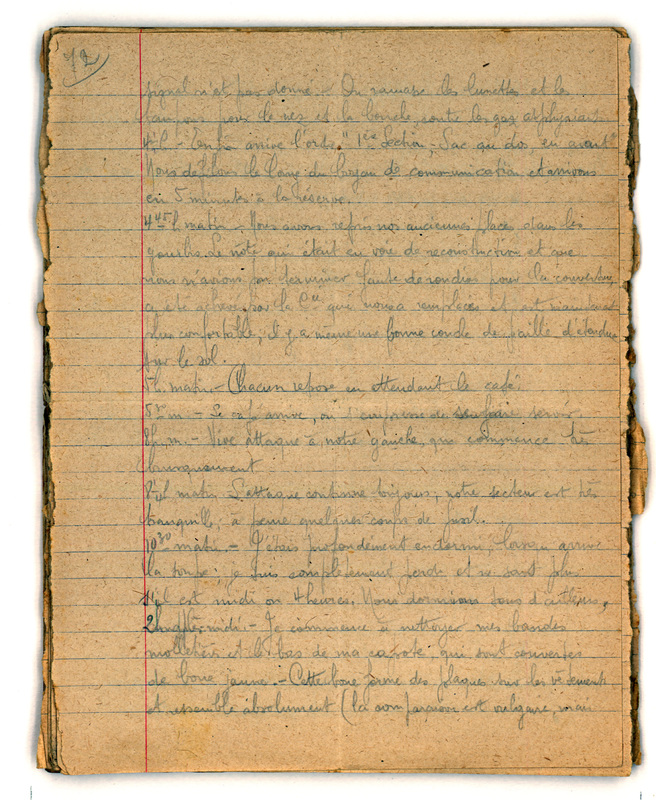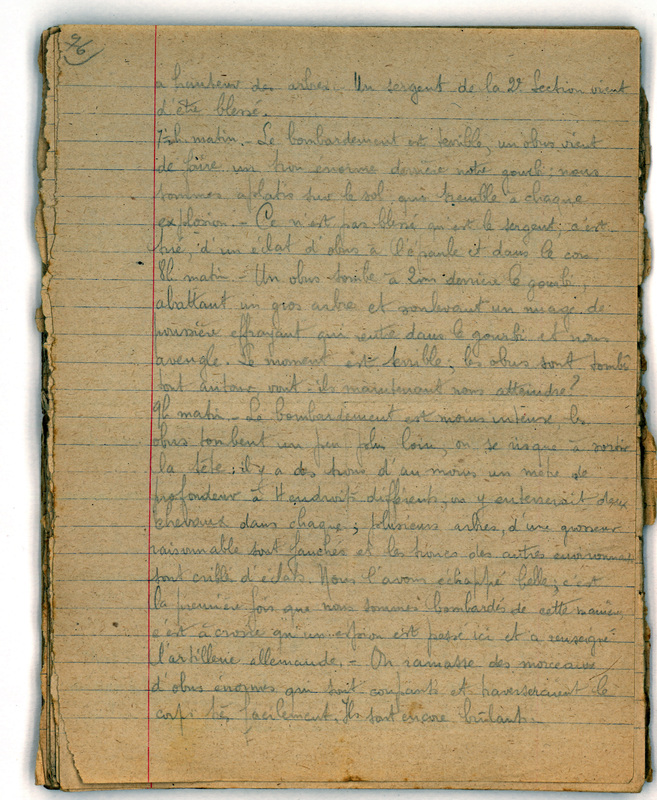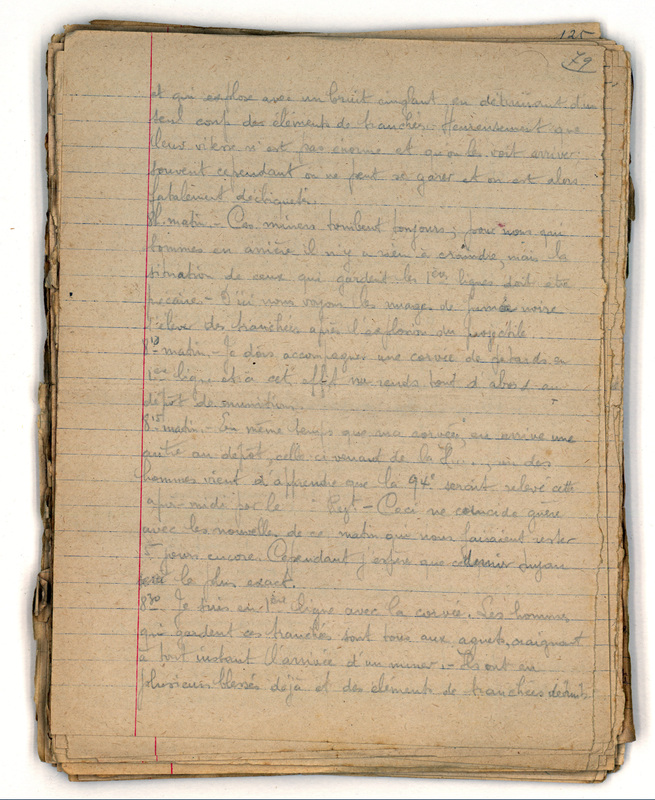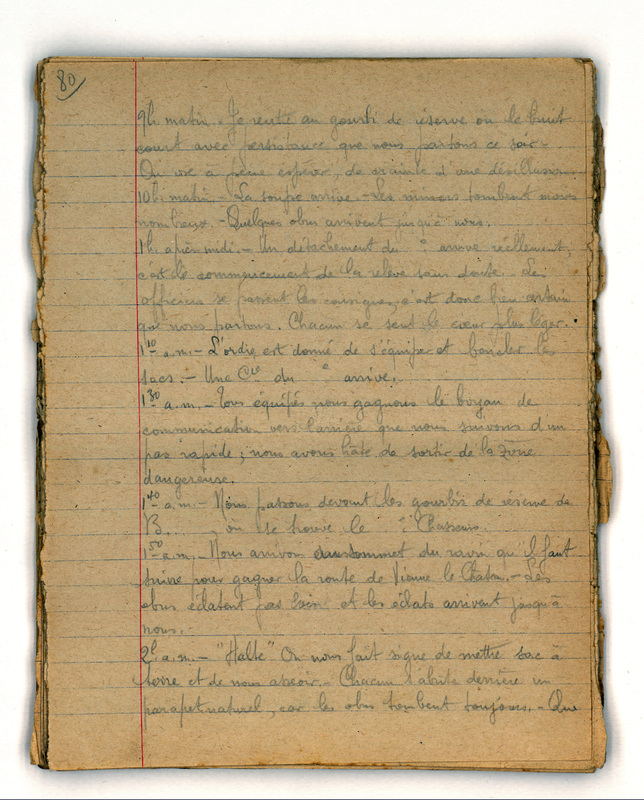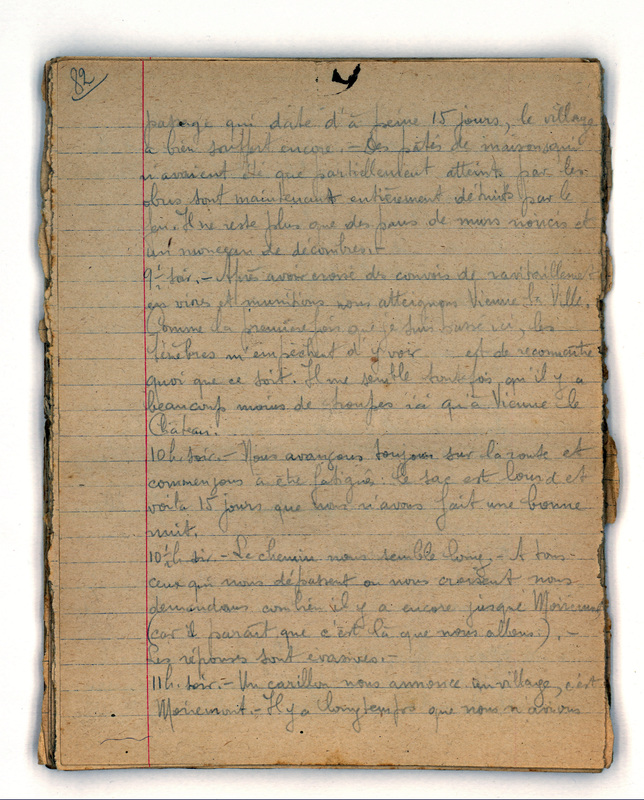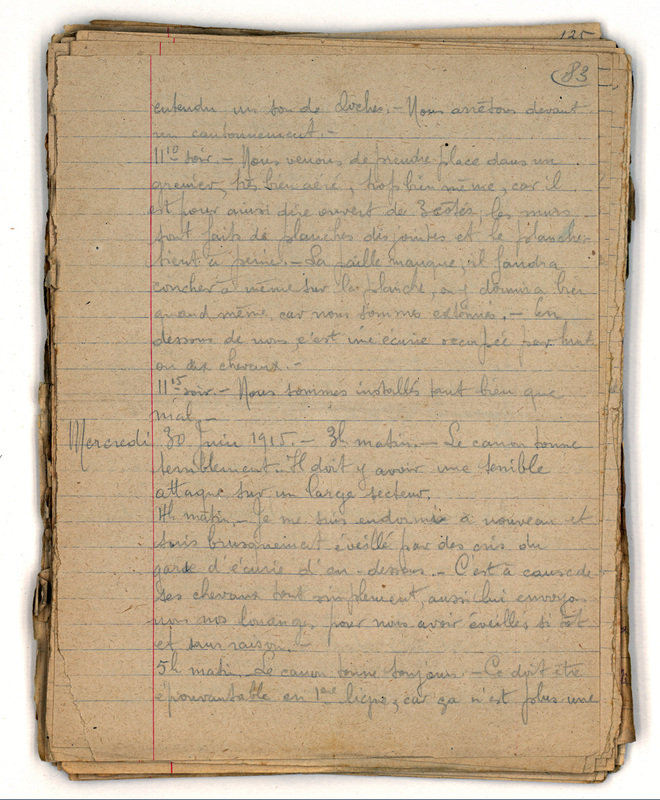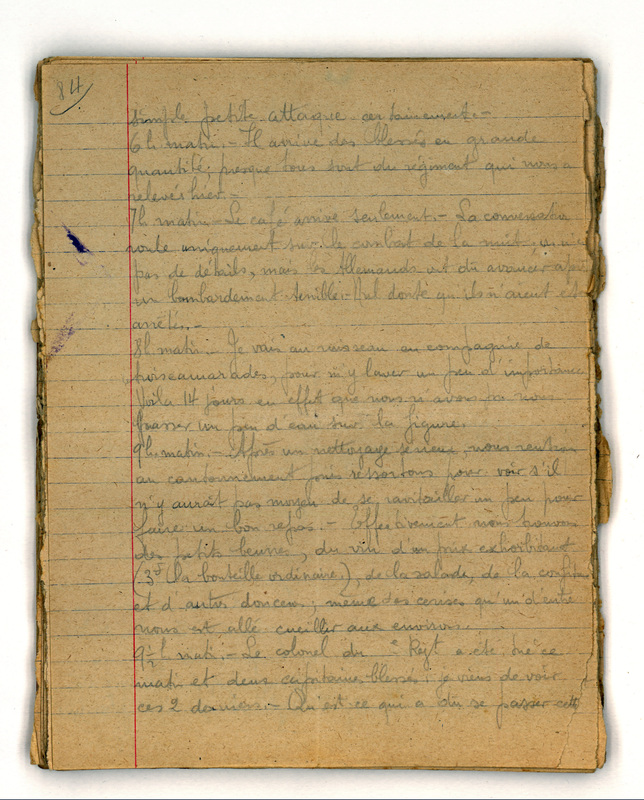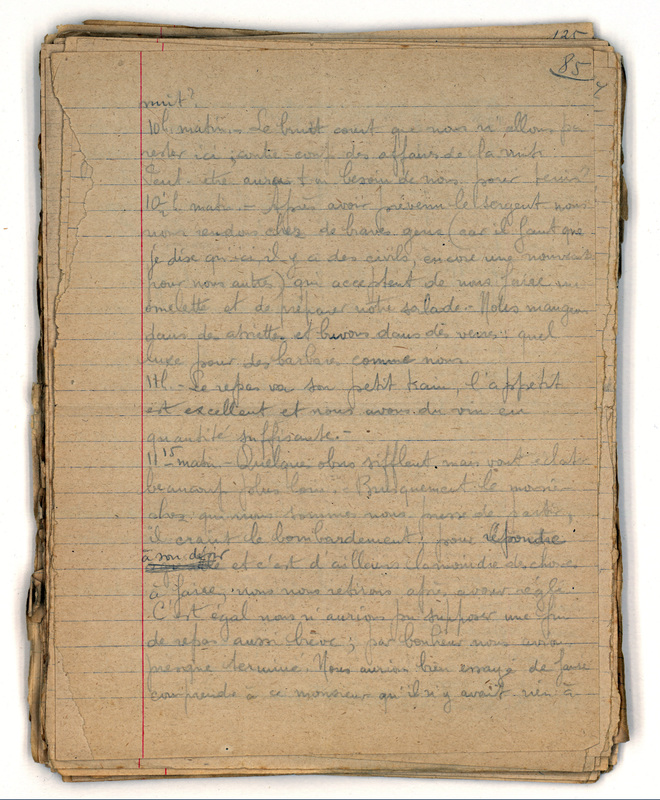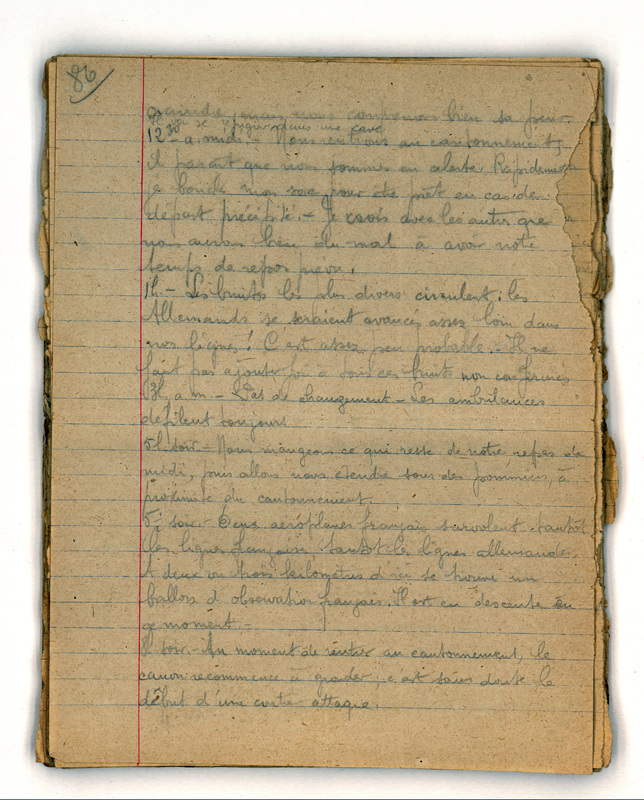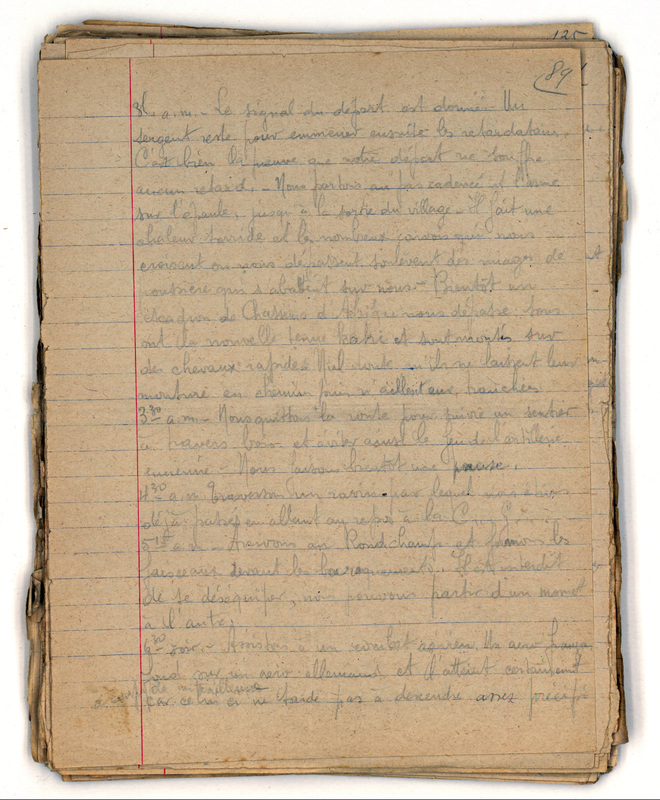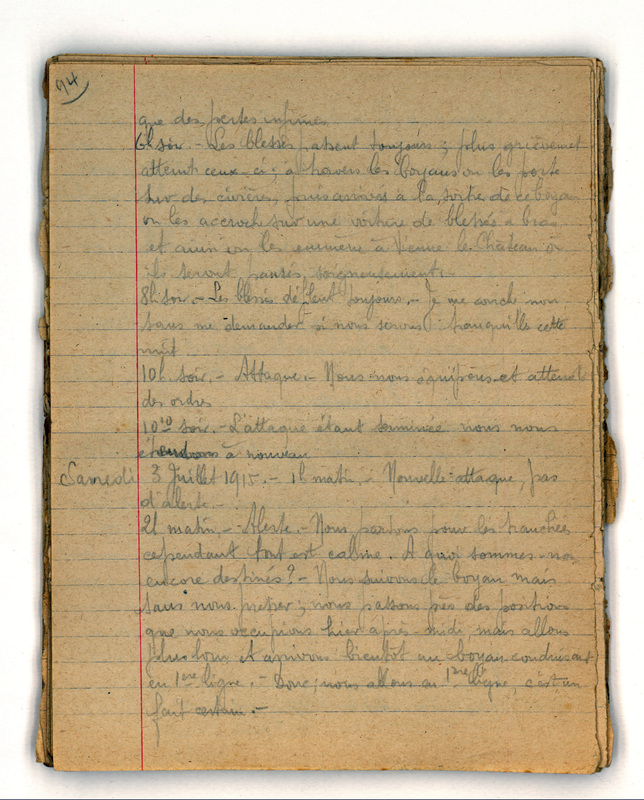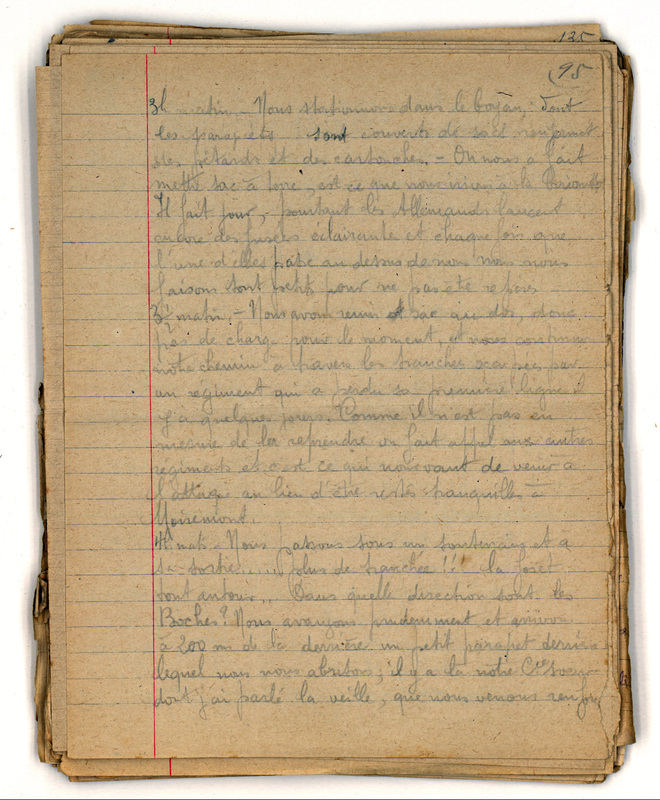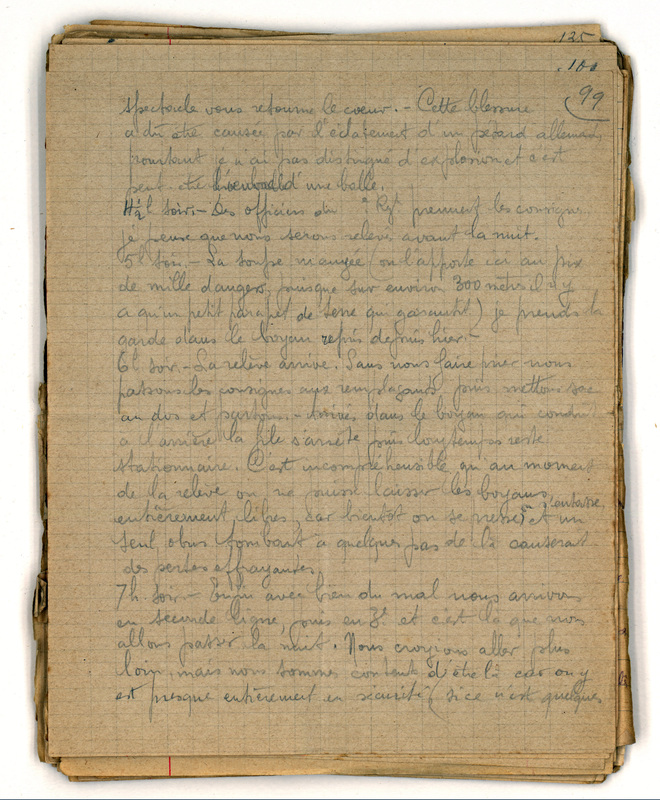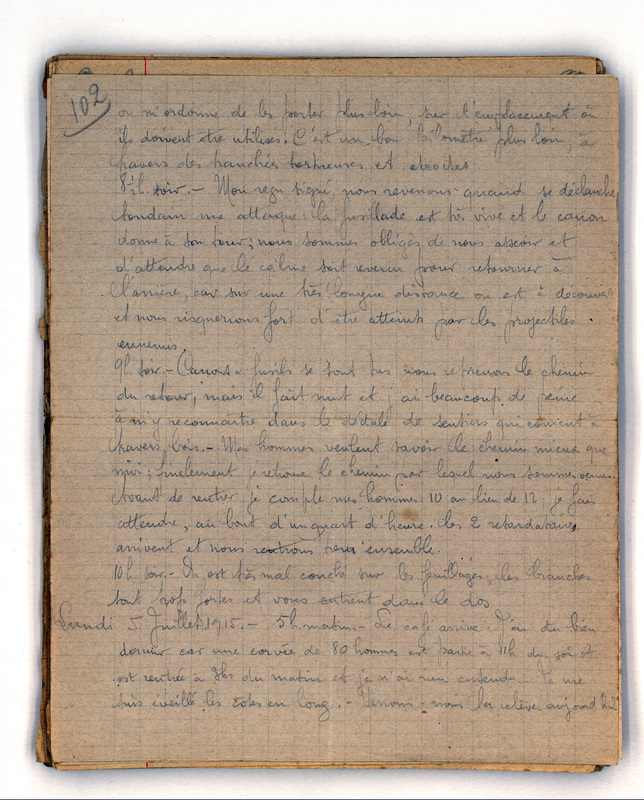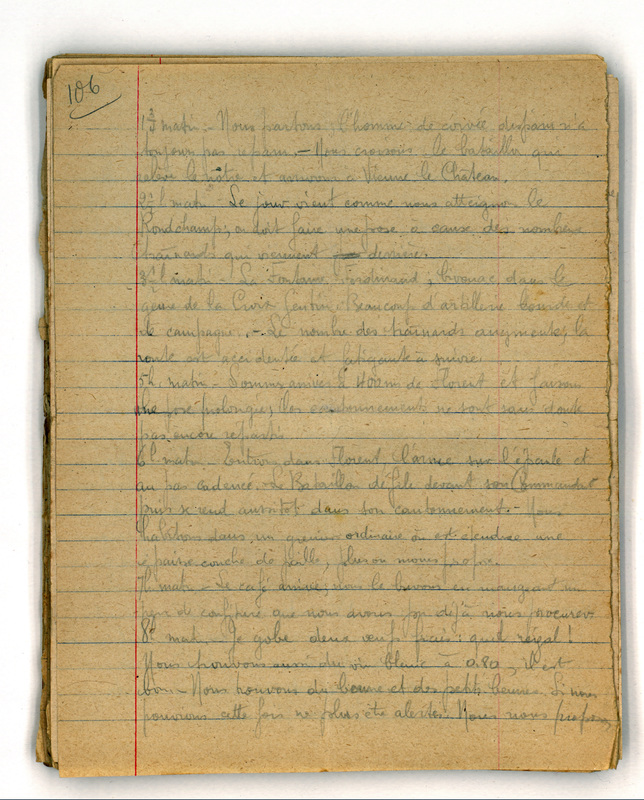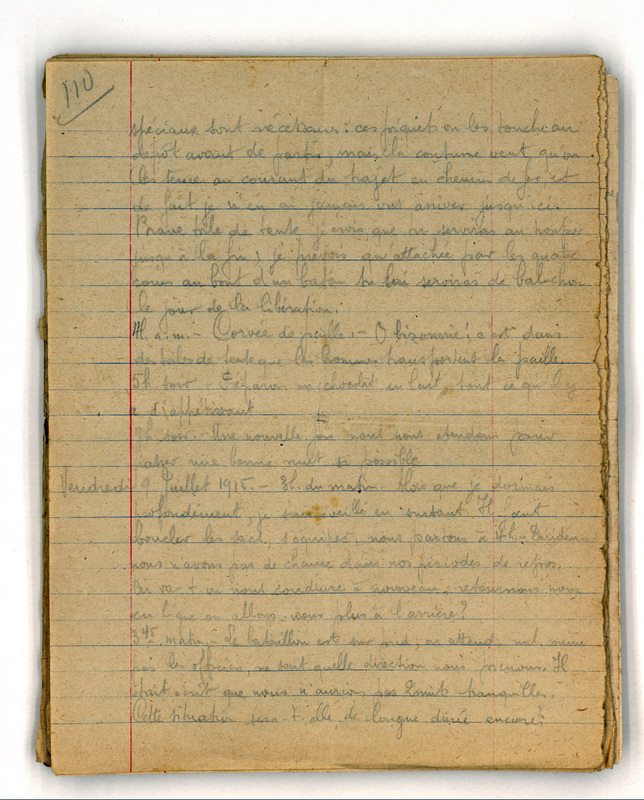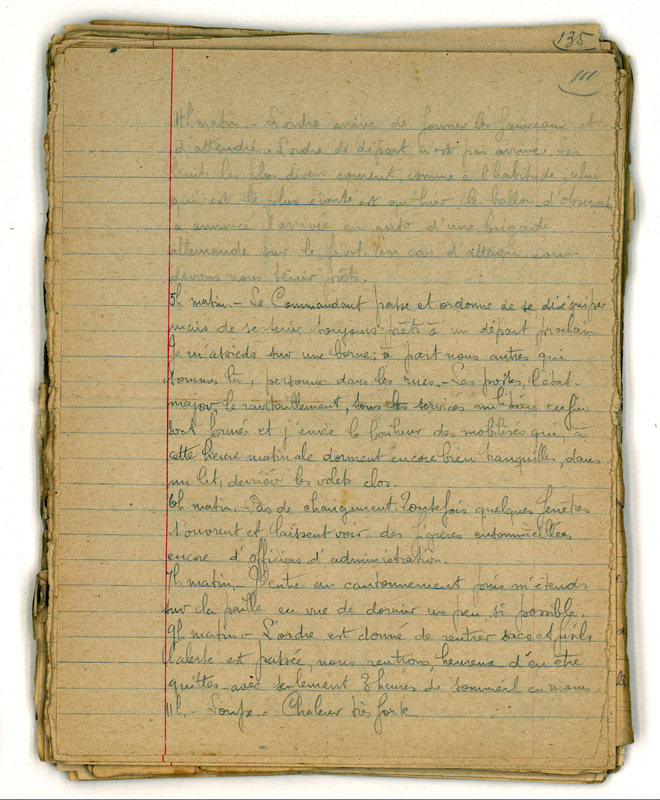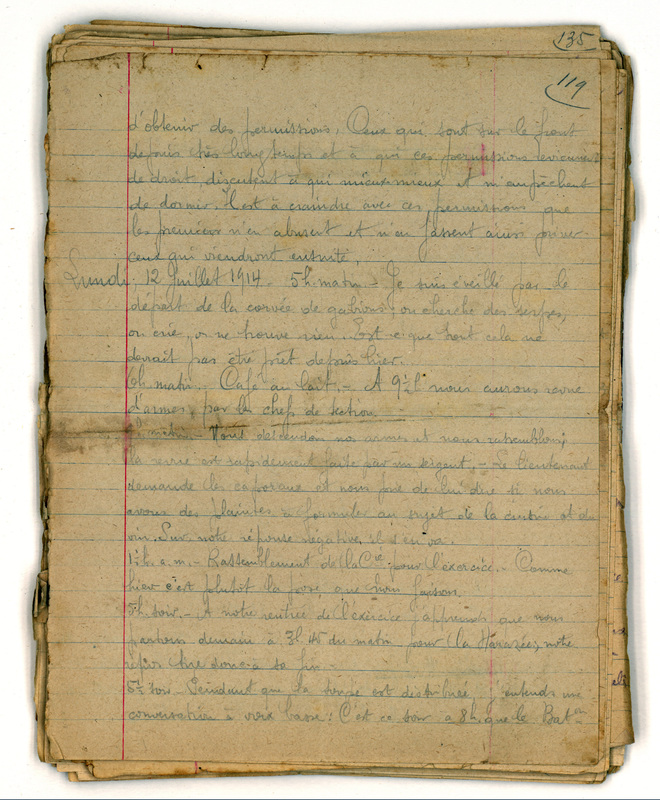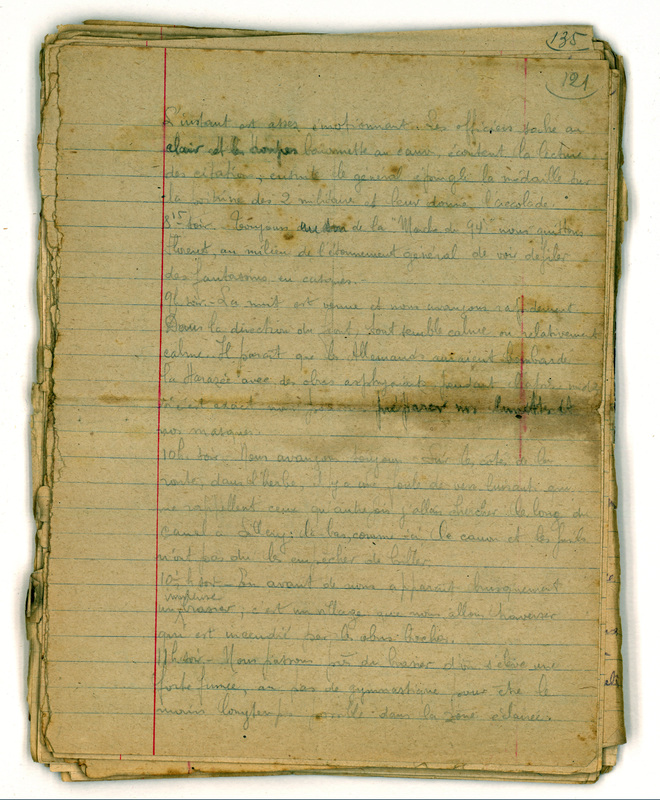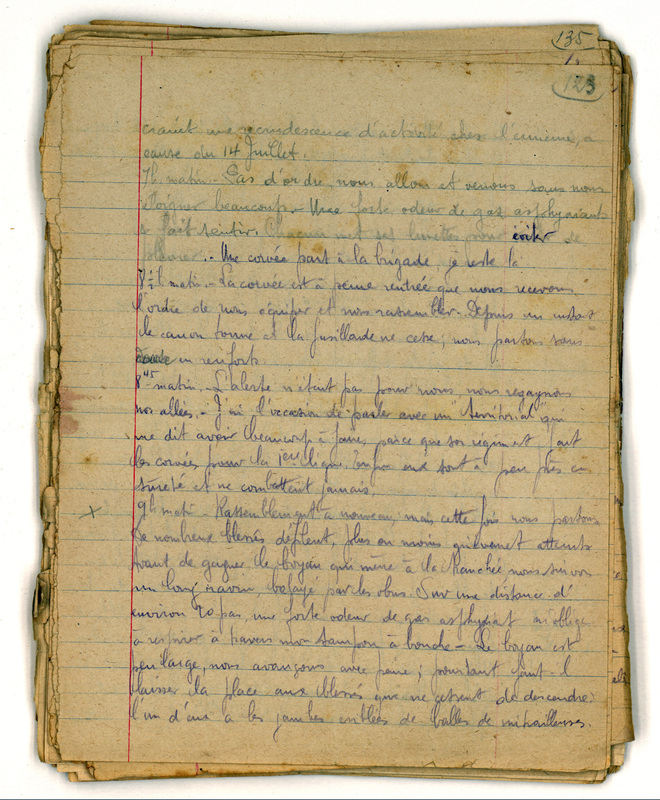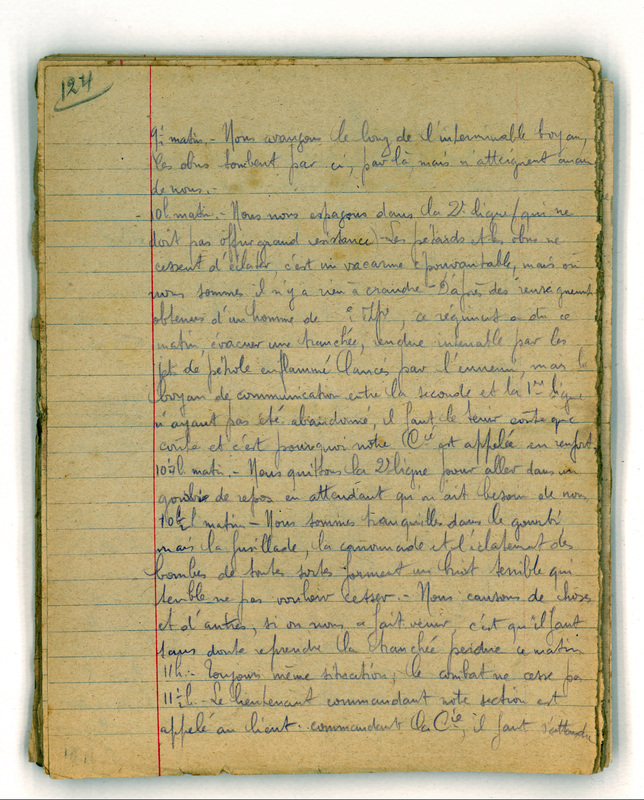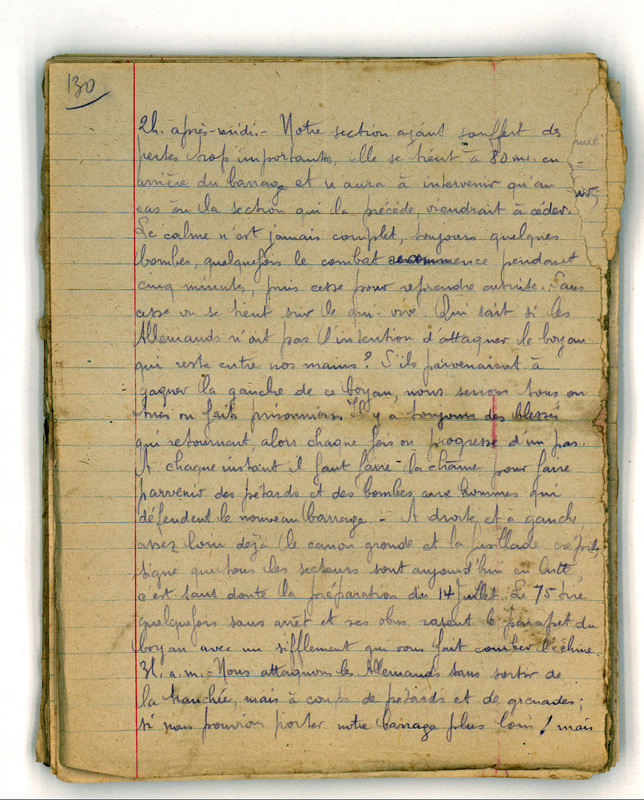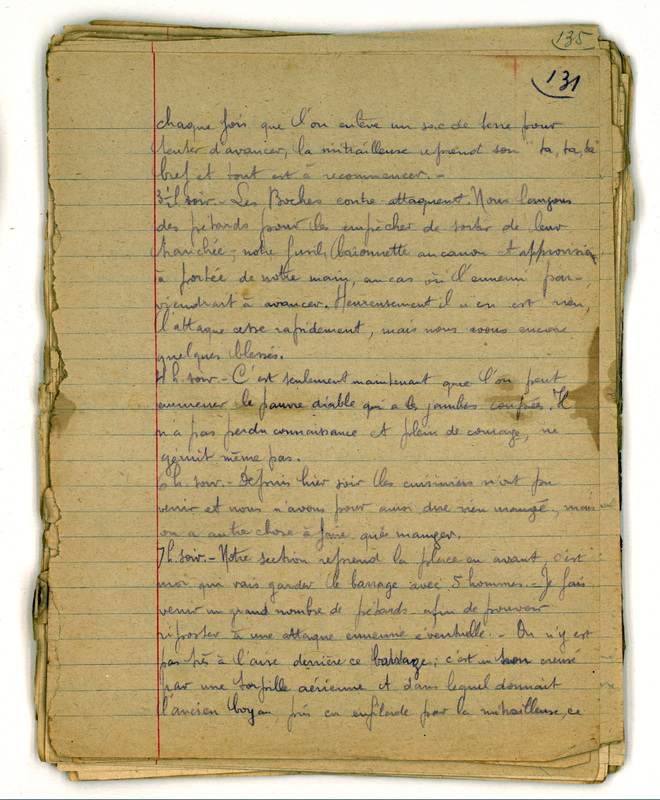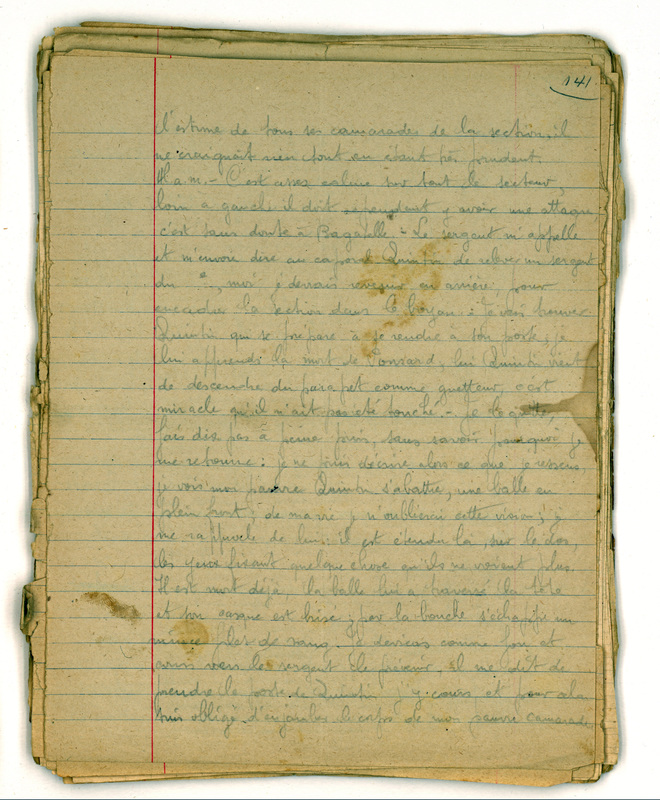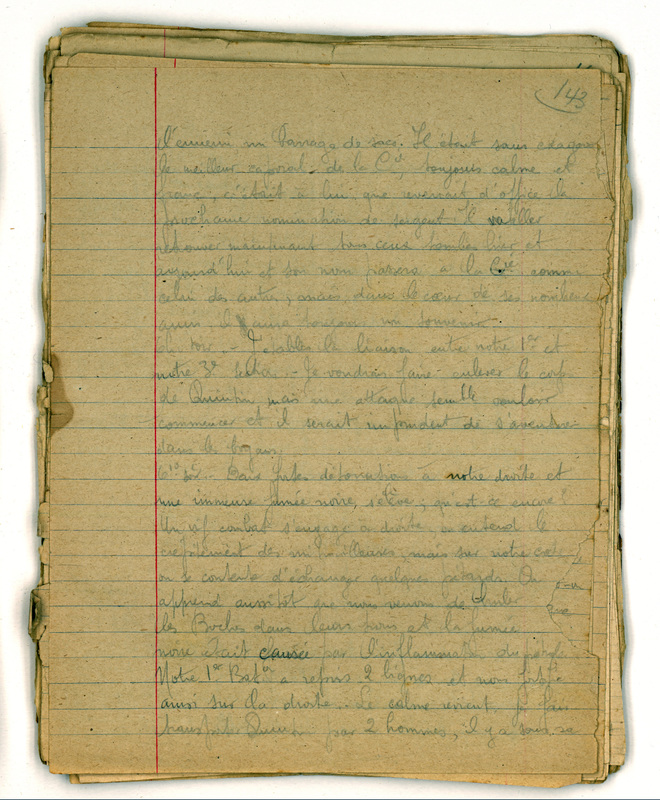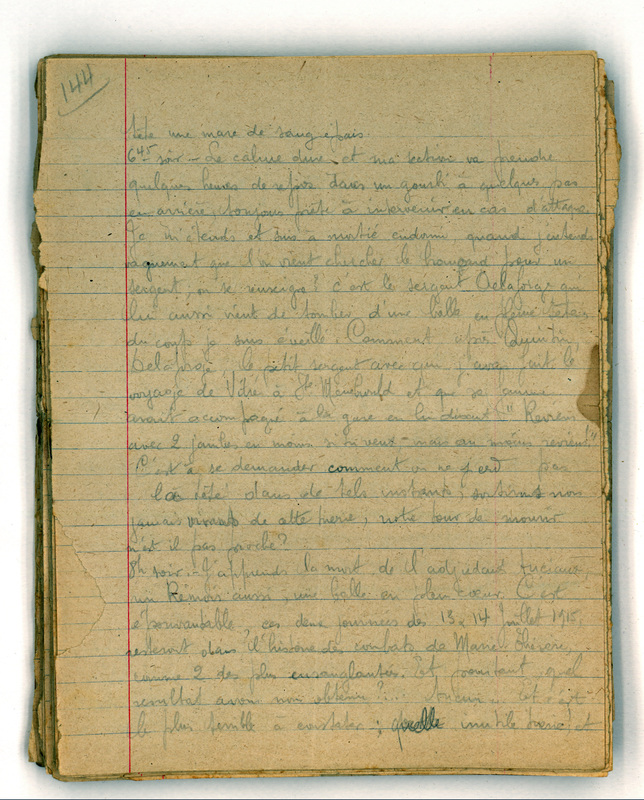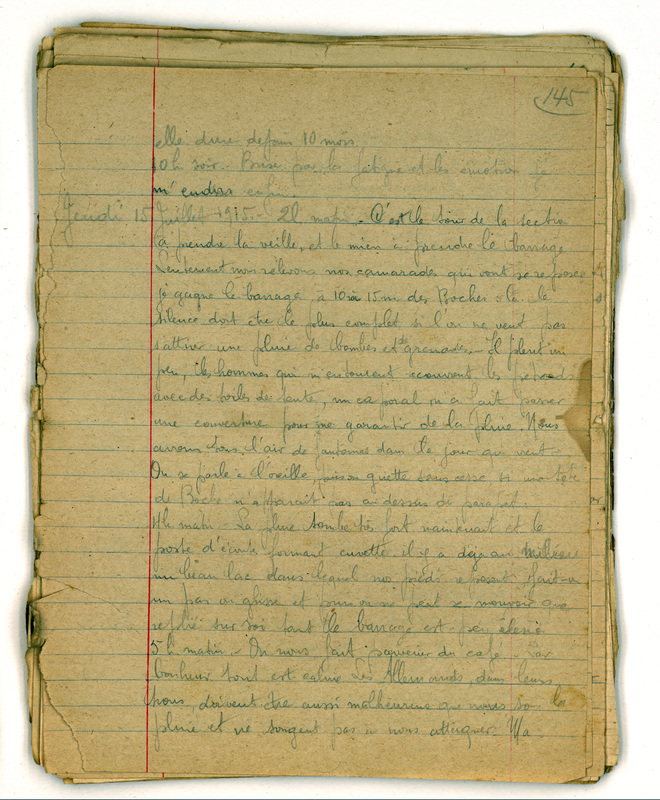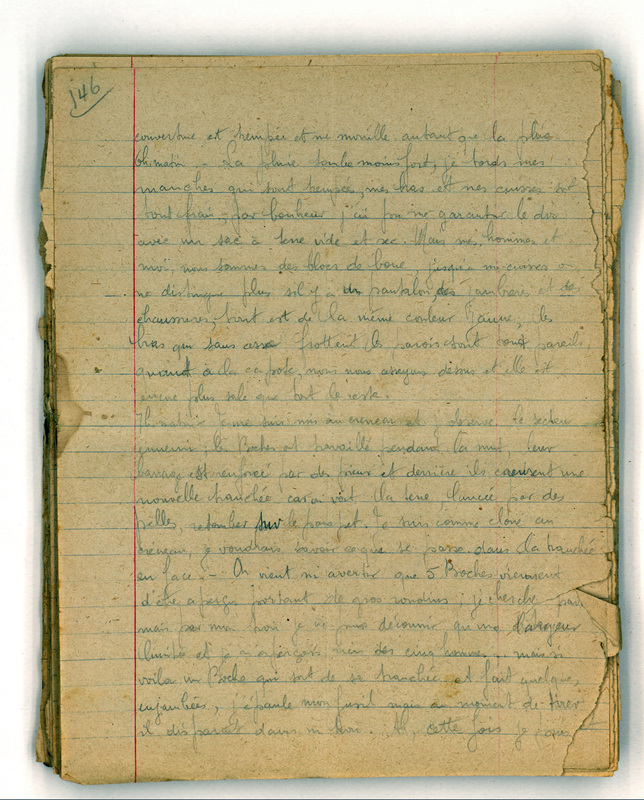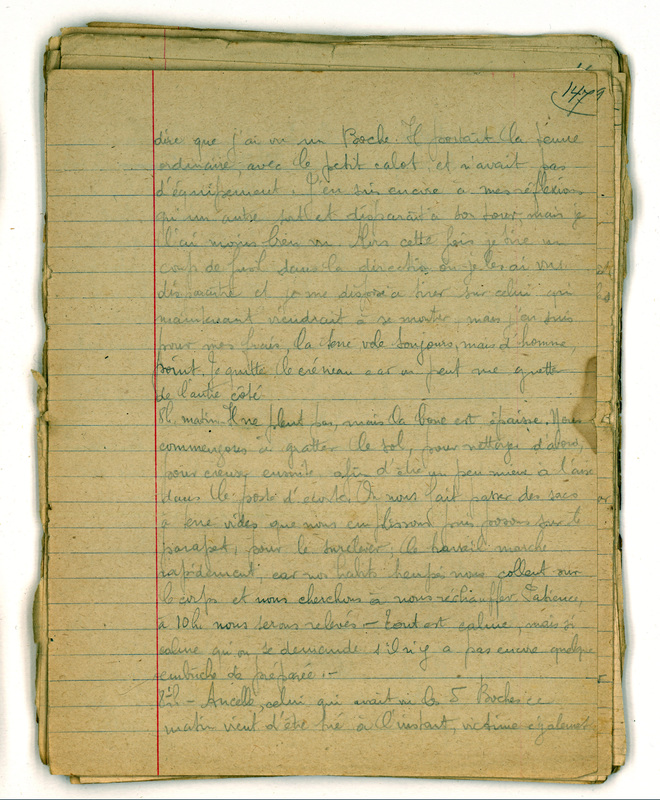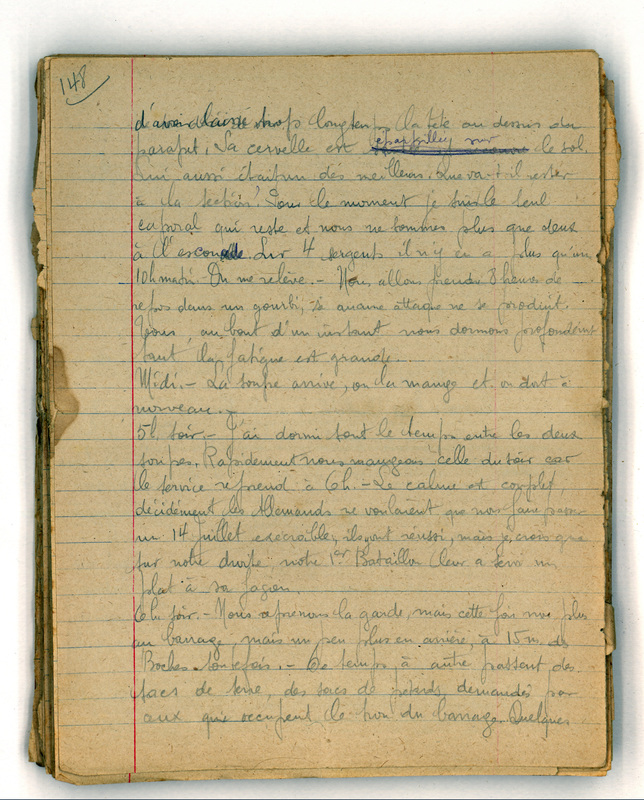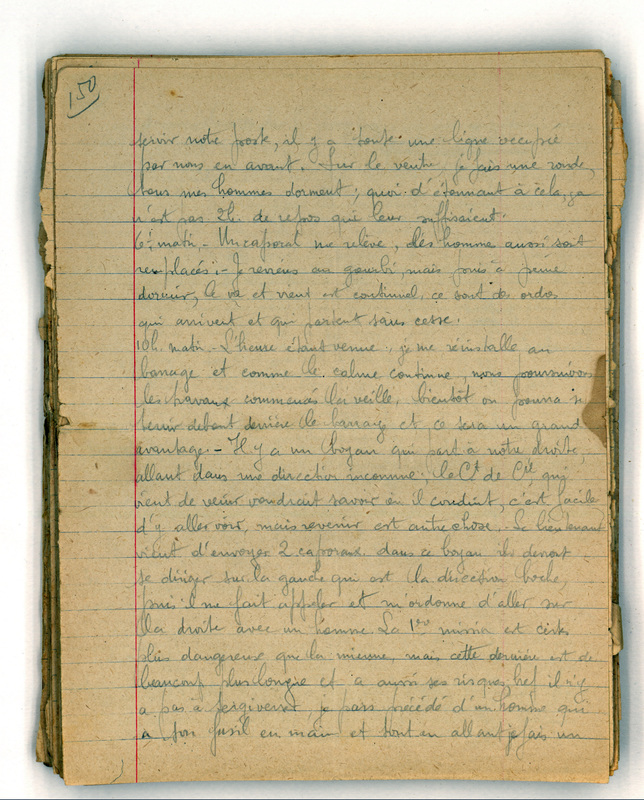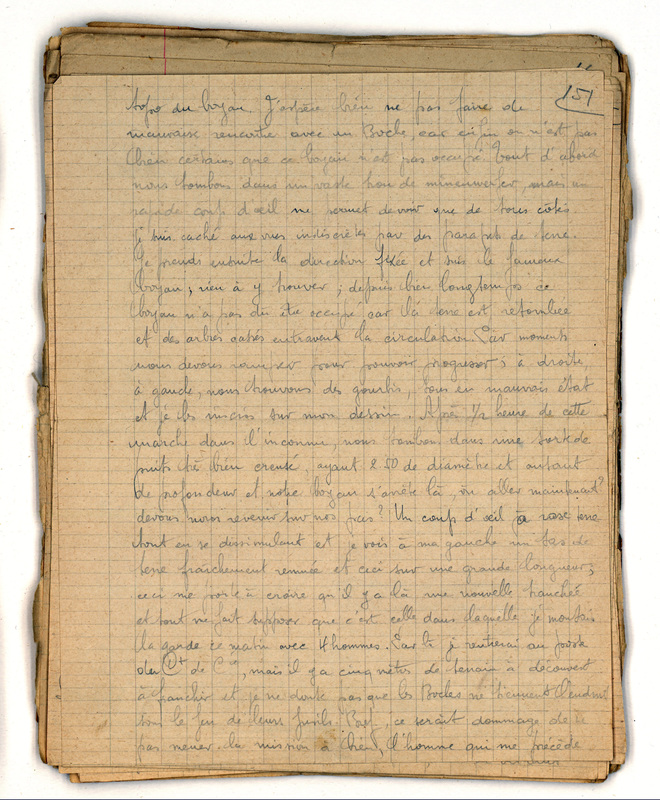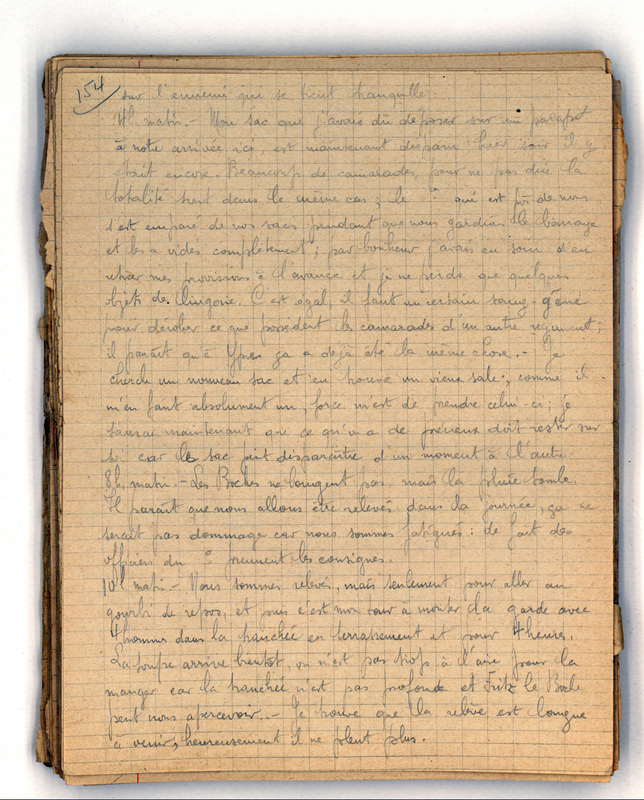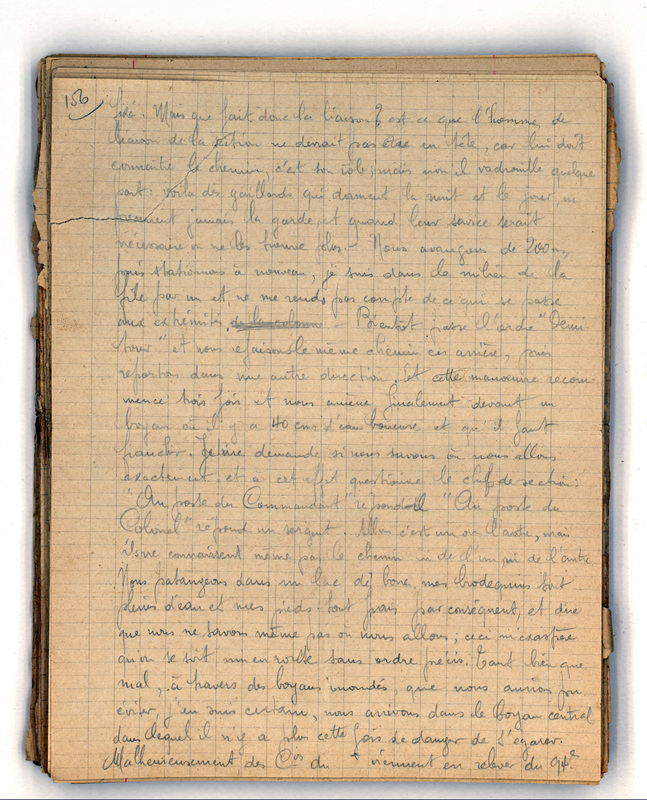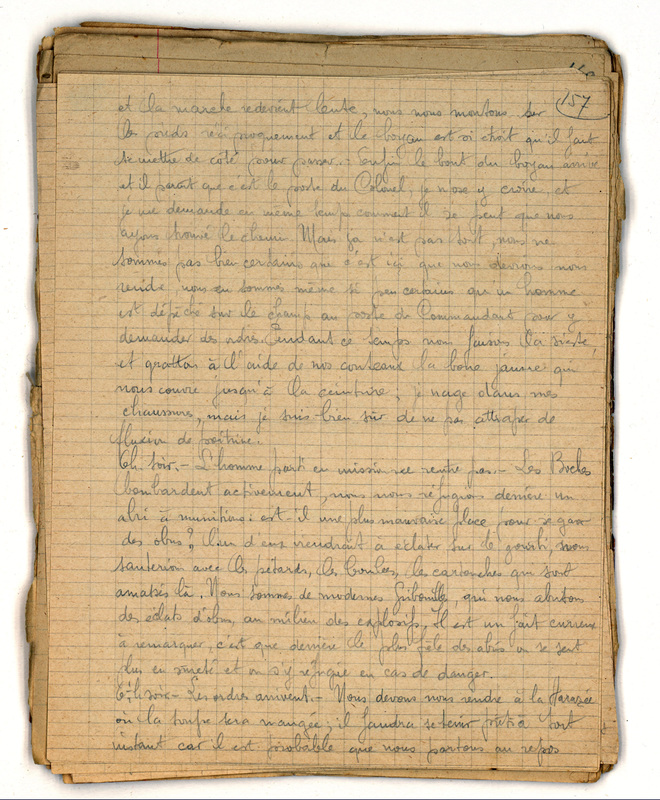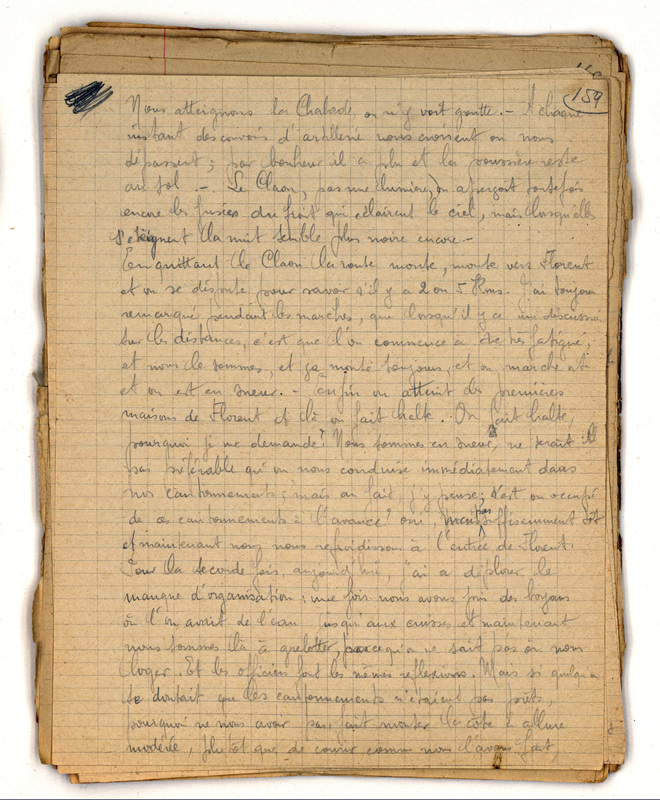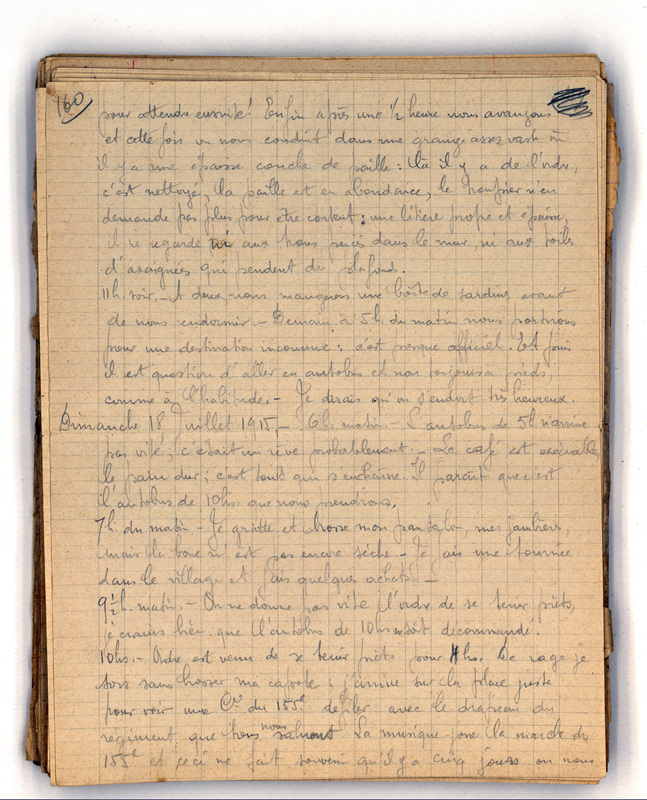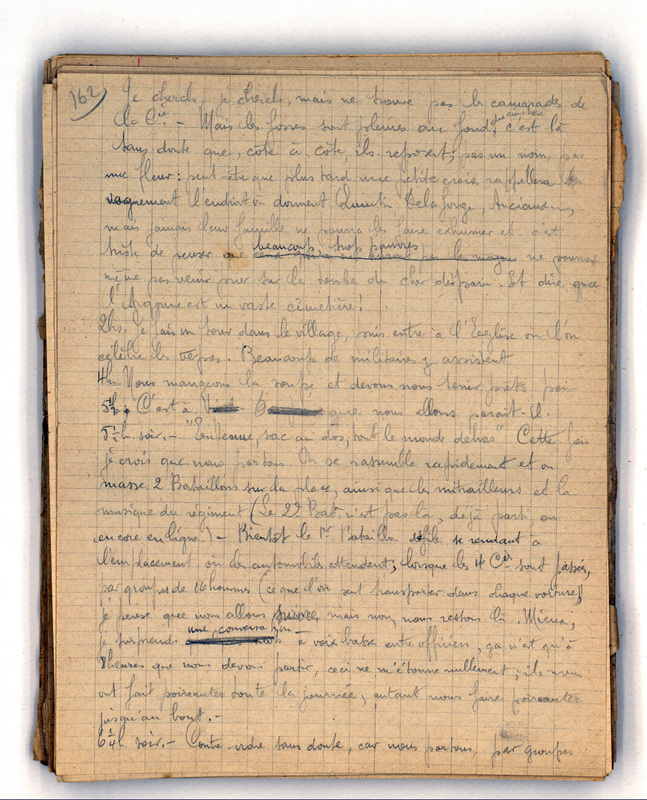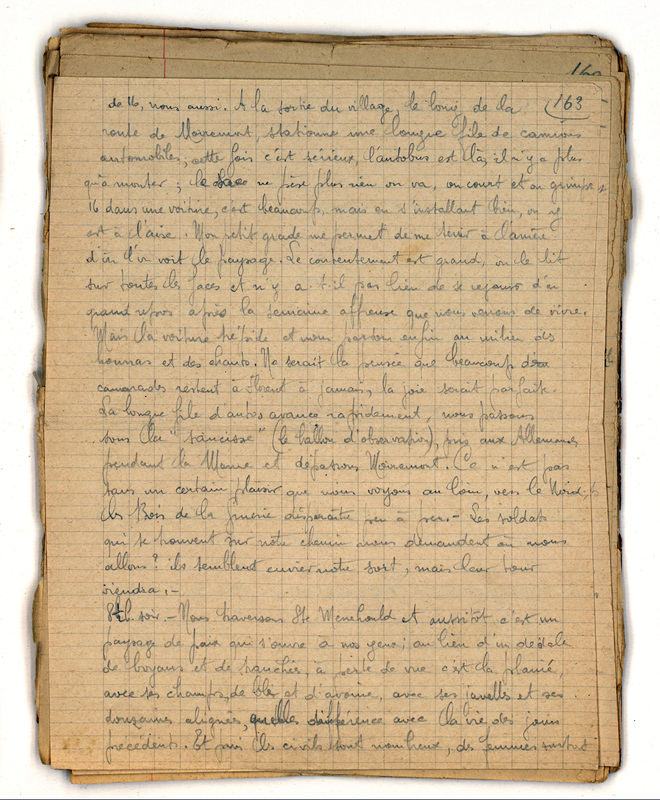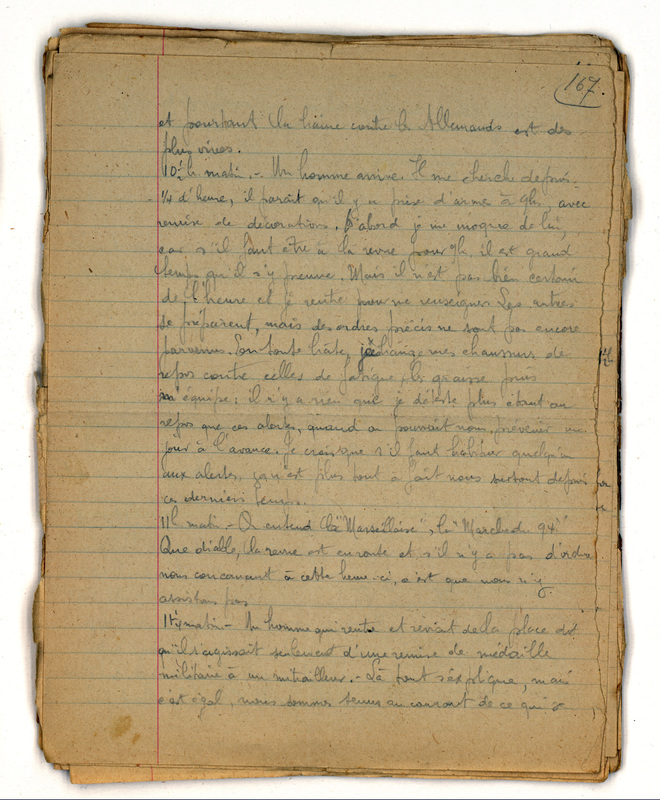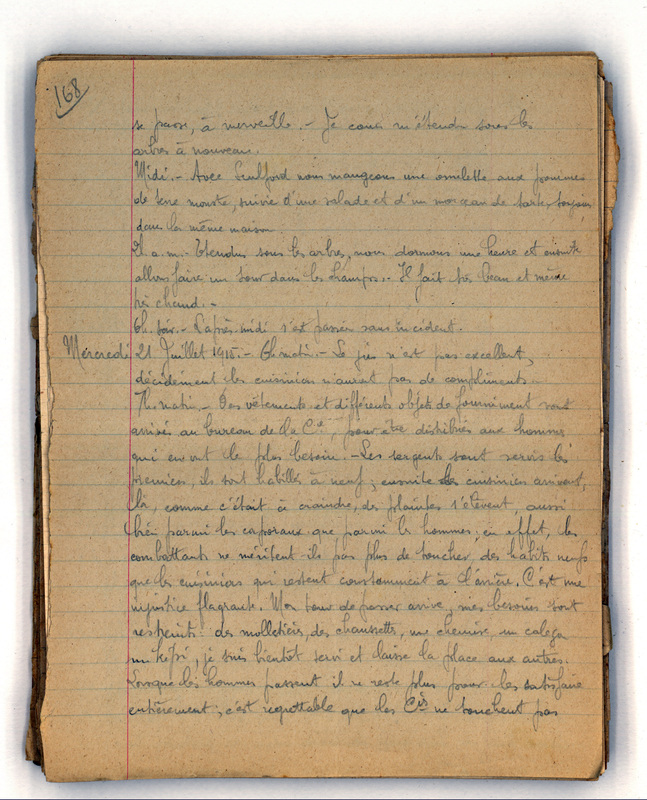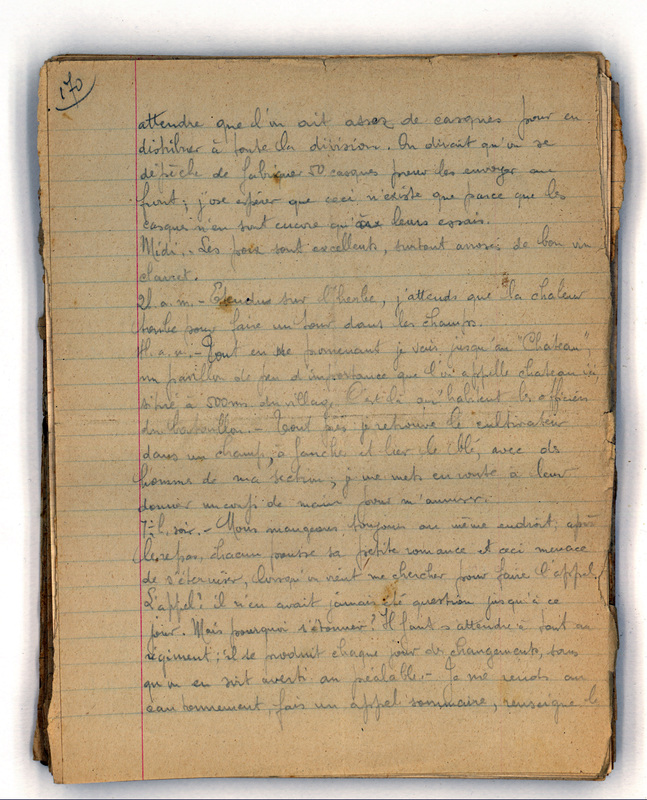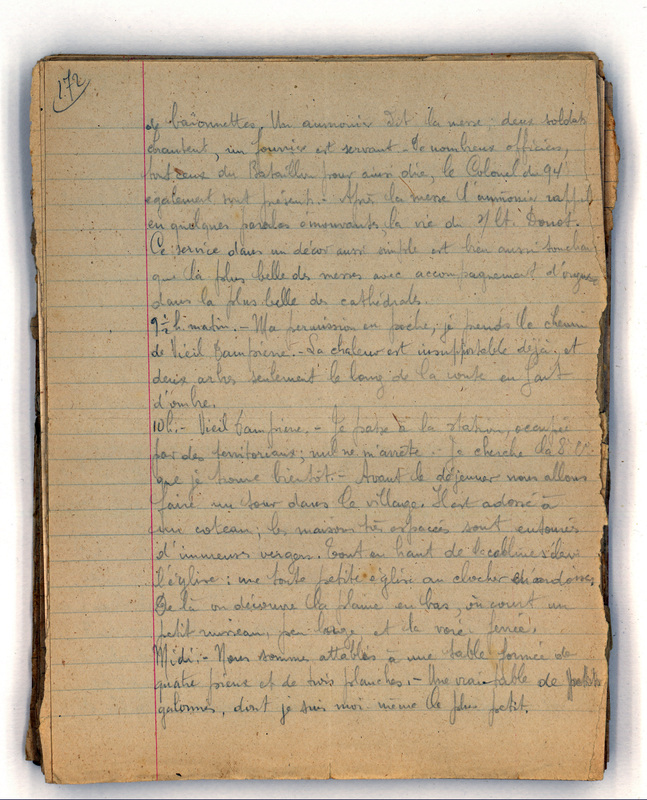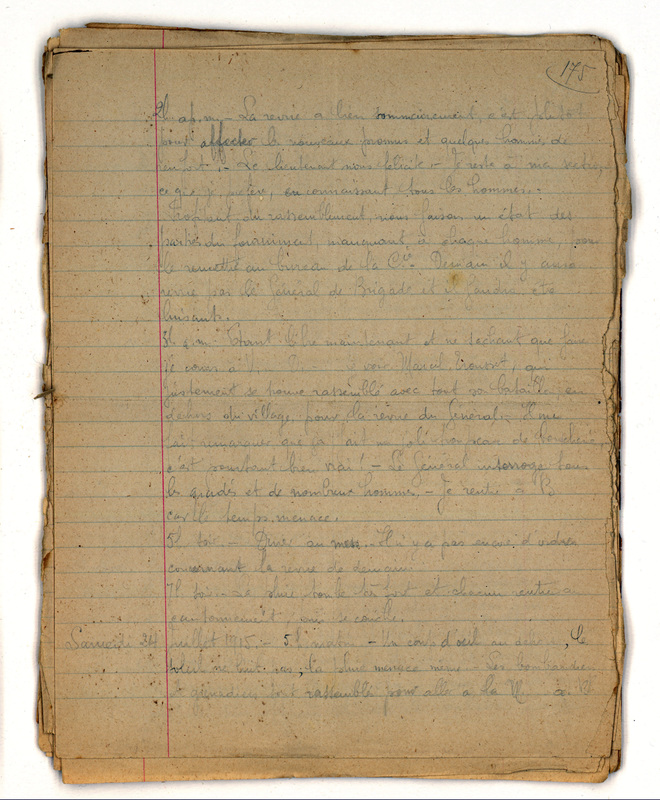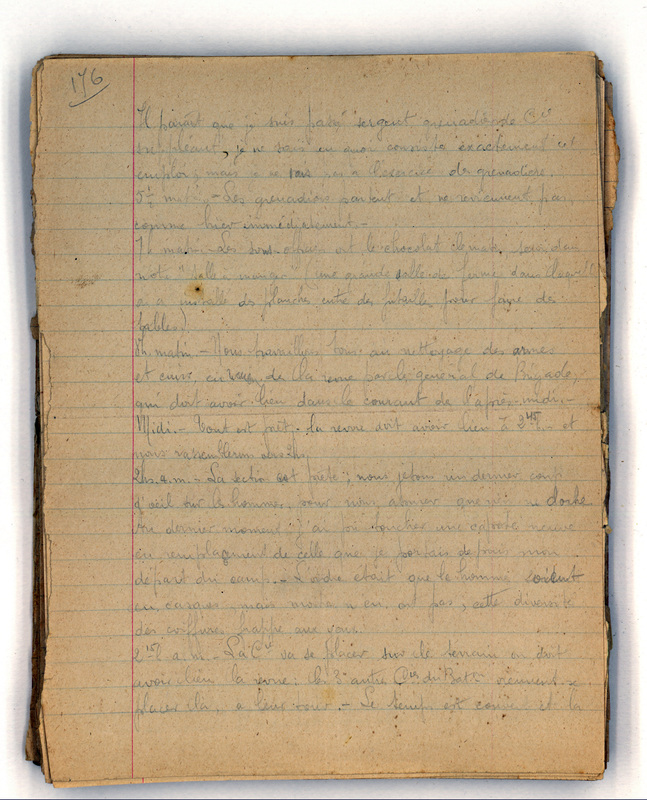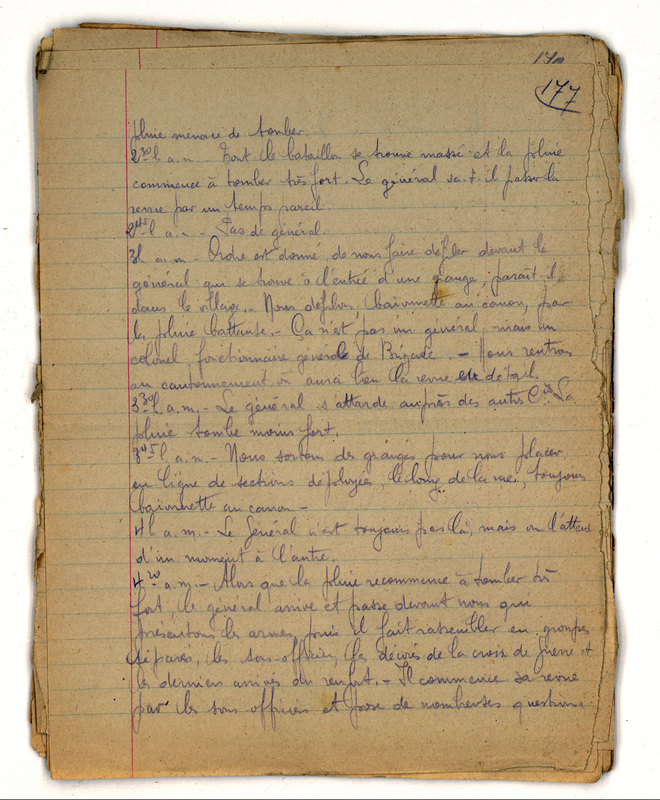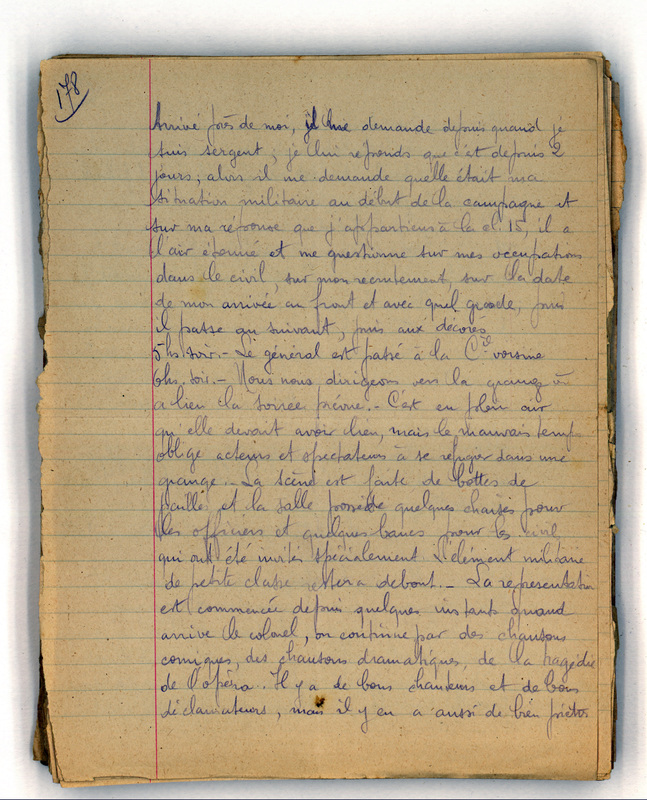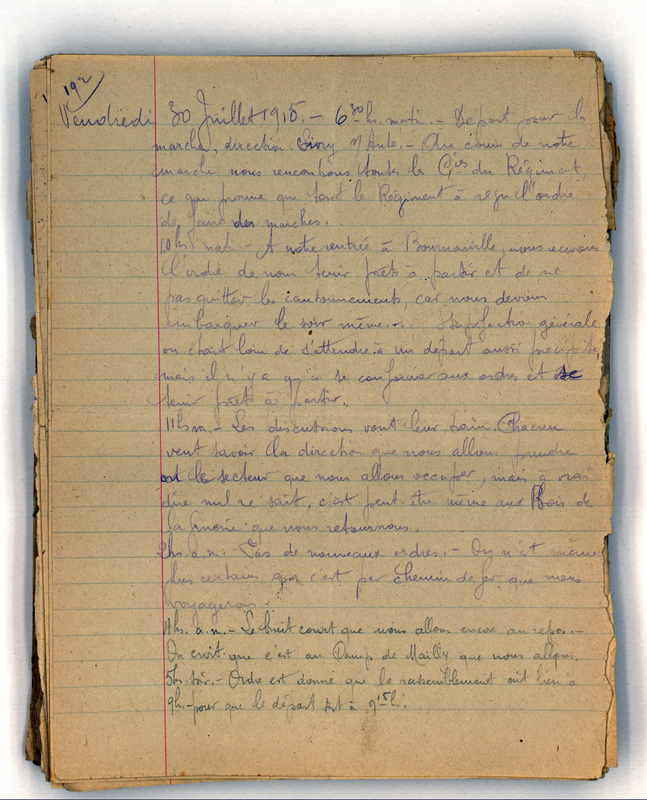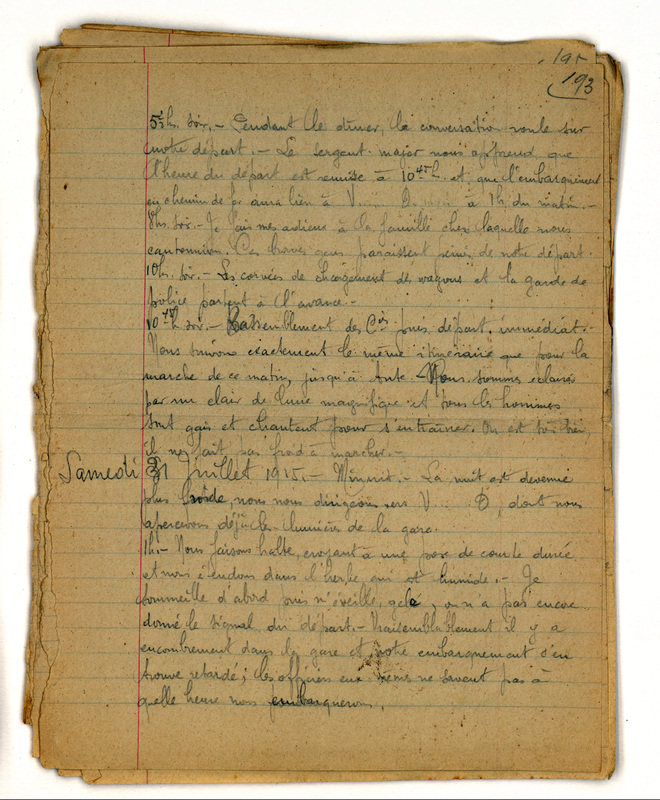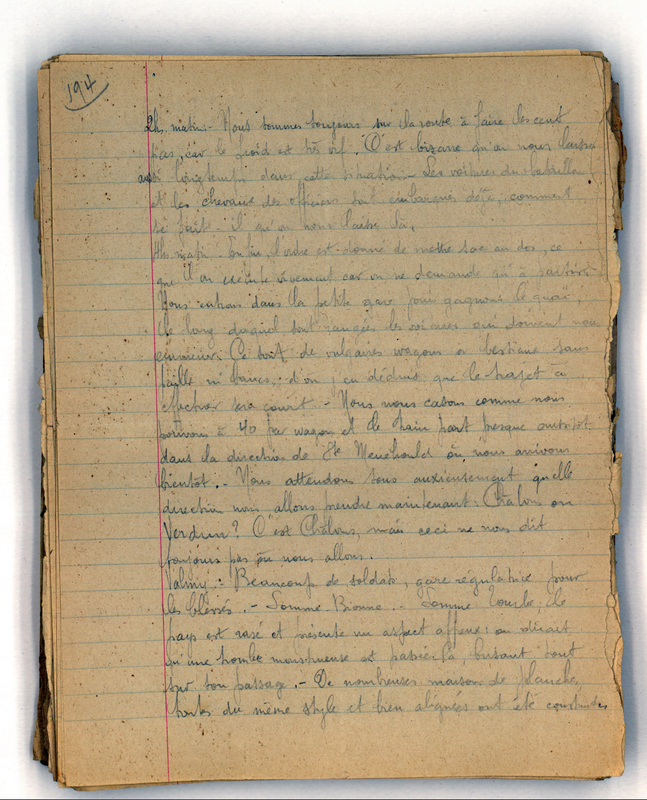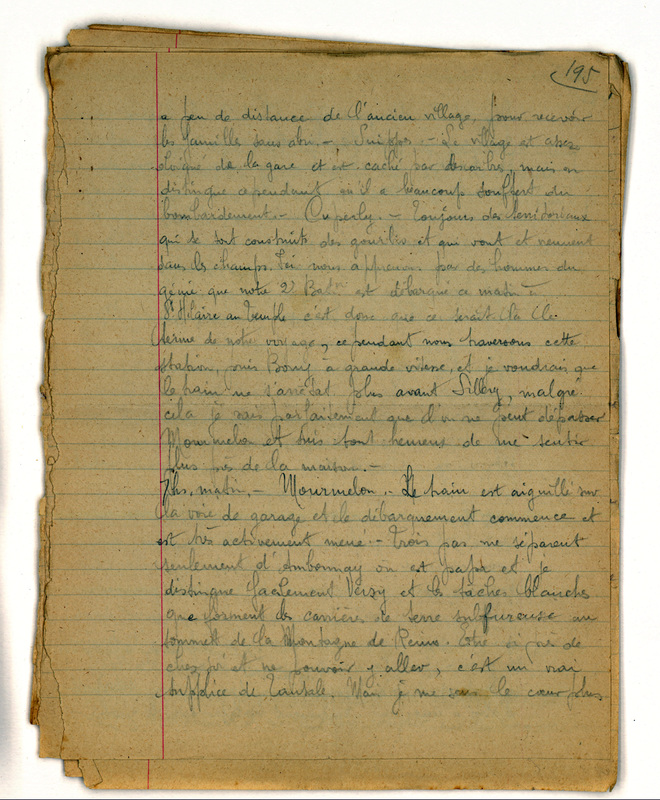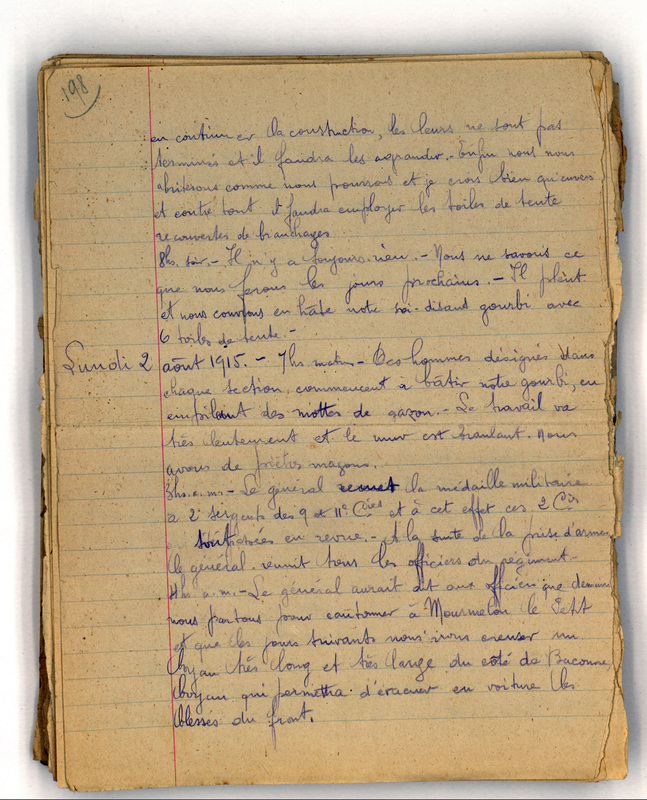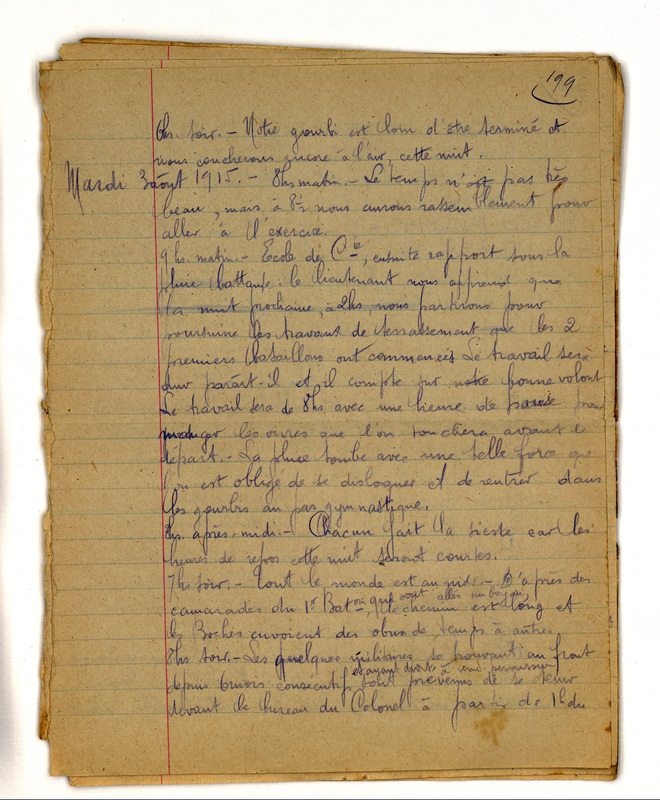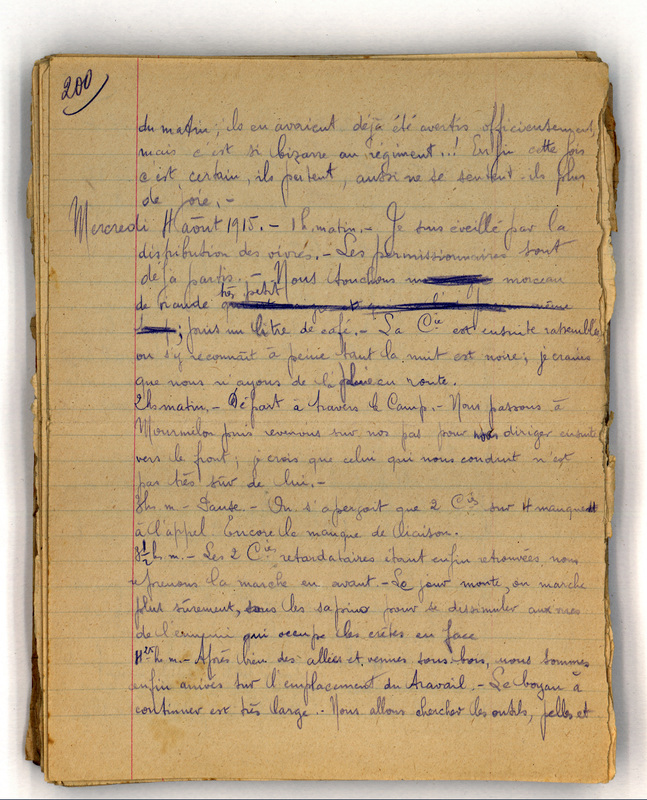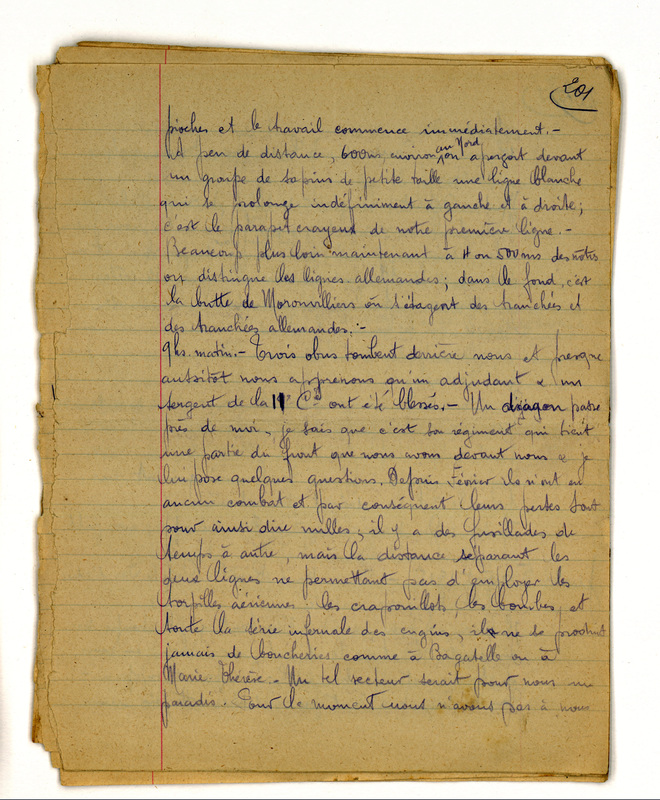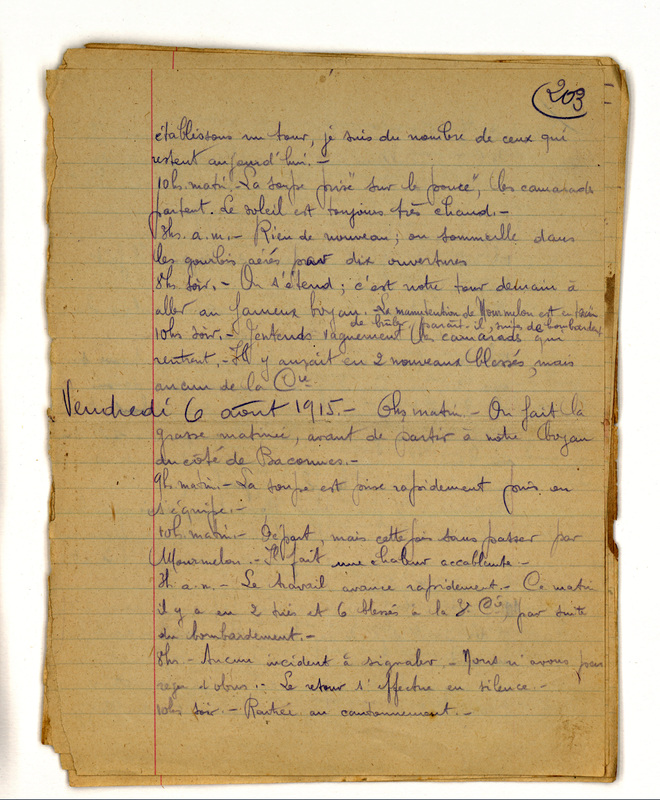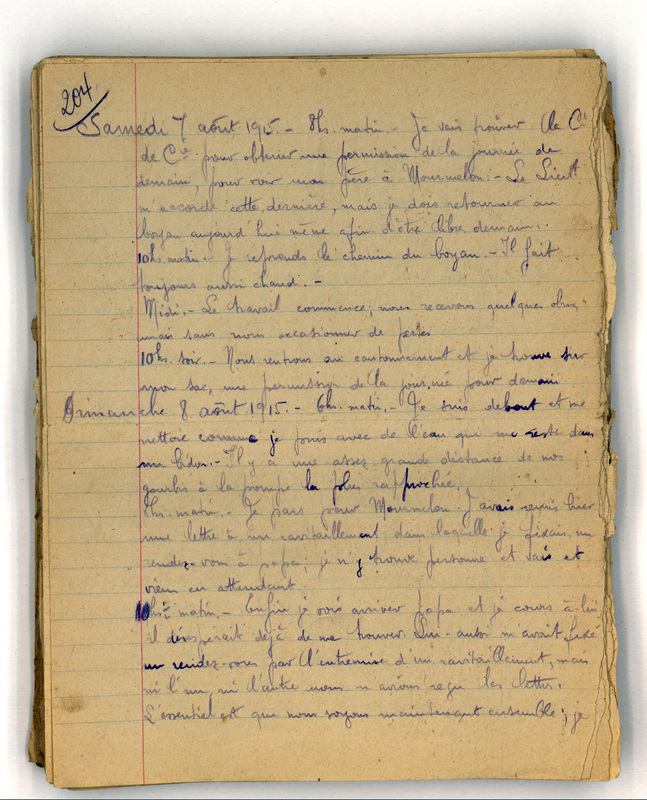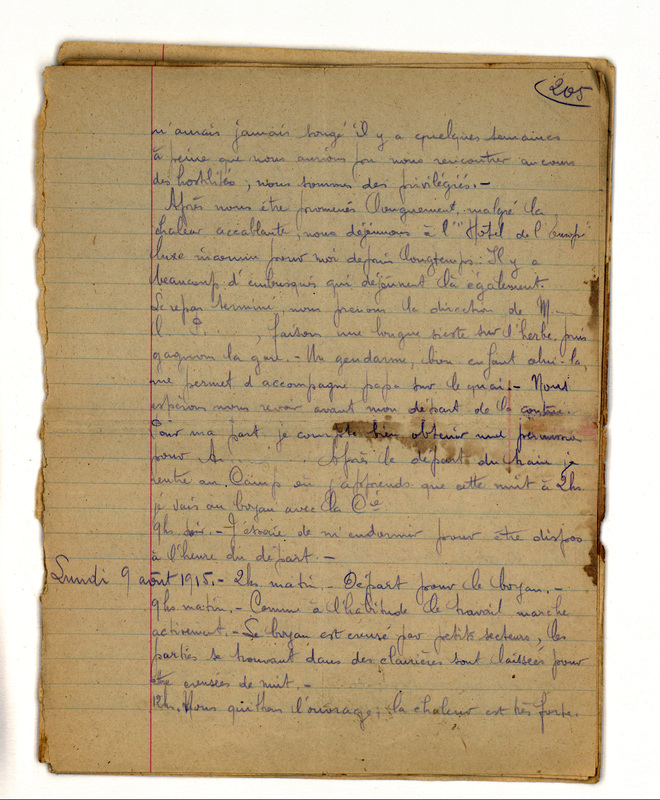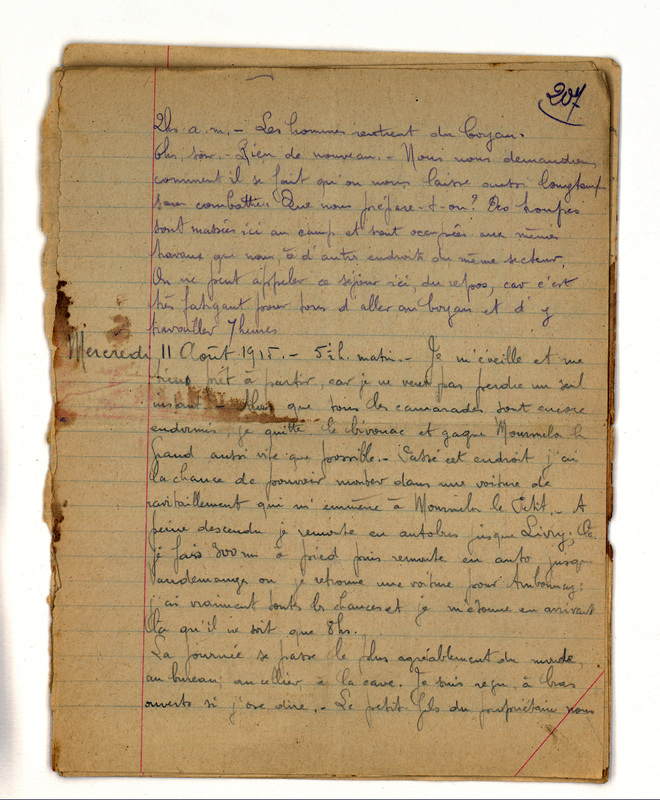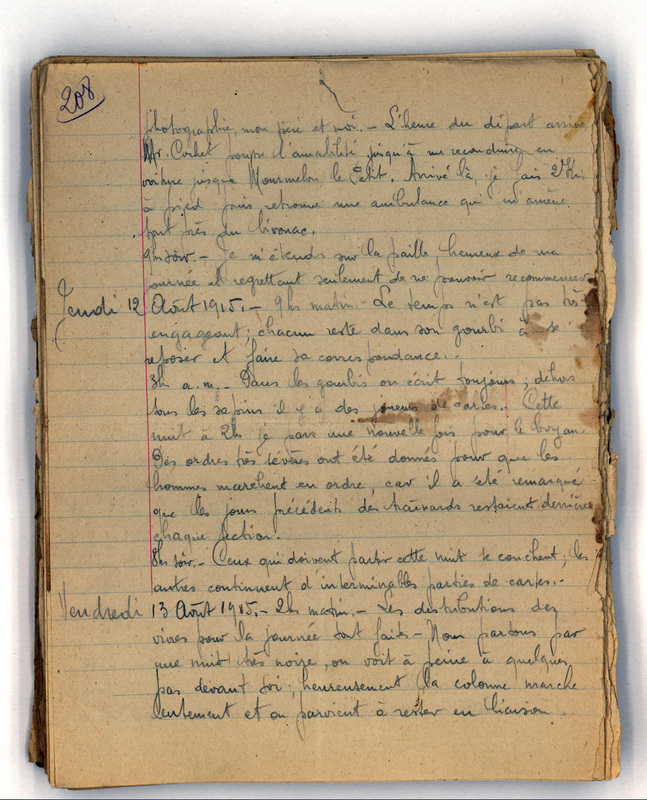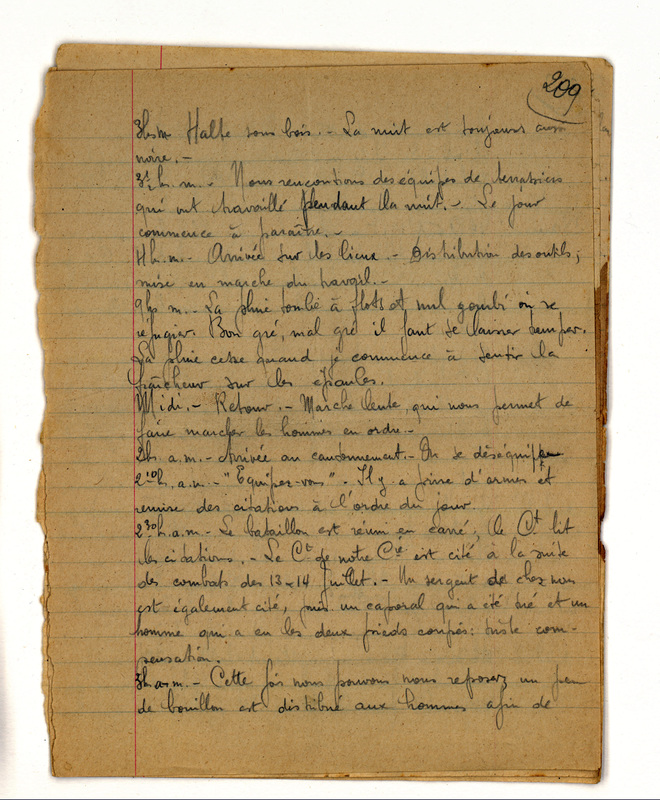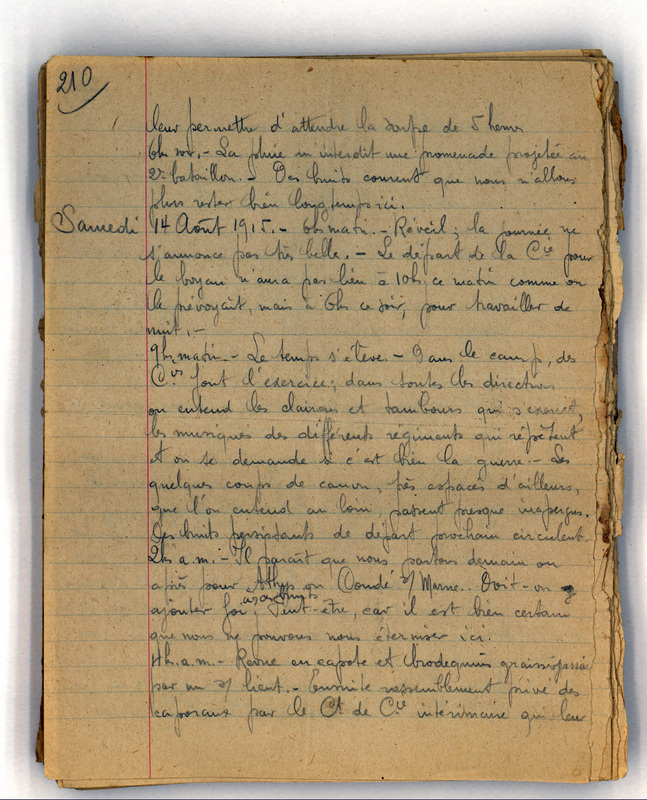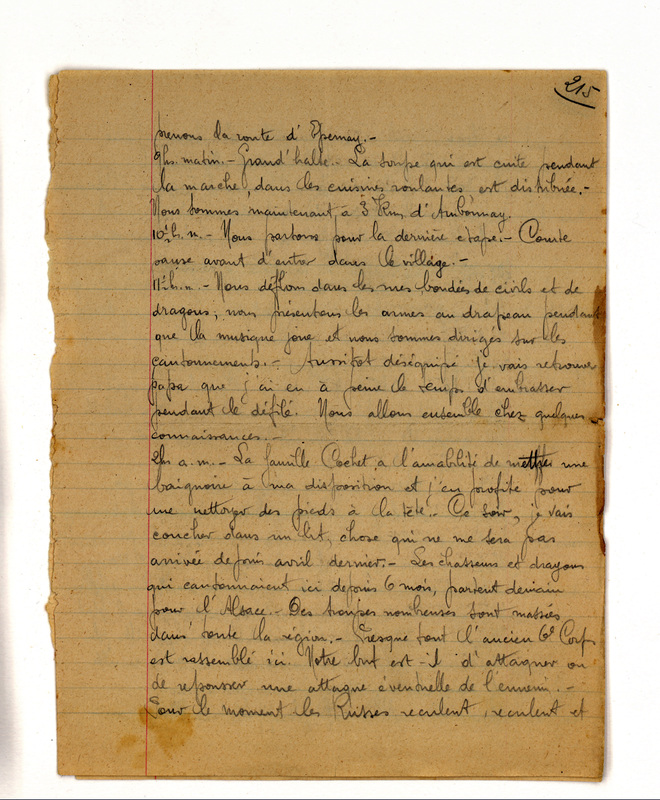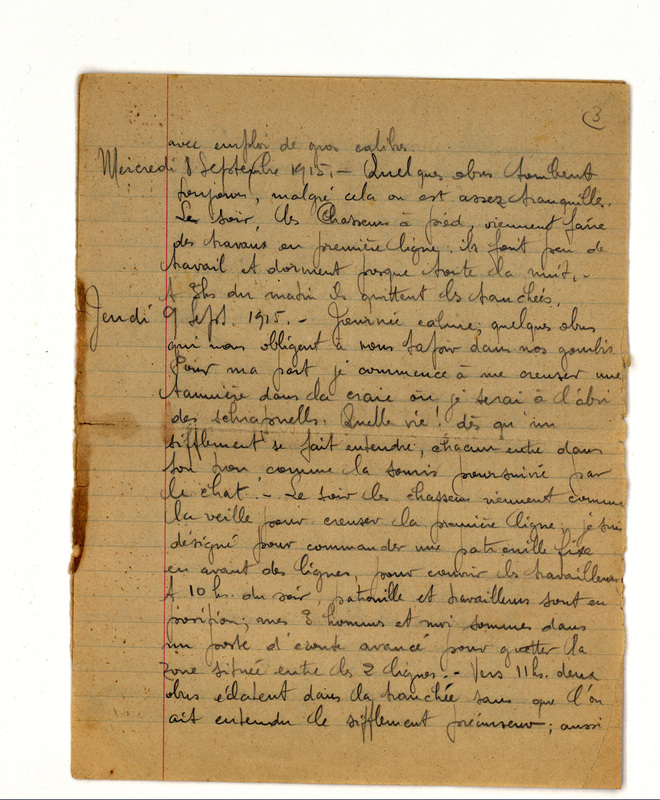Dimanche 23 mai 1915
9h00 — Nous sommes complètement équipés ; les vivres de réserve et de voyage sont touchés ; nous attendons dans la cour de la caserne que le signal du départ soit donné. Les bruits les plus divers circulent : nous allons au nord d’Arras où la lutte est chaude, nous servirons de renfort au 94 en Argonne, nous sommes destinés au corps expéditionnaire des Dardanelles. À vrai dire, nul ne sait, mais chacun veut dire son mot.
11h00 — Nous mangeons la soupe à la caserne. Défense expresse de sortir ; l’heure du départ doit être proche.
13h00 — Rien encore ; tout le monde dort sous les arbres. La chaleur est accablante.
15h00 — Sac au dos ; départ de la caserne, puis répartition des sections dans les wagons. Nous tombons sur un petit compartiment de cinq places que nous occupons à cinq camarades : deux sergents et trois caporaux.
15h30 — Arrivée d’un détachement du camp de Coëtquidan que l’on attache à notre convoi.
16h00 — Le train quitte Vitré au milieu des hourras : il y a cependant moins d’enthousiasme qu’au début.
18h00 — Laval.
21h00 — Le Mans. Dans chaque petite station où nous faisons halte, on nous apporte des fleurs dont nous garnissons les wagons.
Lundi 24 mai 1915
3h00 — Arrivée à Chartres. Arrêt de quatre heures. Allons-nous être dirigés sur le Nord ou sur l’Est ?
7h00 – Départ ; direction : Orléans. Nous cueillons toujours fleurs et branchages ; notre wagon est particulièrement bien fleuri.
12h00 — Les Aubrais. Nous allons bien sur l’Est, probablement en Argonne.
14h00 — Montargis. Nous apprenons la déclaration de guerre de l’Italie à l’Autriche : contentement général. On voudrait des journaux ; impossible d’en trouver.
17h00 — Sens. Nous avons des journaux ; les nouvelles concernant la rupture entre l’Italie et l’Autriche sont encore peu nombreuses.
Soirée — La Roche. Saint Florentin.
Mardi 25 mai 1915
4h00 – Bologne ; quart de « jus ».
7h00 — St Dizier ; nous allons certainement en Argonne.
8h00 — Givry-en-Argonne. Nous approchons ; tous les villages sont remplis de soldats.
9h30 — Sainte-Menehould. Terme du voyage en chemin de fer ; nous continuons la route à pied jusque Florent. Chaleur torride et chargement plus que complet ; nous sommes obligés de faire plusieurs pauses. C’est la forêt de tous côtés, et des montées et des descentes. Nous entendons les premiers coups de canon.
12h00 — Florent. Multitude de soldats.
13h00 — Cantonnons dans un grenier, sur de la paille. Chacun se place comme il peut.
14h00 — Nous déjeunons d’une boite de « singe ».
15h00 — Corvée de paille. La musique du 328ème donne un concert.
Mercredi 26 mai 1915
9h00 — Nous préparons le café et la soupe, par escouade, avec les vivres qui nous ont été donnés et dans les campements emportés de Vitré.
10h00 — Grand repas au bivouac : c’est excellent.
15h00 — Préparons maintenant le repas du soir.
17h00 — On nous annonce que nous partirons demain renforcer le 3ème Bataillon.
Jeudi 27 mai 1915
6h00 — Debout. Préparation du café et de la soupe.
8h30 — Revue des hommes pour le renfort.
10h00 — Départ pour le 3e Bataillon. Chaleur torride ; plusieurs pauses nécessaires. Le premier fort coup de canon éclate derrière nous ; la surprise nous fait sursauter.
11h00 — nous atteignons La Chalade ; un groupe de nos camarades quitte la colonne sans que nous puissions leur faire nos adieux. De chaque côté, des gourbis de l’artillerie se cachent sous les arbres, il y a là une ville entière de petites maisons de toutes formes et construites soit en
bois, soit en chaume ; l’artillerie a l’air là tout-à-fait en sûreté, ainsi
que les chevaux, à qui on a construit également des écuries en feuillages.
12h00 — Nous atteignons les premiers gourbis de l’infanterie, creusés dans la pierre et étagés sur le versant d’une colline ; il y a des centaines de ces petites maisons habitées en ce moment par de l’infanterie de marine au repos. Chacun a apporté son aide dans la fondation de cette ville souterraine et chacun s’est ingénié à obtenir quelque chose de plus confortable. Et puis l’autorité militaire a fourni au soldat ce qui lui est nécessaire et qu’il ne peut trouver sur place ; et c’est ainsi que l’on voit des cuisines, des lavoirs avec lessive, des poêles dans les gourbis. Nous suivons le bas de la colline et le genre de construction ne tarde pas à changer ; ce sont maintenant des baraquements en bois adossés à la colline et recouverts de branchages, pour ne pas servir de cible facile aux aéras.
13h00 — Beaumanoir, petit village de l’Argonne qui a peu souffert du bombardement à cause de sa situation adossée à une colline ; c’est le lieu de repos actuel du 3ème Bataillon du 94, le terme de notre marche.
14h00 — Nous venons d’être affectés ; le bataillon se trouve au repos pour cinq jours, nous en profitons.
Folio 5
16h00 — J’ai pris place dans un grand baraquement en bois où sont déjà logés quatre-vingts hommes ; ce baraquement est large et bien aéré ; des bas flancs l’entourent, ceux-ci recouverts d’une épaisse couche de paille qui nous sert de litière. Des râteliers d’armes ont été ménagés aux extrémités. Les vitres ont été remplacées par des toiles imperméables, laissant passer une lumière suffisante, et qui ont le grand avantage de ne pas se briser au déplacement d’air produit par l’éclatement des obus.
Vendredi 28 mai 1915
6h00 — Je me lève pour prendre le café.
6h30 — Je dois commander une corvée, mais suis remplacé. La matinée s’écoule à sommeiller sur l’herbe, alors que le canon gronde.
15h00 — Rapport. Plusieurs citations à l’ordre du jour, à la suite des affaires des 1er et 13 mai. Les lanceurs de grenades et de bombes sont à l’ordre du jour.
19h00 — Petite soirée organisée par le Commandant de Compagnie, avec le concours de quelques chanteurs.
Samedi 29 mai 1915
9h00 — Liberté complète. Repos sur l’herbe.
13h00 — Corvée de bois ; quelques obus tombent tout près de nous au retour. De nombreux gourbis ayant servi autrefois se trouvent sous terre dans la forêt où nous sommes en corvée.
21h00 — Un incendie est allumé à l’est, qui prend des proportions considérables, puis s’éteint rapidement. Quelques coups de canon pendant la nuit.
Dimanche 30 mai 1915
8h00 — Douches. Chasse aux poux.
10h00 — Plusieurs obus tombent tout prés.
10h30 — Un homme a la cuisse traversée par une balle perdue.
12h00 — Un détachement de quelques hommes part pour s’exercer au lancement des bombes, pétards et « crapouillots ».
15h00 — Nous préparons du café à quelques-uns.
16h00 — Le journal arrive ; on se l’arrache : rien de nouveau.
17h00 — Un aviateur français franchit les lignes allemandes et est salué par un vif bombardement ainsi que par un feu intense des fusils et mitrailleuses. Les éclats d’obus retombent sur nos baraquements et dans l’arbre sous lequel je m’abrite.
18h00 — Par cinq fois, l’appareil français est rentré au-dessus de nos lignes pour franchir ensuite à nouveau les lignes allemandes. Les obus l’encadrent, mais il continue son raid.
19h00 — Ayant sans doute terminé sa mission, l’aéro regagne le Sud, sur Sainte-Menehould.
Lundi 31 mai 1915
7h00 — Nettoyage des effets et corvées, en vue de la revue par le Commandant qui doit avoir lieu à 8h30. Le nombre de nos cartouches est porté de cent vingt à deux cents.
8h00 — Nous sommes en tenue et attendons le signal du rassemblement. Un aéroplane français est signalé au-dessus de nous.
8h30 — Le rassemblement est terminé. Un avion allemand
apparaît ; rapidement, l’ordre est donné de rentrer dans les baraques pour se dérober à ses vues. L’artillerie française commence à bombarder ; l’avion disparaît vers le Sud.
9h00 — Nous sommes rassemblés à nouveau. Quelques obus éclatent au-dessus de nous, tirés par les allemands sur un de nos avions.
9h15 — Revue par le Lieutenant.
9h30 — Revue par le Commandant. Citations de plusieurs gradés et hommes à l’ordre du jour de l’Armée, de la Division et du Régiment. Distribution des diplômes. Allocution du Chef de Bataillon.
10h00 — Défilé devant le Commandant.
17h00 — Après la soupe, distribution des vivres et campements, la relève aux tranchées ayant lieu demain.
20h00 — C’est officiel que nous partons demain à 4h du matin.
Mardi 1er juin 1915
3h00 — Réveil au petit jour et distribution du café. Équipement.
4h00 — Rassemblement, puis départ pour la relève. Temps bas.
4h30 — Passons à Vienne-le-Château, bombardée. Triste vision de maisons saccagées et pillées ; tous les civils sont évacués et seuls les Services militaires y habitent.
5h00 — Atteignons les gourbis occupés par les troupes de réserve, les uns creusés à même dans la colline, les autres bâtis de branches et de terre. Les cuisines des troupes de première ligne sont établies là aussi.
5h45 — Nous entrons dans un boyau peu large où nous avons peine à passer avec notre sac ; nous conservons encore l’arme à la bretelle.
6h00 — Les boyaux deviennent plus profonds et encore plus étroits si possible ; nous mettons l’arme à la main, signe que
nous approchons.
6h15 — Je rencontre plusieurs camarades de la classe 1915, de Guer, allant au repos à leur tour.
6h30 — Nous entrons dans la zone de première ligne, battue par le feu de l’artillerie et par celui de l’infanterie surtout. Les quelques arbres que nous pouvons apercevoir sont coupés et déchiquetés à quelques mètres du sol. Celui qui s’aventurerait sur le parapet serait certainement abattu.
7h00 — Nous sommes tout près de la première ligne de tranchées, la relève commence ; nous arrivons par un boyau, ceux que nous remplaçons s’en vont par l’autre.
7h15 — Chacun a maintenant sa place ; je suis en toute première ligne près d’un pare-éclats ; les balles sifflent de tous côtés, ainsi que les obus des deux camps. Un créneau, percé à travers les sacs de sable, permet de tirer sur les
lignes allemandes.
8h00 — Les combats se bornent à quelques coups de canon et échanges de coups de fusil.
9h00 — Les allemands font sauter une mine ; coup de tonnerre effroyable avec tremblement de terre et pluie de pierres et de terre ; la lutte à coups de fusil est un instant plus intense ; on tire au hasard pour empêcher l’ennemi de sortir de sa tranchée qui est à dix mètres de la nôtre.
9h15 — Le calme relatif règne à nouveau.
11h00 — Au moment où nous commençons à manger, les allemands lancent dans nos lignes une « boîte à singe », sorte de machine infernale qui fait un bruit terrible ; chacun pose quart et gamelle et riposte à coups de pétards que nous ne ménageons pas.
11h15 — Le calme est revenu, nous reprenons le repas interrompu.
14h00 — Les allemands nous lancent cette fois une bombe ; nouveau combat à coups de pétards.
16h00 — Une mine saute à nouveau. Longue fusillade à la suite.
20h00 — Le calme est presque complet ; quelques coups de fusil seulement.
20h30 — Je suis au créneau. Un coup formidable retentit, puis suit une avalanche de terre ; je m’abrite dans une petite niche ; un morceau de terre me tombe sur l’épaule, je me soulève et me trouve projeté à terre ; je me relève, vais chercher un sac de pétards, puis, revenu à ma place, j’amorce les pétards que mon voisin lance sur les tranchées allemandes. Croyant que le coup de mine serait suivi d’une attaque, notre 75 commence à donner et arrose copieusement d’obus la tranchée allemande.
La nuit étant venue, des fusées jaillissent de tous côtés pour éclairer le théâtre de la lutte.
21h00 — Le combat continue, acharné, à coups de bombes et de pétards ; nul ne sort des tranchées ; les allemands sont à six ou huit mètres de nous.
21h15 — Le feu de l’artillerie a cessé, celui de l’infanterie ralentit. 21h30 — Le calme est revenu ; des fusées éclairent toujours.
24h00 — Tout est calme ; un homme surveille.
Mercredi 2 juin 1915
6h00 — La nuit a été assez calme après l’affaire de 21h. La fusillade est assez vive, comme tous les jours, d’ailleurs, au lever du jour.
6h30 — Les allemands nous jettent des bombes, nous répondons par des pétards. Ils réussissent à abattre un pan de mur de sacs de terre, mais ils ne peuvent sortir de la tranchée.
7h00 — Le mur est reconstruit rapidement,
bien qu’une violente fusillade soit dirigée sur ceux qui travaillent et qui se dissimulent tant bien que mal.
7h30 — Une autre compagnie vient nous relever ; sans bruit. Pour ne pas attirer l’attention des allemands, nous défilons vers la deuxième ligne ; pourtant les bombes et grenades lancées
par les allemands ne tardent pas à pleuvoir sur nos remplaçants ; nous nous baissons machinalement pour éviter les éclats.
8h00 — Enfin nous sommes installés en seconde ligne, à l’abri des bombes et grenades ; mais il y a encore le « crapouillot », une sorte de torpille aérienne, qui nous menace. Je me suis trouvé un abri tant bien que mal, où je pourrai me reposer dans une très mauvaise position ; bref, il n’y a pas grand choix.
9h00 — Un premier « crapouillot » s’abat à quelque deux cents mètres de nous ; nous sommes avertis
Folio 14
par un coup de sifflet d’un veilleur désigné dans chaque escouade. Plusieurs suivent, et chaque fois c’est la fuite vers un endroit à l’abri.
9h30 — La terre tremble deux secondes, puis une immense colonne de fumée et de terre s’élève en l’air pour retomber aussitôt, et on se cache comme on peut pour ne pas recevoir un bloc de terre sur le dos. Tout cela énerve considérablement et coupe l’appétit.
12h00 — Tranquillité relative ; chacun en profite pour dormir et se reposer.
15h00 — Nouvelle et courte alerte de « crapouillots ».
Nuit — Nuit calme ; nous couchons à même sur le sol qui n’est ni plat, ni sec ; et puis nous sommes tout équipés, prêts à voler au secours de la première ligne. On fait de petits sommes et on s’éveille plus fatigué que la veille.
Jeudi 3 juin 1915
5h00 — Nous sommes déjà éveillés par un bombardement matinal ; nous devons aller en première ligne à 6h.
6h00 — Nous irons seulement en première ligne après la soupe. Allons, quelques heures de répit encore !
8h00 — Quelques bombes, sans effet sur nous ; toujours ces « crapouillots » que l’on voit arriver et que l’on évite à tout prix.
10h00 — La soupe est mangée, nous passons en première ligne ; ce n’est plus tout-à-fait le même secteur ; je suis mieux placé que la première fois.
12h00 — Violent combat à ma gauche, avec grenades et « boites à singe ».
14h00 — Je remonte le boyau et passe par-
dessus une civière ; tout d’abord je ne distingue pas, puis m’étant retourné, je vois bien que je suis passé sur le corps difforme d’un soldat qui vient d’être haché par une machine infernale. Il a les jambes et la poitrine tailladées et les traits méconnaissables ; des mouches charbonneuses l’ont déjà envahi.
15h00 — Le calme est presque complet. Allons-nous être attaqués ce soir ?
20h00 — Contrairement à notre attente, mais avec plaisir, nous constatons que l’ennemi se tient tranquille. La nuit sera calme.
Vendredi 4 juin 1915
4h00 — Suis éveillé par un camarade, cependant rien de nouveau. Nous comptons sur la
relève à 6h.
6h00 — Le bruit court que nous ne serons relevés que ce soir. Depuis quelques heures, un allemand a repéré mon créneau et tire dessus continuellement ; les balles frappent sur l’acier, donnant un son agaçant qui m’énerve.
8h00 — Enfin nous sommes relevés, et à vive allure nous suivons le boyau de communication qui conduit en réserve à l’arrière.
8h30 — Arrivons à Beaumanoir, en arrière.
10h00 — Mangeons la soupe à Beaumanoir, puis repos sur l’herbe, sous les arbres, près des gourbis.
12h00 — Sommes toujours ici. Paraît que
que nous allons au repos à Ronchamps, ce soir à 18h. C’est là déjà que nous étions au repos il y a quatre jours. Le bruit court que nous changeons de secteur.
18h00 — Sommes prêts à partir, mais le signal n’est pas donné.
18h45 — Nous partons pour Ronchamps. Des brancardiers emportent un cadavre. Il fait une forte poussière qui coupe la respiration.
19h30 — Arrivons à Vienne-le-Château, faisons halte un instant ; corvée d’eau commandée ; cette eau malheureusement sent le permanganate qu’on y ajoute pour la stériliser. Si seulement on pouvait avoir un quart d’eau bien fraîche !
19h45 — Nous reprenons notre marche et atteignons Ronchamps à la nuit.
Folio 19
20h30 — Nous sommes réinstallés et sommes bientôt tous étendus sur la paille.
Samedi 5 juin 1915
6h00 – Réveil ; nous sommes plus heureux que d’habitude ; ce n’est plus le sifflement des balles et l’éclatement des obus comme les jours précédents, mais un calme reposant et complet. La journée passera sans incident.
21h00 — Je me suis couché et sommeille depuis un instant quand je suis réveillé par un bombardement intense. Nos canons, dissimulés dans un bois non loin de l’endroit où nous
sommes, tirent sans arrêt. Les allemands ont tenté d’attaquer, sans doute ; c’est peut-être le contrecoup de la reprise de [illisible] que nous venons d’apprendre avec stupeur.
Dimanche 6 juin 1915
8h00 — Est-ce aujourd’hui que nous partons ? Non, demain nous changeons de secteur. Une corvée de ravitaillement part à Florent, je commande du lait condensé avec lequel nous espérons pouvoir faire le lendemain du chocolat au lait.
10h00 — Je me sens fatigué aujourd’hui, c’est un reste de l’énervement des trois jours passés au feu. De plus, j’ai une forte diarrhée.
12h00 — Le journal arrive, on se l’arrache, on le parcourt avidement, mais toujours ces articles
monotones qui nous intéressent peu ou point. La question à l’ordre du jour est de savoir si les russes pourront se maintenir sur la défensive et arrêter la marche du flot austro-allemand. Chacun se demande quand et comment se terminera la guerre ? Tous donnent leur avis, nul ne sait une réponse plausible. Le fait est que rien ne laisse prévoir une fin prochaine, bien au contraire, mais voilà l’époque des grandes chaleurs et nous en souffrirons autant que du froid.
17h00 — La corvée rentre et me rapporte ce que j’avais demandé.
19h00 — Je vais assister à un petit match de football entre fantassins et artilleurs. Ces artilleurs sont vraiment heureux et n’ont que peu à craindre, ils le disent eux-mêmes.
Lundi 7 juin 1915
5h00 – Réveil ; cette fois encore, je me trouve fatigué. Il doit y avoir revue dans la journée. Départ à 16h.
6h00 — Nous allons à quatre choisir un emplacement sous bois, où installer notre feu pour faire le chocolat ; chacun y met du sien et après une demi-heure, nous avons chacun un litre de chocolat au lait très appétissant et qui nous rappelle un instant
le bonheur de la vie à la maison paternelle.
8h00 — Nous rentrons au baraquement. Nous éprouvons tous une certaine lassitude qui provient de la chaleur.
10h00 — Il y aura une revue générale à 14h. Une revue à l’arrière n’est pas quelque chose de bien ennuyeux ; chacun sait que son fusil doit être propre : quant aux effets, on ne peut nous demander du soigné quand on est obligé avec de passer dans tous les coins.
14h00 — En fait de revue, on nous demande ce qui nous manque et on nous prie de rester en tenue, le ministre de la guerre devant passer dans l’après-midi.
15h00 — Rapport. On nous dit quel secteur nous allons occuper : c’est à six ou sept kilomètres d’ici. Sera-t-il bon ou mauvais ? Le ministre de la guerre n’est toujours pas là.
16h00 — Rassemblement pour le départ. Pas de ministre, nous partirons bien sans cela. La chaleur est encore excessive et le sac bien pesant. Nous marchons longtemps tout en allant peu vite, et lorsque le signal du repos est donné, chacun s’étend rapidement pour reprendre un peu de force.
17h00 — Nous avons repris la marche en avant. Nous allons par un petit sentier étroit et descendant à travers la forêt. Nous atteignons enfin des gourbis ; ce ne sont pas les nôtres, il faut aller plus loin ; pourtant nous sommes bien fatigués, mais à quoi bon se plaindre ? Et puis, ce n’est la faute à personne.
18h00 — Nous sommes rendus dans nos gourbis et avons léché sacs, fusils, équipements et musettes. Pour ma part, je suis exténué ; nous manquons d’eau fraîche, mais enfin on peut se reposer. Notre gourbi est une excavation de quatre mètres sur deux, creusée dans le flanc d’un monticule, et dont le sol a été recouvert de branchages pour retenir la fraîcheur, puis de paille sèche. Il y règne une odeur de fumée à laquelle nous nous faisons. On y est à l’abri des balles et des obus, et c’est utile, car les allemands, ayant sans doute remarqué notre arrivée, commencent à nous bombarder. Ici, nous sommes en réserve et serons sans doute assez tranquilles. Combien de temps allons-nous y rester ?
20h00 — Nous avons pris place sur la paille et allons certainement bien dormir.
Mardi 8 juin 1915
7h00 — Le temps est déjà bien chaud. Nous avons touché de la paille sèche et propre ; il va falloir nettoyer les gourbis pour y étendre ensuite la nouvelle paille.
8h00 — Caporaux et soldats, sans distinction, nous grattons le sol de notre demeure souterraine ; le dessous est un véritable fumier avec des branchages enchevêtrés. Nous avons bien chaud.
10h00 — Le nettoyage est complètement terminé. La paille étendue, nous prenons un repos bien gagné. Entre temps, deux sections sont allées à La Harazée, en deux fois, pour en rapporter du bois ; la première fois, rien n’était prêt : corvée inutile ; la seconde fois, chargement terrible, les hommes reviennent exténués.
14h00 — Le temps devient orageux. Le bruit du tonnerre se mêle à celui du canon, la pluie menace de tomber.
16h00 — Le temps a l’air un peu remis, mais il fait lourd.
20h00 — Sur notre gauche, vive fusillade ; les mitrailleuses ne cessent de tirer. Est-ce une attaque ? Ceci ne
dure pas longtemps.
Mercredi 9 juin 1915
3h00 — Je sommeille encore. Une goutte d’eau me tombe sur la joue ; je ne bouge pas. Une deuxième goutte tombe ; dans mon sommeil, je crois qu’un camarade me fait une farce, mais pour qu’il en soit de ses frais, je me tiens toujours tranquille. Il pleut de plus en plus, et je finis
par me redresser ; quelle n’est pas ma surprise en entendant la pluie tomber à flots au-dehors. En une seconde je comprends : notre pauvre toit est inondé, l’eau le traverse et nous tombe dessus. Les camarades s’éveillent, un surtout est tout frais. À la hâte, nous détachons nos toiles de tente de nos sacs et nous en couvrons, mais la paille est déjà fraiche et la pluie tombe toujours.
4h00 — La pluie tombe moins fort ; chacun dort à nouveau.
5h00 — Le café arrive ; il recommence de pleuvoir et nous osons à peine sortir un genou de dessous la toile de tente. Le Sergent passe, j’entends qu’il prononce mon nom ; je l’appelle : c’est mon tour à être « de jour », parait-il. Je m’incline et me renseigne sur mes fonctions.
6h00 — Etant « de jour », je dois faire la tournée dans la Compagnie pour dresser la liste des malades à présenter au médecin-major. La pluie tombe toujours, le chemin est boueux, j’enfonce jusqu’à la cheville et vais à la recherche des escouades.
6h15 — Ma liste est prête. À 7h, j’irai conduire les hommes au Major. Entre temps, les camarades du gourbi sont entrés et sortis, et ont amené sur la paille déjà fraîche une certaine couche de boue qui lui donne l’aspect d’une litière. Je n’y regarde pas à m’étendre dessus, mais c’est égal : on ne peut se figurer ce que c’est lorsqu’on n’y est pas passé.
6h45 — Une nouvelle fois, je fais le tour de la Compagnie, cette fois pour rassembler les « hommes-visite ». La pluie vient de cesser, mais quelle boue !
7h00 — Tous mes hommes sont devant le Major, je n’ai plus qu’à attendre la fin de la visite. Je m’assois sur un talus. En passant, je dirai que le « bureau » où le major donne consultation est un gourbi un peu mieux installé que le nôtre, et un peu plus élevé, mais il est sous terre et n’a rien d’un palais.
8h00 — La visite terminée, je rentre au gourbi.
8h15 — Un appel : « Le caporal de jour ! ». Je cours, c’est encore un sergent : « Prenez quatre hommes de la 2ème Section et faites nettoyer le boyau qui mène à la route ». Je prends quatre hommes et vais reconnaître l’endroit. Le boyau est plein d’eau et on y enfonce dans la boue ; pour le nettoyage, nous ne disposons que de bêches de cinquante centimètres de haut. J’envoie chercher des pelles, et on commence. Tant bien que mal, on gratte, on pelle, on repousse l’eau.
9h00 — Nous avons atteint le bout du boyau qu’il a fallu laisser inondé, étant trop en contre- bas. En remontant le boyau, je remarque que là où j’ai fait enlever l’eau, d’autre est revenue de plus haut : recommencer ne donnerait pas d’autre résultat ; il faut laisser le soleil passer là-dessus.
10h00 — Je rentre crotté pour manger la soupe. Le soleil semble vouloir se montrer.
11h00 — Un bruit qui court : nous allons être relevés ce soir et être encore envoyés dans une direction inconnue. Bien sûr, nous étions en réserve, c’était trop beau ; enfin, attendons des détails.
12h00 — Les bruits vont leur train. Comme c’était à prévoir, on parle de l’Italie, des Dardanelles, que sais-je ? En tout autre temps, on s’amuserait
de ces bruits si divers. Chaque fois que le cuisinier, l’ordonnance ou le planton passe, il y a un nouveau tuyau ; il est toujours question de nous envoyer partout, mais pas dans nos foyers, c’est certain.
13h00 — Nous partirons ce soir ou demain, certainement, mais pour où ? La boue sèche. 14h00 — La boue continue à sécher.
15h00 — « Caporal de jour ? » — « Présent ! » — « Ramassez les outils qui traînent dans le cantonnement et faites-les conduire au magasin de l’Adjudant de Bataillon ». Je m’exécute.
17h00 — La soupe est mangée. Nous partirons demain à 3h45 du matin. Nous serons relevés par le ...ème d’infanterie, régiment de nos régions et dans lequel je trouverai peut-être des connaissances. 19h00 — Le canon tonne très fort dans la direction de l’Ouest, c’est-à-dire vers Perthes et Le Mesnil, en Champagne.
Jeudi 10 juin 1915
3h00 — Le caporal distribuant le café m’éveille ; il fait petit jour. L’ordre est donné aussitôt de s’équiper. Le ...ème nous attend, puis passe près de nous ; je ne parviens pas à y reconnaître un ami.
4h00 — Nous avons quitté l’endroit ou nous étions
en réserve et gravissons une colline presque abrupte, le long d’un sentier à peine frayé et recouvert par places de branchages entrelacés. Chacun marche allégrement, car il fait frais, et puis derrière la colline se trouve la zone arrière où on est plus en sécurité.
5h00 — Petite pause, après avoir traversé un terrain labouré par les obus de gros calibre. Les trous attestent que le bombardement date déjà d’assez longtemps.
6h00 — Nous atteignons le village arrière où nous devons rester au repos pendant un temps indéfini. C’est déjà là que nous avions eu cinq jours, puis trois jours de repos. C’est bizarre qu’on nous ménage tant ; quelque chose se prépare, sans doute un changement complet de secteur. D’après certains bruits, le —Mme Chasseurs à pied qui forme brigade avec nous, aurait embarqué ce matin pour un autre point du front. Allons-nous le suivre ?
7h00 — Je fais une petite lessive de quelques objets de lingerie. Je ne me tire pas trop bien de ce premier lavage, je ne sais pas manier le savon et la brosse.
12h00 — Rien de nouveau. Il parait que nous embarquons demain matin.
14h00 — Le ciel s’est couvert rapidement. Un gros orage est à craindre ; la température est accablante ; on a peine à rester en place sur la paille tant les mouches sont mauvaises.
16h00 — Le bruit du tonnerre se mêle à celui du canon, le soleil est complètement caché.
17h00 — L’orage éclate, la pluie tombe à flots et traverse même le toit du baraquement ; on étend en hâte les toiles de tente sur la paille pour que ce soir on puisse coucher au sec.
17h30 — L’orage a cessé, mais la pluie menace de recommencer.
18h00 — La pluie recommence plus fort si c’est possible. À notre gauche, les 75 commencent à tirer sans cesse ; c’est un bruit continu plus terrible que celui du tonnerre. Les boches ont sans doute tenté une attaque pendant la pluie, c’est leur habitude, et le canon a la mission de les faucher. Que ce doit être épouvantable dans la tranchée par une telle pluie ! On doit y enfoncer dans la boue jusqu’aux genoux, et si avec cela il faut combattre et se garer des bombes !
18h30 — Avec la fin de la pluie, le canon
a également cessé de tirer. Chacun sort pour prendre l’air frais. Avec un autre caporal, je vais jusqu’aux gourbis des territoriaux, à un kilomètre, pour y chercher quelques journaux si possible. Nous en trouvons quelques-uns, entre autres celui du jour qui annonce la démission de Mr. Bryan, le ministre des affaires étrangères américain ; quelles complications ceci va-t-il amener ?
21h00 — Suis étendu sur la paille. Partirons-nous demain ?
Vendredi 11 juin 1915
6h00 — Le temps s’est rafraîchi à la suite de l’orage d’hier et personne ne songe à s’en plaindre.
9h00 — Il court toujours des bruits de départ que certains régiments de la Division sont déjà partis, mais toujours rien d’officiel. Les officiers eux-mêmes ne savent sans doute pas ce qui nous attend.
12h00 — Le temps est devenu plus beau ; le soleil luit. Les bruits courent, toujours aussi divers.
15h00 — Douches. Qu’il fait bon recevoir de l’eau douce sur le corps !
18h00 — Le bruit court avec persistance que nous partons demain à 3h du matin.
18h10 — Un obus tombe sur la pente faisant face à notre baraquement, où sont assis nombre d’hommes ; aucun n’est touché. Tous cependant évacuent la position qui devient périlleuse car les allemands tirent rarement un seul coup au même endroit.
18h15 — Plus rien. Les allemands restent calmes.
19h00 — Il arrive un renfort du camp ; ils disent que le dépit se vide et qu’à part les territoriaux et les jeunes, il ne reste guère que les inaptes. Il paraît que la vie au camp est également changée : une discipline sévère règne maintenant dans toutes les compagnies et les punitions pieu-vent, pleuvent !
20h00 — Nous partons demain matin à 3h, pour un bivouac arrière. Distribution du pain et du vin pour le lendemain. Chacun boucle son sac et s’endort.
Samedi 12 juin 1915
3h00 — Je suis éveillé en sursaut par le cri de « au jus ! » ; c’est le réveil. Il fait à peine jour, heureusement que notre fourniment ne se compose pas de nombreuses pièces, sans quoi nous risquerions fort d’en oublier quelques unes, par ce matin sombre.
Folio 32
3h15 — Le ...ème d’infanterie arrive pour nous relever ; aussitôt est donné le signal du rassemblement et les sections s’alignent alors que le jour vient plus clair. Un fort brouillard règne au-dessus de nos têtes et nous préserve d’une attaque d’un aéroplane qui pourrait nous survoler. 3h30 — La Compagnie s’ébranle et gagne la forêt, direction Sud, l’inverse du front. Il fait bon aller sous les arbres par ce matin frais, mais le sac qui pèse et le canon qui gronde nous empêchent d’oublier la réalité, même un moment.
4h15 — Un ravin qu’il faut descendre pour remonter ; c’est fatigant, mais on ne s’arrête pas.
5h00 — Nous atteignons un bivouac, la Croix-Gentin ; c’est un immense village de huttes et de gourbis sous les arbres ; gourbis de terre en forme de pyramides à l’intérieur desquels il doit faire très humide, et huttes de branchages construites avec plus de soin et partant, plus confortables ; il y a même quelques grands baraquements comme ceux que nous occupions au repos, c’est sans doute pour les privilégiés. D’autres compagnies du 94 sont déjà là.
5h15 — Nous arrêtons sous les arbres pour la pause ; chacun met sac à terre. Va-t-on nous désigner des gourbis ?
5h30 — L’ordre arrive de rester dehors ; c’est dire que notre arrêt ici ne doit être que de courte durée. Je retrouve un ancien camarade de la 31ème Compagnie qui est arrivé hier avec le dernier renfort ; il confirme les bruits apportés par les autres hommes du renfort suivant lesquels la discipline du camp serait devenue très sévère.
7h00 — Nous sommes là, allant et venant ; les uns jouent aux cartes, les autres lisent, d’autres dorment. Que faire autre chose ? 8h00 — « En tenue ! » — Partirions-nous, par hasard ? Non, car on nous dirige sur des gourbis.
8h15 — Je suis installé dans un grand baraquement en bois, avec de la paille sur les bas flancs où nous serons à souhait ; en effet, une bonne couche de paille sous un bon abri, c’est tout ce dont un soldat peut rêver au front. Je viens de rencontrer plusieurs camarades de la classe 1915 ; si nous restons quelques jours ici, j’en retrouverai beaucoup, je crois.
10h00 — Tout le monde est installé sur la paille, à ne savoir que faire ; les plus heureux
sont ceux qui ont pu trouver le journal. Un coup d’œil rapide sur les gros titres me permet de voir qu’il n’y a toujours rien de nouveau. Pourvu qu’après avoir refoulé les russes, les allemands ne viennent pas se jeter sur les italiens ou sur nous.
15h00 — L’après-midi se passe comme la matinée, à ne rien faire. Les bruits ont cessé de courir, c’est la meilleure preuve qu’on ne sait rien.
19h00 — La soirée est fraîche ; il fait bon s’étendre sous les arbres avant de se livrer au sommeil. Je parle avec un jeune homme qui, comme moi, est allé en Angleterre, et nous nous demandons tous deux quand le plaisir de ces jours passés là-bas reviendra.
Dimanche 13 juin 1915
5h00 — Le café arrive ; aussitôt bu, on se recouche.
8h00 — Je viens de lire le communiqué au gourbi du Commandant ; nous avons enlevé un butin de guerre assez important aux allemands, autour d’Arras, mais ce n’est toujours pas une décision.
9h00 – Je descends à la source pour me laver. Là, jeretrouve encore plusieurs camarades d’une autre compagnie. Comme moi, ils se sont bien tirés de leurs premières journées de tranchées.
10h00 — Le journal arrive. Rien de nouveau.
15h00 — L’après-midi se passe tranquillement. Il fait très chaud dehors.
17h00 — Après la soupe, on va s’étendre sous les arbres pour prendre le frais.
20h00 — Toujours sous les arbres ; un ancien de l’active raconte des histoires de caserne et nous nous demandons tous quand nous revivrons de ces histoires. Nouvelle officielle : revue de tout le Bataillon demain à 8h30.
21h30 — Tout le monde, ou à peu près, est étendu sur la paille ; brusquement le Sergent commande l’extinction complète des feux ; on obéit, c’est un ordre venant du Colonel, paraît- il. On n’avait jamais pris une telle mesure auparavant.
22h00 — L’obscurité est complète. On entend une très forte canonnade et le feu des mitrailleuses. Encore une attaque, sans doute ?
Lundi 14 juin 1915
5h30 — Distribution du café, comme à l’habitude.
7h00 — On se tient prêt pour la revue. Nous allons sans doute savoir ce qui a été décidé sur notre sort.
8h00 — Rassemblement. Nous gagnons le terrain de la
revue, une vaste clairière avec quelques arbustes.
8h15 — Sans que nul ne s’y attende, le Colonel passe devant nous ; nous présentons les armes, le Colonel ne s’arrête pas.
8h30 — « Garde à vous ! » — Le Commandant arrive et inspecte le Bataillon dans tous ses détails. Le sac paraît encore plus lourd en restant ainsi sur place.
9h00 — Le Bataillon est rangé en formation carrée, te Commandant va parler. Tout d’abord, il distribue quelques ordres du jour obtenus à la suite des affaires des 1er, 2 et 3 juin. Le Commandant nous apprend qu’il y a quelques jours nous avons failli remporter près d’Arras la victoire décisive. « La cavalerie, dit-il, était déjà massée derrière nos lignes, prête à couper les communications arrières de l’ennemi, mais nous n’avons pas pu percer ». Nous nous étonnons de ces paroles qui ne sont pas tout-à-fait faites pour inspirer confiance. Il ajoute cependant qu’il espère que dans un temps prochain nous recommencerons ; espérons avec lui que cette fois nous réussirons. En même temps, il nous apprend que contrairement à ce que l’on prévoyait les jours derniers, nous n’allons pas quitter l’Argonne ; nous n’y serons
pas plus mal qu’autre part.
9h30 — Le speech terminé, nous nous préparons à défiler. Le défilé est très rapide, ensuite nous rentrons dans les gourbis. Nous ne savons quand nous retournerons dans les tranchées.
10h00 — Pendant la distribution de la soupe, J’apprends que nous partirons demain dans la nuit. Dans quel secteur irons-nous ? Je l’ignore.
12h00 — Nous nous préparons à quatre camarades à faire du café au lait, avec du lait concentré, et du café que l’un d’entre nous a reçu de chez lui.
12h30 — Le café est prêt ; c’est un vrai régal et nous le savourons lentement.
14h00 — Nous faisons la sieste sous les arbres ; il paraît que le secteur dans lequel nous irons n’est pas trop mauvais. Au dernier communiqué, nous avons légèrement progressé dans la région d’Arras.
17h00 — Une de nos compagnies va partir ce soir pour les tranchées ; nous irons sans doute la relever demain.
19h00 — Une corvée de ravitaillement rentrant de Florent nous apprend que le ...ème Chasseurs est en route pour Sainte-Menehould où le Bataillon va embarquer pour une destination inconnue. C’est bizarre qu’un régiment de
notre Division quitte le secteur alors que nous restons, il y a là quelque chose qu’on ne comprend pas.
21h00 — La canonnade est assez forte ; une alerte sans doute qui ne durera que quelques minutes.
Mardi 15 juin 1915
5h00 — Réveil ; la nuit a été froide et chacun se plaint de n’avoir pas eu chaud.
6h00 — Je descends à la source pour m’y laver ; beaucoup d’autres y sont déjà installés. Une conversation est engagée entre la plupart des assistants : un artilleur a été tué hier par une balle française et sa mort a dû être causée par l’imprudence d’un soldat qui chassait le sanglier aux alentours. En effet, beaucoup se permettent de chasser dans les bois environnant le cantonnement, et il arrive de ces accidents regrettables.
9h00 — Arrivée du journal ; c’est toujours à qui l’aura le premier, pourtant il ne donne rien de nouveau.
9h30 — Il parait que cette fois c’est un soldat du Génie qui vient d’être tué ; on recherche le chasseur.
15h00 — Rapport. Le secteur dans lequel nous allons aller demain est tranquille, nous dit le Lieutenant, mais il y aura sans doute des terrassements à faire. Travailler n’est rien quand les risques sont minces, mais par exemple il nous annonce que nous resterons huit jours
consécutifs en première ligne, ce ne sera pas très amusant.
18h00 — Grand nettoyage du cantonnement que nous quitterons à minuit. Chacun monte son sac, prépare les musettes pour n’avoir qu’à les Jeter sur son dos au moment du départ.
20h00 — Chacun s’étend sur la paille pour profiter des quelques heures de repos.
Mercredi 16 juin 1915
0h00 — Un sergent nous éveille, chacun s’équipe, mais dormirait bien encore cependant. Le cuisinier apporte le café, c’est un vrai sirop ; sans doute que demain il n’y aura pas de sucre du tout.
0h30 — Nous sortons du cantonnement. Il fait noir comme dans un tour dehors ; un par un, nous suivons l’homme de liaison qui, muni d’une lanterne sourde, nous conduit au lieu de rassemblement du Bataillon. Sommeillant à moitié, ne connaissant pas le chemin qui va sous les arbres, nous butons à chaque pas avant d’atteindre la route. Aussitôt arrivés là, le Commandant donne le signal du départ.
1h00 — La marche est relativement facile, bien qu’on se voit à peine à deux pas. Le
chargement est lourd, à cause du complément de cartouches que nous avons reçu.
1h30 — Arrivons à Vienne-la-Ville. J’essaye de reconnaître quelques endroits où je suis venu autrefois, mais impossible ; d’ailleurs, nous ne traversons pas le village dans toute sa longueur. À chaque instant, nous sommes croisés ou dépassés par des ravitaillements d’artillerie, ce qui entrave la marche.
2h30 — Vienne-le-Château. Le jour se lève sur les ruines de ce pauvre village où je suis passé déjà, la première fois que je me rendais aux tranchées.
3h00 — Nous atteignons les gourbis des troupes en réserve, puis enfin le boyau qui doit nous conduire à nos nouvelles tranchées.
4h00 — A la file indienne, nous avançons dans le boyau étroit qui mène à la première ligne. Tout est assez calme.
4h15 — Arrivons enfin aux tranchées ; elles sont en effet bien aménagées : fils de fer recouvrant les murs pour éviter la chute de la terre, chambres de repos pour ceux qui ne sont plus de garde, etc. D’après ceux que nous relevons, le secteur n’est pas mauvais ; nous allons juger par nous-mêmes.
4h30 — Ceux que nous relevons sont partis. Les créneaux sont bien aménagés ; un coup d’œil à travers l’un d’eux permet de voir que les lignes allemandes sont à une centaine de mètres des nôtres, mais des boyaux inoccupés se trouvent entre les deux, et l'ennemi peut-être y vient rôder. Nous y installons un poste d’écoute.
6h00 — Presque pas de coups de fusil ; quelques crapouillots dont il faut se garer et quelques obus.
8h00 — On est assez tranquille, bien qu’on soit presque constamment obligé de regarder en l’air pour guetter l’arrivée toujours possible d’un bolide quelconque.
9h00 — C’est mon tour de prendre du repos. Je vais donc m’installer à la chambre de repos où d’autres ont pris place déjà ; on y tient à douze bien serrés et il ne faut pas songer à s’étendre ; on n’y est que pour un temps très court, d’ailleurs, presque toujours deux heures. C’est un grand gourbi souterrain recouvert de rondins et de terre pour garantir des obus de petit calibre. Un banc de terre aménagé tout autour permet de s’asseoir. On y dort d’un œil.
12h00 — Pas grand'chose de nouveau ; il arrive quelques
obus de 105 de temps à autre. Par bonheur, ils tombent en grande partie en arrière de la première ligne.
13h00 — C’est mon tour de passer au poste d’écoute, avec quatre hommes. Ce poste d’écoute se trouve bien entendu entre nos lignes et celles des allemands, à une distance d’environ vingt mètres des nôtres. On s’y rend par un long boyau recouvert de fils de fer barbelés ; des petites rotondes aménagées en certains endroits permettent de loger les guetteurs. On passe deux heures là, constamment aux aguets, les balles des deux camps passant au-dessus de nos têtes.
14h00 — Je suis assez tranquille au poste d’écoute. Je circule dans les boyaux et vais voir les guetteurs les uns après les autres.
15h00 — Mes deux heures étant achevées, je suis relevé par un autre caporal. Je suis cette fois de garde dans la tranchée, pour deux heures à nouveau ; il fait encore très chaud et toute la tranchée est en plein soleil.
17h00 — C’est cette fois à mon tour de me reposer ; j’entre à la « chambre de repos » et y dors quelques instants.
20h00 — C’est assez tranquille, pourtant des cris retentissent à notre droite ; c’est parait-il une altercation entre français et allemands, on ne sait à quel sujet. Ceci nous vaut d’avoir à nous tenir près à chaque créneau au
cas où une attaque s’ensuivrait.
21h00 — Je retourne pour deux heures au poste d’écoute ; cette fois il faut ouvrir l’œil plus que jamais, car la nuit est venue et ce sera bientôt l’heure des patrouilles allemandes ; il ne faut pas nous laisser surprendre. On fait le moins de bruit possible pour ne pas attirer l’attention de l’ennemi.
22h00 — Rien ne bouge ; faible fusillade seulement. Dans certains secteurs, à droite principalement, l’action est plus vive.
23h00 — Je prends la garde dans les tranchées après avoir été relevé du poste d’écoute ; je vais et viens pour me rendre compte si chacun veille.
Jeudi 17 juin 1915
1h00 — Je vais à la chambre de repos ; par bonheur le nombre des occupants est restreint et je puis m’étendre, ce qui me permet de dormir plus à l’aise.
3h00 — Je suis éveillé par les hommes qui prennent la garde à la relève de 3h. Tout est à peu près calme.
5h00 — Le café arrive ; je le bois puis m’étends à nouveau. Je ne suis pas de service avant 9h.
9h00 — Je reprends mon poste avec les guetteurs ; rien d’anormal. Les obus sifflent au-dessus de nous, mais ne nous atteignent pas. A droite il y a un
échange incessant de « crapouillots ». C’est un bruit assourdissant qui semble vous ballotter l’estomac.
11h00 — Je viens d’achever mes deux heures au poste d’écoute et mange maintenant ma soupe qu’un camarade m’a fait servir pendant mon absence. Un bombardement assez intense commence bientôt et on est obligé de se faire le plus petit possible si l’on veut échapper aux éclats des obus qui éclatent tout près de la tranchée.
13h00 — Je viens au repos, cependant que le bombardement continue. Je crois que les rondins et la terre qui recouvrent le gourbi nous préservent suffisamment. On vient de nous distribuer un quart d’eau, nous en avons bien besoin car la chaleur est accablante ; malheureusement, à cette eau a été additionnée une certaine quantité de permanganate qui lui donne un mauvais goût. Je crains que nous n’ayons de l’orage ce soir ; d’un côté le temps s’en trouverait rafraichi, mais d’un autre, nous serions peut-être trempés.
15h00 — Je suis toujours au repos ; il fait frais, mais nous mourons de soif et rien à boire. Nous nous demandons pourquoi on n’organise pas plus de corvées d’eau.
16h00 — La soupe arrive, on la mange ; il fait encore très chaud et le quart de vin qu’on nous distribue ne nous rafraîchit guère.
17h00 — Le Sergent me prévient qu’étant en surnombre à la Section, c’est moi qui ce soir serai chargé de conduire les travaux : pose de fils de fer, terrassements dans les sapes, réparation des créneaux. J’aurai fort à faire à ce qu’il me semble et je ne dormirai sans doute pas longtemps cette nuit. Nous souffrons toujours de la soif. Contrairement à mes prévisions, l’orage n’est pas venu.
19h00 — Le Sergent m’appelle pour l’accompagner chez le Lieutenant, au sujet des travaux. Je m’y rends, mais au lieu de m’occuper des travaux, c’est d’une patrouille qu’il s’agit. Le Capitaine commandant la Compagnie a ordonné que le caporal le plus nouvellement arrivé fasse une patrouille avec deux hommes, pour battre le terrain entre deux postes d’écoute, c’est-à-dire d’un certain rayon entre les lignes allemandes et françaises. Les patrouilles sont presque toujours périlleuses et je n’en n’ai jamais fait. J’ai aussi pour mission de m’approcher le plus possible d’un certain poste d’écoute allemand dont on ne connaît pas exactement l’emplacement.
Tout cela n’est pas très intéressant. Bref, avec mes deux hommes, je pro-fite des quelques heures qui nous restent avant de partir (car je ne dols sortir qu’en pleine nuit, à 10h), pour jeter un coup d’œil par les cré-neaux pour reconnaître le terrain et retenir quelques points de repère. La distance à parcourir est d’environ cent cinquante mètres, mais le terrain doit étre couvert de fils de fer qui ralentissent la marche.
20h00 — J’ai à peu près tous les renseignements voulus, j’ai reconnu le point de sortie et celui de rentrée ; il ne me reste plus qu’à attendre la nuit.
21h00 — La lune se lève, il ne fera pas trop noir ; c’est avantageux d’un côté, car je m’y reconnaîtrai plus facilement, d’un autre c’est nuisible, car je serai moins caché aux vues de l’ennemi.
21h45 — L’ordre est donné dans les tranchées de cesser le feu jusqu’à ce que je sois rentré, car je vais passer devant nos lignes.
22h00 — Nous enjambons le parapet d’un boyau, la patrouille commence ; nous nous dirigeons suivant l’itinéraire fixé. Nous nous traînons sur le ventre en faisant le moins de bruit possible
et en nous dissimulant derrière les hautes herbes ou derrière des arbres abattus. Souvent nous attendons quelques instants pour regarder ou écouter puis on reprend la marche rampante. Des fusées éclairantes viennent parfois nous surprendre ; brusquement on s’aplatit et on attend qu’elles s’éteignent.
— Il me serait impossible de dire depuis combien de temps je suis parti : une heure environ, et l’arbre qui se trouve à mon point de rentrée est encore bien éloigné. Il vaut mieux aller doucement et ne pas se laisser surprendre. Nous avons entendu certains bruits nous permettant de savoir approximativement l’emplacement du poste allemand. Au-dessus de notre tranchée, j’aperçois une tète. On nous demande si nous sommes bien la patrouille française, nous faisons signe que oui. Une déclivité du terrain nous permet d’avancer sur les genoux sans être vus ; c’est plus rapide, mais il y a un réseau de fils de fer barbelés presque infranchissable auquel nous nous accrochons à chaque instant. Enfin, l’homme qui marche en tête fait signe qu’il a atteint le boyau, il se fait reconnaître et descend, et ainsi de
suite pour moi et l’homme qui me suivait.
23h30 — Nous sommes sains et saufs ; j’apprends qu’il est 23h30. Notre patrouille a duré une heure et demie. J’ai à peine le temps d’aller rendre compte de ma mission au Lieutenant, que de part et d’autre commence une vive fusillade ; assez loin à notre droite, il y a une attaque. Je suis rentré au bon moment, un quart d’heure de plus et j’étals entre les deux feux ; aurais- je pu m’aplatir suffisamment pour n’être pas atteint ?
Vendredi 18 juin 1915
0h00 — La fusillade continue, moins vive cependant.
0h30 — L’attaque a cessé ; tout retombe dans le silence. Quelques fusées éclairantes illuminent encore les deux camps. Je me rends au gourbi pour faire un rapport écrit demandé par le Capitaine. Je rédige ce rapport rapidement.
1h00 — Conduit par son ordonnance à travers tout un réseau compliqué de tranchées, j’arrive au gourbi du Capitaine qui est couché. Je lui remets le rapport, puis réponds à ses questions. Après avoir été congédié, je rentre à la « chambre de repos » pour me reposer une partie de la nuit.
3h00 — Je suis éveillé par la relève. Rien de nouveau.
5h00 — Je passe au poste d’écoute. C’est tranquille.
Je n’ai qu’à surveiller si les guetteurs sont bien à leurs postes et ne s’endorment pas.
7h00 — Je quitte le poste d’écoute pour prendre la garde dans la tranchée. Là aussi, c’est tranquille. Nous prenons le café avec un morceau de pain sec et poussiéreux dedans.
9h00 — Il fait très chaud, déjà. Je vais au repos pour quelques heures.
10h00 — On distribue de l’eau en quantité suffisante, et puis elle ne contient pas de permanganate et on la boit avec plus de plaisir.
11h00 — La soupe arrive. L’ennemi nous bombarde assez violemment. Les obus tombent à quelque vingt mètres en arrière de la tranchée, mais les éclats sifflent autour de nous.
12h00 — Le bombardement continue ; les obus continuent à tomber en arrière et n’atteignent personne.
13h00 — Nous dormons dans le gourbi, pendant que l’équipe de relève veille au-dehors.
13h30 — Une corvée d’eau arrive. Chacun s’empresse autour de l’arrosoir ; par bonheur, l’eau est abondante, et c’est la seconde fois aujourd’hui qu’on en distribue. Nous emplissons nos bidons.
15h00 — Je retourne au poste d’écoute, c’est assez calme.
Quelques crapouillots à droite.
17h00 — Je prends la garde dans la tranchée. Là aussi, c’est tranquille.
19h00 — Je vais au repos ; quelques instants après m’être endormi, je suis éveillé par un caporal qui va recommencer ma patrouille d’hier soir, mais dans le sens opposé, et qui désire quelques tuyaux. Je le renseigne du mieux que je peux, sachant toute la valeur de ces renseignements. La patrouille ne partira qu’à minuit ; on s’attend à une attaque sur un secteur situé assez loin à notre droite.
20h00 — Je suis à nouveau étendu.
21h00 — La nuit vient. Le Sergent fait sortir tous les hommes du gourbi ; au lieu de se reposer à l’intérieur de celui-ci, ils pourront le faire dans la tranchée. Seuls, nous restons à deux caporaux ; en cas d’alerte, le caporal de service dans la tranchée nous préviendrait.
23h00 — Cette fois nous devons tous sortir, cependant il n’y a pas d’attaque ; c’est même relativement calme.
Samedi 19 juin 1915
0h00 — C’est mon tour de prendre le service au poste d’écoute ; il fait sombre et il faudra veiller sans cesse. La patrouille qui devait partir à minuit est déjà rentrée, elle était partie en avance et a tait très vite. Je me trouve dans une sape ou l’on y voit à peine. De temps à autre, je vais à l’extrémité du poste pour voir st les guetteurs veillent.
1h00 — Le jour commence à poindre et on commence à mieux distinguer les objets se trouvant dans le boyau. Nous n’avons pas d’alerte ; quelques balles arrivent au sommet du poste, tirées sans doute trop bas par les veilleurs de nos tranchées.
2h00 — Dans la tranchée, c’est tranquille. Il fait déjà bien clair. Un aéroplane quitte nos lignes, on ne l’aperçoit pour ainsi dire pas ; sans doute a-t-il une mission importante à remplir pour avoir pris l’air à une heure aussi matinale.
3h00 — Je fais balayer le boyau, la tranchée, et le gourbi. Comme les matins précédents, le temps est très clair ; il fera chaud dans la journée.
4h00 — Au repos. Je dors un peu.
5h30 — Distribution du café, ensuite je m’endors à nouveau. Il tombe quelques obus et quelques crapouillots à notre droite.
8h00 — Rien de nouveau. Toujours échange de projectiles au même endroit.
10h00 — Poste d’écoute. Violent bombardement. Je suis obligé de m’abriter sous la sape pour me garantir des éclats d’obus qui tombent tout autour. Par moments l’action ralentit, puis recommence ; il faut sans cesse être sur le « qui-vive ».
Pendant les deux heures que dure ma faction, c’est la même chose.
12h00 — Il fait très chaud, et jusqu’ici il n’y a pas eu de corvée d’eau. Le quart de vin distribué avec la soupe a été bien vite bu. Bombardement assez violent des deux côtés ; par bonheur les projectiles tombent derrière la tranchée et il nous suffit de nous abaisser rapidement pour nous garantir des éclats.
14h00 — Heure de la relève. Je vais au repos. Le bombardement continue toujours, les obus tombent à droite et à gauche ; on n’a aucune perte à subir.
16h00 — La chaleur est intolérable ; on peut à peine s’étendre dans le gourbi qui est occupé au grand complet, et cependant on tombe de sommeil. Toujours pas d’eau.
17h00 — Le cuisinier de la Section vient d’être tué par un éclat d’obus en nous montant le repas du soir. Moitié est perdue, les autres sections se privent toutes un peu pour que nous mangions ; nous avons ainsi suffisamment, d’ailleurs chacun a ses petites provisions auxquelles il touche dans les cas semblables.
18h00 — Conférence dans le gourbi sur la situation militaire et la durée de la guerre. Qu’on a tort de parler de cela quand on est aussi peu fixé, c’est
dire que chacun donne son avis qui est différent de celui du voisin. C’est officiel qu’au nord d’Arras nous avons repoussé une contre- offensive allemande menée par onze divisions, ce qui est un chiffre énorme.
20h00 — Je reprends le poste d’écoute ; il faut veiller, mais aucune alerte. Une compagnie voisine tend des fils de fer barbelés pour garantir sa tranchée.
22h00 — Je suis de service dans la tranchée. Un sergent, un caporal et deux hommes sont occupés à installer des fils de fer sur notre mur de sacs de terre. Je passe dans chaque travée prévenir qu’on ne tire pas dessus. Poser des fils n’est pas une agréable besogne, il faut circuler debout et on risque fort d’être aperçu de l’ennemi.
23h00 — Au moment de redescendre dans la tranchée, le sergent faillit être touché par une balle qui lui frôle la tempe gauche ; il l’a échappé belle et en reste sourd un instant.
24h00 — Je rentre au repos.
Dimanche 20 Juin 1915
3h00 — Le jour est venu. Vive fusillade venant des tranchées allemandes et qui nous oblige à prendre chacun notre poste au créneau. Vont-ils attaquer ? C’est ce qu’on se demande, car enfin, pourquoi tant de coups de fusil ? Bientôt les crapouillots
et les obus pleuvent et forment un concert admirable avec les balles. Il faut se tenir sur ses gardes pour éviter les projectiles. Pourtant les allemands ne se décident pas à attaquer.
4h00 — Je passe au poste d’écoute ; il faudra avoir l’œil, car canons et fusils ne cessent de tirer. Mes deux heures de service se passent ainsi.
6h00 — Pas de changement. Les allemands qui occupaient la tranchée hier ont sans doute été remplacés par d’autres, car de tranquille qu’elle était, la situation est devenue plutôt
mauvaise. Nous allons être relevés d’ici une demi-heure, parait-il, par une autre compagnie, pour aller cette fois en réserve.
6h30 — Toujours la fusillade et ta canonnade ; nous avons un tue et trois blessés. La relève ne vient pas. L’artillerie bombarde le boyau de communication et empêche la compagnie de relève de venir nous remplacer.
7h00 — Pas de changement, on ne peut commencer la relève. Le boyau est déjà rompu par endroits.
8h00 — Le canon cesse un instant, il faut réparer le boyau : nous ne serons relevés qu’à 13h.
8h30 — La fusillade cesse aussi, mais nous ne devons pas quitter le créneau.
9h00 — Fusillade et canonnade reprennent. Enfin, que nous veulent les Boches ?
Ils n’attaquent pas et ne cessent de tirer. Les sacs de terre formant la partie supérieure de nos parapets sont percés par leurs balles. Même les fils de fer tendus hier soir sont coupés à plusieurs endroits. Les crapouillots éclatent avec un bruit infernal.
10h30 — Insensiblement le calme est revenu et nous mangeons la soupe qui vient d’arriver, toujours sur le qui-vive, bien entendu.
11h00 — Nous avons enfin la clef du mystère, nous connaissons la cause de la fusillade de ce matin. Le ...ème Régiment d’infanterie, venant pour faire la relève dans un secteur situé à notre droite et ne connaissant pas les lieux, s’était aventuré en plein terrain découvert au lieu de prendre le boyau. Les allemands, ayant aperçu ce rassemblement, avaient ouvert le feu de leurs fusils et de leurs canons et l’avaient fait durer assez longtemps dans l’espoir de parvenir à empêcher la relève. Y ont-il réussi ? C’est peu probable.
11h30 — Nos pionniers rentrent ; le boyau est réparé et la circulation rétablie.
13h00 — La compagnie de relève arrive ; nous passons nos consignes aux remplaçants puis partons enfin. Comme d’habitude, c’est très rapidement que nous
franchissons le boyau et que nous arrivons aux gourbis de réserve.
14h00 — Nous sommes installés dans un gourbi tout ce qu’il y a de plus gourbi ; c’est un chenil, haut d’à peine un mètre, où nous sommes entasses à trente environ. On ne peut s’y mouvoir qu’à genoux ou en rampant ; le sol est recouvert de fougères sèches, le toit formé de rondins qui, à notre avis, ne suffiraient pas à nous garantir d’un bombardement éventuel. C’est là que nous coucherons, et malgré tout, je persiste à croire que nous y dormirons bien.
16h00 — Notre 75 tonne sans arrêt derrière nous et prépare sans doute une attaque pour ce soir.
17h00 — Départ d’une corvée chargée de porter de l’eau en première ligne. Je n’en fais pas partie et dors en attendant sa rentrée.
19h00 — La corvée rentre ; c’est à cette heure-ci seulement que nous mangeons la soupe ; il faut se tenir presque constamment dans les gourbis, car les obus arrivent de temps à autre, et il ne faut pas non plus que les avions allemands puissent nous repérer.
20h30 — Chacun est étendu sur sa couche de fougères poussiéreuses et ne tarde pas à s’endormir.
Lundi 21 juin 1915
5h00 — Nous avons dormi d’un sommeil de plomb et n’avons entendu ni canon ni fusillade. 6h00 — Nous prenons le café.
7h00 — Je suis appelé pour accompagner une corvée d'eau. Nous devons déjà aller chercher l’eau dans un village des environs pour la porter ensuite en première ligne.
7h30 — Nous arrivons à La Harazée, village bombardé. C’est un site magnifique entre des montagnes vertes rendues encore plus pittoresques par les innombrables petites huttes accrochées à leurs flancs ; c’est dommage que le bruit constant des canons et des fusils ne rappelle à la réalité. A droite, en arrivant à La Harazée, se trouve un petit cimetière où se dressent de nombreuses croix encore blanches sur les tombes des hommes tués. Il y a autour du village plusieurs de ces petits cimetières, paraît-il : ils sont propres avec des arceaux autour de chaque tombe. Pas un jour ne passe qu’on n’y apporte plusieurs tués.
8h00 — Les arrosoirs s’emplissent. Beaucoup de Services militaires sont établis là, entre autres un hôpital d’évacuation. On y rencontre des hommes de tous les régiments de la Division.
8h30 — Nous gravissons la côte menant à l’entrée du boyau conduisant en première ligne et rencontrons plusieurs blessés ou malades : l’un d’eux a da avoir une très forte commotion, car son regard est hagard et il semble ne plus rien entendre ; un autre a la figure couverte de sang, mais il ne doit être que légèrement atteint, n’étant pas accompagné.
9h00 — Nous sommes dans le boyau. Avec six hommes, je dois
ravitailler en eau la 11ème Compagnie qui occupe le secteur immédiatement à droite de celui que nous avons quitté hier. La distribution d’eau se fait, le plus justement possible, mais chacun n’a qu’un quart d’eau.
10h00 — Sommes revenus en réserve non sans avoir été obligés plusieurs fois de nous baisser pour éviter les éclats d’obus.
12h00 — Il tombe toujours quelques obus.
16h15 — Brusquement, le 75 commence à donner avec fureur, les coups se suivent à intervalles très courts, il tire sans doute sur les premières lignes allemandes.
16h25 — Aussi brusquement qu’il avait commencé, le 75 cesse de tirer. On entend alors une fusillade très nourrie et l’éclatement des projectiles à main et des crapouillots. Le canon allemand tire aussi sur nos lignes. Beaucoup de balles perdues viennent s’aplatir sur les arbres qui nous entourent ; il faut rentrer dans les gourbis.
16h35 — L’ordre est donné de s’équiper, c’est l’alerte ; on craint certainement que les allemands n’avancent et que nous ne soyons obligés d’aller renforcer. La fusillade est toujours très vive, l’attaque continue.
16h45 — Notre 2ème Section qui était en piquet reçoit l’ordre de gagner les boyaux pour aller en première ligne. C’est sans doute par précaution seulement.
Folio 59
17h00 — Nous sommes toujours sous les gourbis, dans l’attente. La lutte est toujours aussi chaude. Le 75 recommence à donner ; c’est un bruit assourdissant.
7h30 — Le calme semble revenir peu à peu, bien que les mitrailleuses crachent toujours. La soupe n’arrive pas, les cuisiniers ont dû être obligés de rester en chemin par suite du bombardement.
18h00 — La soupe arrive, le calme est revenu. Il faut manger la soupe très rapidement car plusieurs corvées doivent monter en première ligne.
18h15 — J’accompagne une corvée de cartouches en première ligne. En gagnant celle-ci, nous croisons dans le boyau notre 2ème Section qui n’a pas eu à intervenir et qui rentre en réserve.
19h00 — C’est très calme, avec toujours quelques coups de fusil et de canon.
20h00 — Petit à petit tout le monde rentre. Espérons que nous aurons notre nuit tranquille.
21h00 — L’attaque a repris certainement, car voilà toute la pétarade en route ; allons-nous avoir encore alerte ? Quelques gros obus allemands éclatent tout près.
21h15 — Le calme est revenu brusquement. On s’endort.
Mardi 22 juin 1915
5h00 — Quelques obus pour nous éveiller. Il paraît que vers 1h du matin il y a eu encore attaque. Pour ma part, je n’ai rien entendu.
Folio 60
9h00 — Rien de nouveau.
15h00 — Le temps se couvre brusquement ; il va faire de l’orage certainement.
15h30 — La pluie tombe très fort. Nous craignons que comme au Four de Paris, le toit ne soit traversé par l’eau.
16h00 — La pluie a passé ; le toit est encore sec, il doit être plus résistant. 19h00 — Vif commencement d’attaque qui ne dure guère que trois minutes.
19h10 — L’attaque recommence aussi vive que tout à l’heure. C’est à croire que l’on ne sera jamais tranquille.
19h20 — L’attaque a cessé. Quel est le résultat ? Peut-être est-il nul. 21h00 — Chacun repose, recroquevillé dans le gourbi.
Mercredi 23 juin 1915
6h00 — Distribution du café. Il y a encore eu une attaque cette nuit, paraît-il ; décidément les boches ont juré de ne plus nous laisser en repos. C’est aujourd’hui notre dernière journée de réserve ; espérons qu’aucun empêchement ne surviendra pour nous supprimer les quelques jours de repos auxquels nous avons droit. La pluie a tombé toute la nuit, transformant le sol argileux en une boue gluante dans laquelle
on a peine à avancer. Ceci donne une petite idée de ce que devaient être les boyaux pendant l’hiver.
7h00 — J’accompagne une corvée d’eau à La Harazée, puis en première ligne. C’est très fatigant de marcher dans cette boue et on emporte un kilo de terre à chaque pied. En allant à La Harazée, nous rencontrons plusieurs petites voitures de blessés transportant des morts. Tous sont plus ou moins mutilés, l’un d’eux a la tête complètement enlevée.
8h00 — Je suis de retour de première ligne, j’ai de la boue jusqu’aux genoux, que je suis obligé de gratter avec mon couteau. Mes molletières sont un bloc de boue.
9h00 — La pluie tombe, ce n’est pas cela qui fera sécher la boue. La situation semble calme, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver.
12h00 — L’ordre arrive de démolir notre gourbi pour le reconstruire en l’agrandissant. Nous devons déménager notre fourniment ; je crains que la pluie ne reprenne et qu’alors nous n’ayons plus d’abri.
13h30 — Ce que je craignais est arrivé, la pluie tombe ; nous ne savons où nous mettre ; la reconstruction du gourbi était cependant en bon chemin.
15h00 — Le gourbi est agrandi, il faut maintenant le recouvrir : une corvée part pour aller chercher des rondins.
15h10 — La corvée revient sans rondins ; comment allons-nous recouvrir le gourbi ? N’aurait- on pas mieux fait d’attendre que les rondins soient là pour commencer à découvrir ? La pluie menace toujours et cette nuit nous serons sans abri.
15h30 — Il faut recouvrir avec les vieux rondins ; pour cette nuit, on se contentera de cette couverture sommaire ; en cas de pluie, nous étendrons nos toiles de tente.
15h50 — L’ordre arrive de nous équiper, il va y avoir attaque à notre gauche et il faut se tenir prêts.
15h55 — L’attaque commence, très vive, et dure assez longtemps. Le bruit court qu’au lieu d’aller au repos, nous retournerons demain en première ligne ; ce ne serait pas une agréable surprise, car voilà déjà huit jours que nous sommes de service.
17h00 — La soupe arrive. La pluie tombe. On reste équipé par crainte d’une alerte.
19h00 — L’attaque ne s’est pas renouvelée, par contre c’est officiel que demain à 3h30 du matin nous relevons la compagnie de première ligne.
20h00 — Nous sommes tous étendus sous le gourbi à peine recouvert ; il fait froid et la terre sur laquelle nous reposons est très humide. On dort cependant, et je suis sûr que nous n’aurons même pas le rhume.
Jeudi 24 juin 1915
3h00 — Le signal est donné que chacun s’équipe ; l’une après l’autre, les sections gagnent le boyau pour aller en première ligne.
3h15 — C’est notre tour d’avancer. Le boyau est plein d’eau et de boue, on y enfonce jusqu’à la cheville, c’est très fatigant.
3h30 — Nous sommes réinstallés en première ligne, chacun dans sa travée. Nous ne savons pas pour combien de temps nous sommes ici. Nous autres, caporaux, prendrons six heures de garde, six heures de repos, et ainsi de suite. D’après les renseignements tirés de la compagnie que nous relevons, le secteur est assez tranquille ; c’est plus à gauche que l’on se bat.
5h00 — Je commence par être au repos. C’est assez tranquille au-dehors. Le gourbi que nous occupons est plus vaste que celui dans lequel nous étions la dernière fois en première ligne. Il n’a par contre qu’une ouverture et il est par conséquent plus sombre ; d’un autre côté le courant d’air est évité. Il est recouvert de gros rondins et de terre, et je ne pense pas qu’un obus de petit calibre soit à craindre. On y tient à douze sans être trop serrés.
10h00 — Un brancardier vient d’être tué dans un boyau ; il appartenait à une compagnie sœur.
12h00 — Je quitte le repos pour prendre mes six heures de garde, avec deux autres caporaux. Notre tâche nous est fixée
à chacun. Je dois faire l’inventaire des grenades et des pétards, puis faire aménager des trous dans les tranchées pour loger ceux-ci. C’est rapidement fait.
13h00 — De temps à autre, je fais une petite ronde pour voir si chacun veille. Quelques crapouillots tombent à notre droite, mais généralement trop en arrière ; nous répondons par des projectiles du même genre. Il pleut un peu et la tranchée qui était presque sèche redevient boueuse.
15h00 — Un crapouillot vient d’éclater derrière la tête d’un homme de la Section et il est devenu sourd tout d’un coup ; c’est déjà la seconde fois que cet accident lui arrive. Il n’a pas perdu connaissance, mais n’entend rien ; un brancardier l’accompagne au poste de secours.
16h00 — Le soleil chauffe une ondée. Il tombe toujours quelques crapouillots, ce qui nécessite une extrême vigilance.
18h00 — Je rentre au repos. « Il paraît » que nous serons relevés dimanche matin.
21h00 — Le Sergent fait sortir tous les hommes du gourbi pour veiller et travailler au-dehors ; nous restons à deux caporaux à dormir jusqu’à notre tour de garde : minuit.
Vendredi 25 juin 1915
0h00 — Je suis éveillé par le caporal que je dois relever. Je viens de dormir trois heures et bien que la couche soit humide et dure, je serais volontiers resté
étendu quelques heures encore. Un caporal s’occupe de la pose de fils de fer avec trois pionniers, un autre et moi sommes chargés des rondes. Le calme est presque complet ; dans chaque travée il y a un veilleur, les autres qui relèveront à l’heure indiquée dorment dans un coin sous une toile de tente ou à demi enfouis dans une sape. La nuit est assez claire, de plus des fusées éclairantes illuminent le ciel à certains instants.
1h00 — Le canon gronde à gauche et la fusillade devient très vive, il y a sûrement attaque. Par dessus le parapet, nous jetons un coup d’œil dans la direction ; c’est un véritable feu d’artifice avec les fusées qui se succèdent sans interruption. C’est notre feu de la Saint Jean puisque nous sommes dans la nuit du 24 juin.
1h15 — L’attaque a cessé, ce n’était qu’une alerte.
1h30 — Le jour vient rapidement, le temps est couvert.
3h00 — La pluie commence à tomber juste comme nous commencions le nettoyage de la tranchée ; celle-ci est bientôt boueuse et glissante. On balaie quand même avec des balais quelconques, venus je ne sais d’ou.
4h00 — Nous apprenons que pendant vingt-quatre heures, à partir de 5h ce matin, nous aurons à fournir un certain nombre d’hommes pour un poste d’écoute. Ils devront rester douze heures de suite dans ce poste. Nous autres caporaux, nous relèverons toutes les six heures.
5h00 — Les hommes sont choisis, puis partent au dit poste d’écoute.
6h00 — Le café arrive ; je le bois et vais au repos.
8h00 — Bien qu’ayant veillé six heures, je n’ai pas sommeil et reste étendu sur la banquette de terre.
10h00 — Le Sergent vient nous distribuer notre quart de vin et nous annonce en sème temps que nous serons relevés demain matin. Est-ce bien certain ? Cette nouvelle est accueillie avec plaisir, car après quelques jours de réserve, nous espérons bien cette fois aller au repos.
11h00 — Je vais relever le caporal au poste d’écoute ; il parait que ça va de 5h à 11h et de 11h à 17h, six heures par conséquent.
11h15 — La relève est faite ; les hommes sont à leurs emplacements. Ce poste est très long et non couvert, celui du caporal excepté, qui se compose d’une niche dans la terre et de quelques rondins au-dessus du boyau pour garantir contre la pluie. Il y a une boue affreuse dans les boyaux du poste d’écoute.
11h30 — La soupe arrive. (Nous appelons indistinctement « soupe » tout ce que l’on nous apporte à manger, que ce soit de la viande, des légumes, ou du fromage. Nous ne touchons d’ailleurs jamais de soupe proprement dite dans les tranchées, pour cette raison que les récipients qui devraient la contenir ne pourraient pas passer dans les boyaux). Le repas se compose de rôti et de pommes de terre avec des pois nouveaux ; c’est très bon, et avec cela, il
y en a en abondance et je pense que personne ne songera à se plaindre de la nourriture cette fois-ci.
12h00 — La chaleur n’est pas excessive, mais on étouffe ; nous aurons sans doute encore de l’eau avant bien longtemps. Il tombe toujours quelques crapouillots.
13h00 — Echange très vif de crapouillots ; les allemands surtout redoublent d’activité. Un sifflement au-dessus de nos tètes, puis l’éclatement bref d’un obus ; c’est notre 75 qui a repéré le canon à crapouillots allemand et qui tente de le faire taire. Un moment, la tranquillité revient, puis les crapouillots recommencent à tomber ; alors, le 75 redouble son tir et a enfin le dernier mot.
14h00 — J’ai établi un service au poste pour que ce ne soit pas toujours le même homme qui ait la plus mauvaise place.
15h00 — La pluie commence à tomber à grosses gouttes ; je me blottis du mieux que je peux dans ma niche pour éviter l’eau. J’ai les pieds dans un lac de boue.
15h15 — La pluie tombe toujours, mais moins fort. La boue est devenue plus molle et on y enfonce encore plus.
16h00 — Les allemands commencent à nous bombarder ; au poste d’écoute, nous sommes passablement garantis des éclats. La fumée produite par l’éclatement est verdâtre et je me demande si ce ne seraient pas des gaz asphyxiants.
16h15 — Les obus tombent toujours produisant un
nuage vert qui reste au-dessus des tranchées. Je me renseigne près du Sergent ; il croit que ce sont des obus ordinaires de 105.
17h30 — Nous sommes relevés du poste d’écoute et je rentre dans la tranchée pour manger la soupe.
18h00 — Le Général passe dans les tranchées qu’il inspecte rapidement.
19h00 — Je vais au repos et m’endors aussitôt.
Samedi 26 juin 1915
2h00 — Je m’étonne qu’on ne m’ait pas éveillé à minuit, c’était mon heure de relève. J’apprends qu’un caporal seul est nécessaire pour veiller à cette heure là, c’est pourquoi on m’a laissé deux heures de plus. Rien de mieux puisqu’il n’y a pas alerte.
3h00 — Le jour est venu, je m’occupe du nettoyage des boyaux ; ils sont boueux et on a beaucoup de peine à enlever cette boue.
5h00 - Il y a eu une attaque à gauche, elle a duré peu de temps. Le café arrive.
6h00 — J’entre au repos ; allons-nous être relevés ?
7h00 — Je ne puis dormir. Nous ne serons relevés que ce soir.
9h00 — Il y a une mine qui saute à droite ; certains ont entendu des cris : encore des hommes à demi enfouis, sans doute ? À mon avis, de tous les périls
qui nous guettent, c’est la mine le plus redoutable.
12h00 — Je prends le service dans la tranchée. Les crapouillots ne tardent pas à arriver, il faut guetter avec soin. De mon côté, je m’installe entre deux gabions d’où il me sera possible d’observer tout le ciel au-dessus du secteur ennemi. La chaleur est très forte et pas d’ombre.
13h00 — Toutes les dix minutes, j’entends le coup sourd du canon à crapouillots allemand : vivement, je jette un coup d’œil et m’assure que le projectile ne vient pas dans ma direction. D’autres qui l’ont aperçu avant moi sifflent pour avertir et chacun se gare en attendant l’explosion. C’est énervant d’observer ce cylindre noir qui décrit une courbe en l’air avant de tomber. L’explosion est forte et soulève la terre des tranchées.
13h30 — Un crapouillot est tombé sur un abri de tranchée et a démoli la toiture ; l’occupant en est quitte pour la peur et une douleur bénigne au bras qui a dû recevoir un morceau de bois du toit.
14h00 — Les crapouillots viennent maintenant dans ma direction ; par bonheur, on les entend partir, et on peut suivre leur trajet en l’air et se garer au moment opportun. Je m’étonne que nous ne répondions pas à cette pluie d’explosifs.
15h00 — Les crapouillots ne tombent plus. Il fait toujours très chaud.
16h00 — Nous serons relevés demain au point du jour ; décidément, on joue avec nous : c’est notre onzième journée de service et on a bien du mal à se tenir éveillé.
17h00 — Nous mangeons la soupe.
17h05 — Une nouvelle mine saute, toujours dans le même secteur à droite. C’est loin, cependant la terre tremble jusqu’ici.
18h00 — Je reprends mon repos après avoir bu une large rasade de coco. Il fait très lourd.
19h00 — Je sommeille, mais m’éveille au moindre bruit.
22h00 — Je suis éveillé en sursaut par une fusillade d’une extrême violence venant du secteur de gauche ; c’est venu brusquement, c’est sans doute une attaque par surprise qui a été éventée au moment propice. Nous sortons du gourbi pour prendre place dans la tranchée.
22h10 — Le canon donne cette fois ; chez nous c’est tranquille, mais il faut veiller activement par crainte d’une surprise.
22h15 — Le Lieutenant m’envoie chercher. Je me rends près de lui et reçois l’ordre de me tenir à l’entrée du boyau de sortie avec deux hommes baïonnette au canon ; la consigne est de ne laisser passer qui que ce soit.
22h20 — La consigne est levée ; je rentre au repos.
22h30 — L’attaque est terminée. C’est maintenant la droite qui devient nerveuse.
Dimanche 27 juin 1915
00h00 — Je suis éveillé par le caporal de service que je dois relever. La fatigue des jours passés revient ; j’ai les jambes cassées, par moment mes yeux se ferment, cependant je veux résister.
1h00 — Avec le Sergent et un homme, je vais poser des fils de fer barbelés sur les gabions et les pare-éclats. Nous sommes grimpés sur le parapet qui est mouvant et nous risquons à chaque instant de tomber dans la tranchée. On s’arrache les doigts après les barbes du fer, la capote ou le pantalon s’accrochent, et on ne sait plus de quel côté avancer. Il fait un clair de lune magnifique et je m’étonne que les allemands ne nous aperçoivent pas.
2h00 — La pose des fils de fer est terminée ; je continue mes rondes pour vaincre la fatigue.
3h00 — Il fait grand jour ; on commence le nettoyage des tranchées.
3h30 — Le Capitaine de la compagnie de relève arrive. Enfin, c’est la relève probablement.
4h00 — La compagnie de relève arrive ; nous nous préparons à évacuer la tranchée pour revenir en réserve, un peu à l’arrière.
4h15 — Nous nous tenons toujours prêts à partir, mais le
Folio 72
signal n’est pas donné. On ramasse les lunettes et les tampons pour le nez et la bouche contre les gaz asphyxiants.
4h30 — Enfin arrive l’ordre : « Première Section, sac au dos, en avant ! ». Nous défilons le long du boyau de communication et arrivons en cinq minutes à la réserve.
4h45 — Nous avons repris nos anciennes places dans les gourbis. Le nôtre qui était en voie de reconstruction et que nous n’avions pas pu terminer faute de rondins pour la couverture, a été achevé par la compagnie qui nous a remplacés et est maintenant plus confortable ; il y a même une bonne couche de paille d’étendue sur le sol.
5h00 — Chacun repose en attendant le café.
5h30 — Le café arrive ; on s’empresse de se faire servir.
8h00 — Vive attaque à notre gauche, qui commence très brusquement.
8h15 — L’attaque continue toujours ; notre secteur est très tranquille ; à peine quelques coups de fusil.
10h30 — J’étais profondément endormi, lorsqu’arrive la soupe ; je suis complètement perdu et ne sais plus s’il est midi ou 16h. Nous dormions tous, d’ailleurs.
14h00 — Je commence à nettoyer mes bandes molletières et le bas de ma capote qui sont couvertes de boue jaune. Cette boue forme des plaques sur les vêtements et ressemble absolument (la comparaison est vulgaire, mais
c’est celle qui s’applique le mieux dans ce cas) aux jambes des vaches dont la litière n’est que rarement changée. Il faut gratter au couteau, puis battre à la baguette flexible, et encore ne parvient-on qu’à enlever le plus gros.
16h00 — Nouvelle et très vive attaque, toujours dans le même secteur de gauche, comme il y a huit jours (route de Beaumanoir). L’ordre arrive de nous équiper. Nous sommes bombardés très violemment, ce qui nous oblige à nous tenir sous nos gourbis ; les obus éclatent tout près.
16h30 — L’attaque continue. Notre 75 tire sans arrêt, c’est un roulement continuel. Il nous arrive toujours des obus de gros calibre qui envoient des éclats très loin. Ce serait dangereux de sortir.
17h00 — L’attaque semble ne pas vouloir finir ; le canon et les mitrailleuses ne cessent de tirer. On entend également l’explosion des explosifs à main.
17h30 — Nous mangeons la soupe rapidement ; il tombe toujours quelques obus. L’attaque semble ralentir.
19h00 — Nous nous étendons pour nous reposer un peu. Espérons que la nuit sera bonne et qu’on ne nous éveillera pas par suite d’une alerte.
21h00 — Je suis éveillé en sursaut : « Tout le monde en tenue et dehors ! » L’attaque recommence. Allons, il était
écrit que nous ne serions pas tranquilles. Le fusil entre les jambes, nous attendons, assis sur le parapet du gourbi. C’est toujours la gauche qui donne. De nombreuses fusées sont lancées de part et d’autre pour diriger le feu de l’artillerie.
21h10 — La fusillade commence très loin à droite et se trouve accompagnée bientôt d’une violente canonnade. Décidément, les boches veulent faire la trouée.
21h20 — L’attaque de gauche s’apaise et nous rentrons. Comme le secteur est de piquet, il est fort probable que nous n’en sommes pas quittes avec cette simple alerte.
Lundi 28 juin 1915
0h15 — L’attaque recommence sur la gauche ; nous devons nous tenir prêts.
0h25 — Le calme revient très vite. Nous reprenons notre sommeil interrompu.
2h15 — Le Sergent arrive à l’entrée du gourbi et ordonne de sortir avec fusil et équipement. Il fait à peine jour et le combat fait rage à nouveau sur la gauche. La droite est calme. Nous descendons dans le boyau de première ligne pour nous rapprocher de celle-ci, au cas où l’attaque se propagerait à notre secteur. Il y a une boue épaisse dans le boyau et on enfonce jusqu’à la cheville.
2h30 — Avec un sergent et douze hommes, nous occupons une
jonction de boyaux, avec la consigne de ne laisser circuler personne.
2h35 — Le calme revient petit à petit. J’ai peine à me tenir éveillé ; nous espérions passer une nuit tranquille, et nous en sommes déjà à notre troisième alerte.
3h00 — Le jour est venu et avec lui un calme complet. Nous conservons notre poste par précaution ; d’ailleurs il faut attendre les ordres supérieurs pour rentrer.
3h30 — Nous sommes toujours là. Des crapouillots commencent à tomber en avant de nous ; quelques coups de fusil.
3h45 — Le Sergent m’envoie au Lieutenant demander si nous devons rentrer. Je fais deux cents pas et rencontre l’homme de liaison ; il apporte l’ordre de se retirer que je transmets au Sergent.
4h10 — Nous rentrons dans nos gourbis. Quelques obus tombent aux environs.
5h00 — Nous sommes à peine endormis que le café arrive ; nous préférons cela à l’alerte.
6h00 — De très gros obus, des 120 au moins, tombent dans notre coin. Un ordonnance vient d’être grièvement blessé par un éclat. Chacun se terre ; je me demande si notre gourbi résisterait à un gros obus.
7h00 — Nous sommes terriblement bombardés ; ce ne sont pas des 120, mais au moins des 210, qui creusent d’énormes trous en terre et soulèvent la grève et les branchages
à hauteur des arbres. Un sergent de la 2ème Section vient d’être blessé.
7h30 — Le bombardement est terrible, un obus vient de faire un trou énorme derrière notre gourbi ; nous sommes aplatis sur le sol qui tremble à chaque explosion. Ce n’est pas blessé qu’est le sergent, c’est tué d’un éclat d’obus à l’épaule et dans le cou.
8h00 — Un obus tombe à deux mètres derrière le gourbi, abattant un gros arbre et soulevant un nuage de poussière effrayant qui rentre dans le gourbi et nous aveugle. Le moment est terrible ; les obus sont tombés tout autour, vont-ils maintenant nous atteindre ?
9h00 — Le bombardement est moins intense, les obus tombent un peu plus loin, on se risque à sortir la tète : il y a des trous d’au moins un mètre de profondeur à quatre endroits différents, on y enterrerait deux chevaux dans chaque ; plusieurs arbres, d’une grosseur raisonnable, sont fauchés et les troncs des autres environnant sont criblés d’éclats. Nous l’avons échappé belle ; c’est la première fois que nous sommes bombardés de cette manière, c’est à croire qu’un espion est passé ici et a renseigné l’artillerie allemande. On ramasse des morceaux d’obus énormes qui sont coupants et traverseraient le corps très facilement. Ils sont encore brûlants.
10h00 — Il tombe encore des obus et pour la première fois on ne servira pas la soupe en plein air. Chacun préfère rester caché dans le gourbi, bien qu’on ne s’y sente pas suffisamment en sûreté.
11h00 — Le bombardement a presque entièrement cessé.
14h00 — C’est assez tranquille, bien que des obus tombent encore, par deux cette fois.
16h30 — Une vive attaque commence à gauche. Un distingue parfaitement le tir la mitrailleuse allemande, Le 75 entre bientôt dans la danse, c’est alors le roulement ininterrompu qui vous assourdit.
17h00 — L’ordre est donné de nous équiper ; allons-nous une nouvelle fois gagner les boyaux ?
17h30 — L’attaque continue, plus ou moins vive.
18h00 — Le canon et les mitrailleuses donnent toujours.
19h00 — L’attaque n’est pas encore terminée, mais devient moins vive. C’est regrettable que nous ne sachions jamais le résultat. Le bruit court que dans les attaques d’hier nous avons utilisé du pétrole enflammé ; c’est si monstrueux que l’on ose à peine y croire.
20h00 — Le canon et la mitrailleuse ne se sont pas encore complètement tus. Je crois que nous avons été relevés du piquet par une autre section.
Aurons-nous notre nuit tranquille cette fois ?
23h00 — Je suis éveillé par le bruit de la fusillade. Celle-ci ne dure que peu de temps. Je ne puis dormir, les jambes me font souffrir ; voilà treize jours et treize nuits qu’elles sont serrées et je ne puis enlever mes molletières que quelques minutes chaque jour ; le sang circule difficilement.
Mardi 29 juin 1915
5h30 — La nuit a été tranquille ; nous avons pu nous reposer plus qu’à l’habitude, c’était bien nécessaire. Nous comptions être relevés ce matin pour aller au repos, mais il parait que demain nous retournerons en première ligne pour deux Jours, puis reviendrons ensuite en
réserve jusque dimanche. Ce n’est pas très encourageant et ceci doit être la faute du ...ème Régiment qui a perdu des tranchées, à notre gauche sans doute.
7h00 — Le bombardement commence. Les obus tombent pour le moment assez loin de notre gourbi.
7h30 — Nos gourbis ne sont plus bombardés, mais voici que nos premières lignes, celles de notre secteur principalement, sont bombardées par des « minen ». C’est le nom que nous donnons aux projectiles lancés par les « Minenwerfer » ; leur effet est terrible. Ces projectiles, d’un poids de 80 kg sont chargés de 50 kg de tolite, explosif remplaçant la dynamite
et qui explose avec un bruit cinglant en détruisant d’un seul coup des éléments de tranchées. Heureusement que leur vitesse n’est pas énorme et qu’on les voit arriver souvent ; cependant on ne peut pas se garer et on est alors fatalement déchiqueté.
8h00 — Ces minen tombent toujours ; pour nous qui sommes en arrière il n’y a rien à craindre, mais la situation de ceux qui gardent les premières lignes doit être précaire. D’ici nous voyons les nuages de fumée noire s’élever des tranchées après l’explosion du projectile.
8h10 — Je dois accompagner une corvée de pétards en première ligne, et à cet effet me rends tout d’abord au dépôt de munitions.
8h15 — En même temps que ma corvée en arrive une autre au dépôt, celle-ci venant de La Harazée ; un des hommes vient d’apprendre que le 94ème serait relevé cet après-midi par le ...ème Régiment. Ceci ne coïncide guère avec les nouvelles de ce matin qui nous faisaient rester cinq jours encore. Cependant j’espère que ce dernier tuyau sera le plus exact.
8h30 — Je suis en première ligne avec la corvée. Les hommes qui gardent ces tranchées sont tous aux aguets, craignant à tout instant l’arrivée d’un minen. Ils ont eu plusieurs blessés déjà et des éléments de tranchées détruits.
9h00 — Je rentre au gourbi de réserve où le bruit court avec persistance que nous partons ce soir. On ose à peine espérer, de crainte d’une désillusion.
10h00 — La soupe arrive. Les minen tombent moins nombreux. Quelques obus arrivent jusqu’à nous.
13h00 — Un détachement du ...ème arrive réellement, c’est le commencement de la relève sans doute. Les officiers se passent les consignes, c’est donc bien certain que nous partons. Chacun se sent le cœur plus léger.
13h10 — L’ordre est donné de s’équiper et de boucler les sacs. Une compagnie du ...ème arrive.
13h30 — Tous équipés, nous gagnons le boyau de communication vers l’arrière que nous suivons d’un pas rapide ; nous avons hâte de sortir de la zone dangereuse.
13h40 — Nous passons devant les gourbis de réserve de Beaumanoir, où se trouve le ...ème Chasseurs.
13h50 — Nous arrivons au sommet du ravin qu’il faut suivre pour gagner la route de Vienne- le-Château. Les obus éclatent pas loin et les éclats arrivent jusqu’à nous.
14h00 — « Halte ! » On nous fait signe de mettre sac à terre et de nous asseoir. Chacun s’abrite derrière un parapet naturel, car les obus tombent toujours. Que
signifie cette halte ?
15h00 — La halte se prolonge ; quand on prend la direction du repos, on trouve toujours que l’on va trop lentement.
15h30 — Il paraît que nous allons retourner à Beaumanoir pour y manger la soupe. Nous ne partirons qu’à 19h ce soir. Pourquoi ce retard ? Craint-on que le bombardement à coups de minen ne soit le précurseur d’une attaque allemande ?
16h00 — La soupe arrive. Nous ne sommes pas retournés à Beaumanoir. Il tombe toujours quelques obus. Les compagnies qui ont été relevées de première ligne où elles recevaient des minen disent que leurs tranchées ont été fortement endommagées. Ce n’est certainement pas sans but que les allemands font cela.
17h00 — Pas de changement.
19h00 — Nous mettons sac au dos et partons enfin. Nous avançons d’abord sur un chemin de rondins glissant.
19h30 — Nous atteignons la route ; la marche est plus facile, malgré une boue assez épaisse.
20h00 — Vienne-le-Château. Depuis notre dernier
passage qui date d’à peine quinze jours, le village a bien souffert encore. Des pâtés de maisons qui n’avaient été que partiellement atteints par les obus sont maintenant détruits par le feu. Il ne reste plus que des pans de murs noircis et un monceau de décombres.
21h30 — Après avoir croisé des convois de ravitaillement en vivres et munitions, nous atteignons Vienne-la-Ville. Comme la première fois que je suis passé ici, les ténèbres m’empêchent d’y voir et de reconnaître quoi que soit. Il me semble toutefois qu’il y a beaucoup moins de troupes ici qu’à Vienne-le-Château.
22h00 — Nous avançons toujours sur la route et commençons à être fatigués : le sac est lourd et voilà quinze jours que nous n’avons fait une bonne nuit.
22h30 — Le chemin nous semble long. À tous ceux qui nous dépassent ou nous croisent, nous demandons combien il y a encore jusque Moiremont (car il paraît que c’est là que nous allons). Les réponses sont évasives.
23h00 — Un carillon nous annonce un village, c’est Moiremont. Il y a longtemps que nous n’avions
entendu un son de cloches. Nous arrêtons devant un cantonnement.
23h10 — Nous venons de prendre place dans un grenier, très bien aéré, trop bien même, car il est pour ainsi dire ouvert de trois cotés ; les murs sont faits de planches disjointes et le plancher tient à peine. La paille manque, il faudra coucher à même sur la planche ; on y dormira bien quand même, car nous sommes exténués. En dessous de nous, c’est une écurie occupée par huit ou dix chevaux.
23h15 — Nous sommes installés tant bien que mal.
Mercredi 30 juin 1915
3h00 — Le canon tonne terriblement. Il doit y avoir une terrible attaque sur un large secteur. 4h00 — Je me suis endormi à nouveau et suis brusquement éveillé par des cris du garde d’écurie d’au-dessous. C’est à cause de ses chevaux, tout simplement ; aussi lui envoyons- nous nos louanges pour nous avoir éveillés si tôt et sans raison.
5h00 — Le canon tonne toujours. Ce doit être épouvantable en première ligne, car ce n’est plus une
simple petite attaque certainement.
6h00 — II arrive des blessés en grande quantité ; presque tous sont du régiment qui nous a relevés hier.
7h00 — Le café arrive seulement. La conversation roule uniquement sur le combat de la nuit ; on n’a pas de détails, mais les allemands ont dû avancer après un bombardement terrible. Nul doute qu’ils n’aient été arrêtés.
8h00 — Je vais au ruisseau en compagnie de trois camarades pour m’y laver un peu d’importance. Voilà quatorze jours en effet que nous n’avons pu nous passer un peu d’eau sur la figure.
9h00 — Après un nettoyage sérieux, nous rentrons au cantonnement, puis ressortons pour voir s’il n’y aurait pas moyen de se ravitailler un peu pour faire un bon repas. Effectivement nous trouvons des petits-beurres, du vin d’un prix exorbitant (trois francs la bouteille ordinaire), de la salade, de la confiture et d’autres douceurs ; même des cerises que l’un d’entre nous est allé cueillir aux environs.
9h30 — Le Colonel du ...ème Régiment a été tué ce matin et deux capitaines blessés ; je viens de voir ces deux derniers. Qu’est-ce qui a da se passer cette
nuit ?
10h00 — Le bruit court que nous n’allons pas rester ici, contre-coup des affaires de la nuit. Peut-être aura-t-on besoin de nous pour tenir ?
10h30 — Après avoir prévenu le Sergent, nous nous rendons chez de braves gens (car il faut que je dise qu’ici il y a des civils, encore une nouveauté pour nous autres) qui acceptent de nous faire une omelette et de préparer notre salade. Nous mangeons dans des assiettes et buvons dans des verres : quel luxe pour des barbares comme nous.
11h00 — Le repas va son petit train, l’appétit est excellent et nous avons du vin en quantité suffisante.
11h15 — Quelques obus sifflent, mais vont éclater beaucoup plus loin. Brusquement, le monsieur chez qui nous sommes nous presse de sortir, il craint le bombardement ; pour répondre à son désir, et c’est d’ailleurs la moindre des choses à faire, nous nous retirons après avoir réglé. C’est égal, nous n’aurions pu supposer une fin de repas aussi brève ; par bonheur, nous avions presque terminé. Nous aurions bien essayé de faire comprendre à ce monsieur qu’il n’y avait rien à
craindre, mais nous comprenons bien sa peur. Il va se réfugier dans une cave.
12h30 — Nous rentrons au cantonnement ; il parait que nous sommes en alerte. Rapidement, je boucle mon sac pour être prêt en cas de départ précipité. Je crois avec les autres que nous aurons bien du mal à avoir notre temps de repos prévu.
13h00 — Les bruits les plus divers circulent : les allemands se seraient avancés assez loin dans nos lignes ! C’est assez peu probable. Il ne faut pas ajouter foi à tous ces bruits non confirmés.
15h00 — Pas de changement. Les ambulances défilent toujours.
17h00 — Nous mangeons ce qui reste de notre repas de midi, puis allons nous étendre sous des pommiers, à proximité du cantonnement.
17h30 — Deux aéroplanes français survolent tantôt les lignes françaises, tantôt les lignes allemandes. À deux ou trois kilomètres d’ici se trouve un ballon d’observation français. Il est en descente en ce moment.
20h00 — Au moment de rentrer au cantonnement, le canon recommence à gronder ; c’est sans doute le début d’une contre-attaque.
21h00 — Nous sommes étendus dans la paille. Le canon gronde de plus en plus.
Jeudi 1er juillet 1915
3h00 — Je suis éveillé par le canon ; le combat doit encore être épouvantable.
6h00 — Le café bu, j’accompagne une corvée de balayage des rues. C’est un travail plus long que difficile ; je n’ai pas à y mettre la main, mais ce n’est pas intéressant de regarder des hommes balayer pendant deux heures.
9h00 — A peine rentrés au cantonnement, on nous prévient de nous tenir prêts et propres. Nous allons rendre les honneurs au Colonel du ...ème tué hier. Chacun astique, brosse, cire, et finalement est propre comme on peut l’être en campagne.
9h30 — On entend une musique qui joue dans un coin du village. Tous les jours, il y a concert par la musique d’un régiment quelconque. Je me demande s’il devrait être permis de faire de la musique à l’arrière, alors qu’à quelques kilomètres, sur le front, il y a des hommes qui se
font tuer, déchiqueter, et que l’on emporte en morceaux affreux à voir dans des toiles de tente. Espère-t-on par cette musique nous égayer ? Sans doute, mais je remarque que sur mes camarades aussi bien que sur moi, c’est l’effet
contraire qui se produit. Peut-être que les militaires qui se trouvent dans le village, et qui pour une raison ou pour une autre vont jamais aux tranchées, trouvent du plaisir à écouter la musique, mais pour nous qui ne prenons ici que quelques jours de repos, le cas est différent ; cette musique nous fait sentir que pendant que nous souffrons dans la tranchée il y en a qui s’amusent à l’arrière. C’est l’avis de plusieurs de mes camarades, c’est pourquoi je soulève cette question.
11h00 — Il passe quelques blessés. Je crois qu’il est bon de ne pas trop s’éloigner du cantonnement ; une alerte est possible.
14h00 — Le courrier arrive.
14h15 — L’ordre arrive de boucler les sacs. Moitié des hommes sont absents, partis en corvée commandée.
14h20 — Un agent de liaison accourt. « Immédiatement en tenue, et rassemblement pour le départ ! » Cette fois c’est l’alerte véritable ; à mon avis, nous avons bien fait de profiter hier de notre repos car le voilà aux vents.
14h25 — Les hommes de corvée rentrent par petits groupes, beaucoup cependant manquent.
14h45 — La Compagnie est rassemblée, ainsi que les trois autres du Bataillon. Nous partons pour Ronchamps, paraît-il. Il manque encore des hommes à l’appel.
Folio 89
15h00 — Le signal du départ est donné. Un sergent reste pour emmener ensuite les retardataires. C’est bien la preuve que notre départ ne souffre aucun retard. Nous partons au pas cadencé et l’arme sur l’épaule jusqu’à la sortie du village. Il fait une chaleur torride et les nombreux convois qui nous croisent ou nous dépassent soulèvent des nuages de poussière qui s’abattent sur nous. Bientôt un Escadron de Chasseurs d’Afrique nous dépasse ; tous ont la nouvelle tenue kaki et sont montés sur des chevaux rapides. Nul doute qu’ils ne laissent leur monture en chemin puis n’aillent aux tranchées.
15h30 — Nous quittons la route pour suivre un sentier à travers bois et éviter ainsi le feu de l’artillerie ennemie. Nous faisons bientôt une pause.
16h30 — Traversons un ravin par lequel nous étions déjà passés en allant au repos à La Croix-Gentin.
17h15 — Arrivons au Ronchamps et formons les faisceaux devant les baraquements. Il est interdit de se déséquiper, nous pouvons partir d’un moment à l’autre.
18h30 — Assistons à un combat aérien. Un aéro français fond sur un aéro allemand et l’atteint certainement à coups de mitrailleuse car celui-ci ne tarde pas à descendre assez précipi-
Folio 90
-tamment.
21h00 — Nous allons partir à 21h30, paraît-il, et la soupe du soir n’est pas encore arrivée. Chacun touche à ses vivres de réserve.
21h30 — A partir de là, je perds la notion du temps, tant les incidents se succèdent avec rapidité. Nous partons alors qu’un violent duel d’artillerie commence ; des obus éclatent non loin de nous, il semble que l’on se faufilerait dans un trou de souris pour éviter leur atteinte. Nous continuons notre route sur le flanc d’une colline qui nous préserve des obus, mais ceux- ci sifflent au-dessus. Le bombardement est sans doute trop violent de l’avis du Commandant pour essayer d’atteindre la crête, car on nous fait aplatir derrière un parapet et attendre. C’est un bruit étourdissant de canons qui tonnent et d’obus qui éclatent avec des éclairs rouges. Puis le bombardement diminue d’intensité, on va tenter alors de gagner la crête et d’arriver à Vienne-le-Château. Par petits groupes, à cinquante pas les uns des autres, nous avançons rapidement et la traversée se fait sans encombre, heureusement. A peine descendus de la crête, plusieurs d’entre nous, puis tous ensuite, se plaignent de picotements dans les
yeux en même temps qu’une certaine odeur que je ne pourrais définir nous prend à la gorge. Nul doute que les derniers obus allemands ne contenaient des gaz asphyxiants. Vivement nous mettons nos lunettes et nos respirateurs. Je dois dire que l’odeur à la gorge n’est pas très forte, pourtant un de mes voisins vomit. Les yeux souffrent plutôt et ne cessent de pleurer. Enfin nous traversons Vienne-le-Château et allons à cent mètres de l’autre côté du village où nous allons sans doute passer la nuit. En effet, au bout d’un quart d’heure environ, nous sommes conduits dans un baraquement où toute la Section se loge. On y est très serrés, mais on se case comme on peut. Lorsque chacun fut étendu sur la paille, il était environ 23h30. Nous sommes ici en réserve, et d’un moment à l’autre l’ordre peut arriver d’aller de l’avant. La soupe n’a pu venir.
Vendredi 2 juillet 1915
3h00 — Violente canonnade. Nous ne sommes pas alertés.
6h00 — Le café arrive ; le canon ne cesse guère, pas plus que la fusillade d’ailleurs ; on doit se battre sans cesse dans différents secteurs.
9h00 — C’est toujours la même situation. Nous
craignons d’être alertés à chaque instant ; il passe des blessés en quantité, la plupart blessés aux bras où à la tête.
14h00 — L’ordre arrive de s’équiper immédiatement. Ceci fait, nous sortons et nous préparons à aller en ligne. Pour la seconde fois en vingt-quatre heures, je ne sais plus à quelle heure exactement se passent les évènements, tant le moment est tragique. Il serait impossible de décrire ce qui se passe alors et ce qui suit ne peut en donner qu’une faible idée. Par rafales, les obus allemands tombent et éclatent à quelques mètres du boyau de communication avec un bruit de tonnerre et lançant des milliers d’éclats qui sifflent au-dessus de nous ; quelques- uns même atteignent certains d’entre nous à la tête ; vivement ils lâchent leur sac, leur équipement, et courent à l’arrière se faire panser. Bientôt c’est la course folle dans le boyau qui monte, avec le sac qui vous brise le dos ; la chaleur est torride et le tumulte ne cesse pas. Tous les dix pas, nous croisons des blessés, les uns soutenant leur bras, d’autres essayant avec un doigt ou la main de fermer une blessure. Il y en a qui ont la tète en sang et qui sont affreux à voir.
Folio 93
Cependant la course continue dans cet interminable boyau et la sueur me coule de partout, je me sens tout trempé ; quand même, on court. Brusque arrêt ; on se baisse pour éviter les éclats, le sol est moucheté du sang des blessés. On repart et tourne à droite, et on
continue à courir à travers des travées et des travées qui semblent n’être occupées que par peu de poilus. Puis on arrête, on se place dans les travées. « Desserrez ! » On desserre. « Resserrez ! » On resserre. Et toujours la pluie d’obus, mais plus loin en arrière ; en avant c’est la fusillade effrénée et l’explosion des pétards, bombes et grenades. Quelle affreuse tuerie ce doit être. Je crois que nous allons rester là, car on nous ordonne de mettre sac à terre. Une Compagnie sœur passe, ayant laissé son sac en arrière : indice qu’ils vont pour une besogne pressée, une charge à la baïonnette certainement. Nous sommes très énervés ; pourtant assez rapidement le calme renaît. Allons-nous passer la nuit ici ? Non, nous remettons sac au dos et reprenons le chemin par où nous sommes venus. Lorsque nous rentrons au gourbi, il est 17h. Tous nous sommes d’accord pour dire que nous venons d’en voir une fière ; pourtant nous n’avons
que des pertes infimes.
18h00 — Les blessés passent toujours, plus grièvement atteints ceux-ci ; à travers les boyaux on les porte sur des civières, puis arrivés à la sortie de ce boyau, on les accroche sur une voiture de blessés à bras et ainsi on les emmène à Vienne-le-Château où ils seront pansés soigneusement.
20h00 — Les blessés défilent toujours. Je me couche non sans me demander si nous serons tranquilles cette nuit.
22h00 — Attaque. Nous nous équipons et attendons des ordres.
22h10 — L’attaque étant terminée, nous nous étendons à nouveau.
Samedi 3 juillet 1915
1h00 — Nouvelle attaque. Pas d’alerte.
2h00 — Alerte. Nous partons pour les tranchées, cependant tout est calme. À quoi sommes- nous encore destinés ? Nous suivons le boyau, mais sans nous presser ; nous passons près des positions que nous occupions hier après-midi, mais allons plus loin et arrivons bientôt au boyau conduisant en première ligne. Donc nous allons en première ligne, c’est un fait certain.
3h00 — Nous stationnons dans le boyau dont les parapets sont couverts de sacs renfermant des pétards et des cartouches. On nous a fait mettre sac à terre, est-ce que nous irions à la baïonnette ? il fait jour, pourtant les allemands lancent encore des fusées éclairantes et chaque fois que l’une d’elles passe au-dessus de nous, nous nous faisons tout petits pour ne pas être repérés.
3h30 — Nous avons remis sac au dos, donc pas de charge pour le moment, et nous continuons notre chemin à travers les tranchées occupées par un régiment qui a perdu sa première ligne il y a quelques jours. Comme il n’est pas en mesure de la reprendre, on fait appel aux autres régiments et c’est ce qui nous vaut de venir à l’attaque au lieu d’être restés tranquilles à Moiremont.
4h00 — Nous passons sous un souterrain et à sa sortie... plus de tranchée !!! La forêt tout autour. Dans quelle direction sont les boches ? Nous avançons prudemment et arrivons à deux
cents mètres de là derrière un petit parapet derrière lequel nous nous abritons ; il y a là notre Compagnie sœur dont j’ai parlé la veille, que nous venons renforcer.
Chaque homme s’est creusé un petit trou pour se dissimuler. C’est presque la guerre en rase campagne. Nous apprenons par nos camarades de l’autre compagnie que, comme nous l’avions pensé, ils ont chargé hier à la baïonnette et ont chassé l’ennemi d’un réseau de boyaux assez important, mais encore incomplet, et nous croyons avec eux que nous venons pour une nouvelle charge qui nous rendra maîtres de nouveaux boyaux. Pendant leur charge de la veille ils ont eu quatre tués et trente-deux blessés, dans seulement deux sections ; c’est beaucoup, mais les gains sont appréciables.
4h30 — Ma demi-section reçoit l’ordre de gagner les positions conquises la veille ; l’attaque partira sans doute de là. Le Lieutenant m’ordonne de fermer la marche, de sorte que la demi- section une fois entrée dans le boyau, c’est moi qui en garde l’entrée.
5h00 — On a réussi sans charger à pousser le barrage de vingt mètres dans le boyau conduisant aux lignes allemandes. Les boches eux aussi ont construit un barrage et tentent au moyen de tous les projectiles possibles de détruire notre barrage pour avancer à leur tour, mais c’est bien gardé et ils ne peuvent faire un pas. Le Caporal de la 1ère
est atteint au bras par une balle ; il court à l’arrière. Trois bombardiers sont atteints en tentant d’avancer encore le barrage. Les bombes et pétards pleuvent ; là où je me trouve, je suis assez bien garanti. Les officiers qui dirigent l’action sont à deux pas de moi.
6h00 — Il tombe des crapouillots en avant de nous. On entend les allemands creuser une tranchée face à nous ; par dessus le parapet, nous tirons sur eux, mais ils sont en contre-bas ; toutefois il est probable que plusieurs soient atteints. Eux aussi tirent sur nos hommes qui mettent le boyau reconquis en état de défense.
8h00 — Il n’est plus question de charge à la baïonnette. Bien que ça n’était pas une perspective intéressante, nul d’entre nous ne tremblait ; d’ailleurs le matin est si beau qu’on le croirait choisi pour l’offensive. En me renseignant, j’apprends que c’est là en avant que deux compagnies ont été ensevelies sous leurs tranchées ; en effet la route de Beaumanoir est légèrement à notre gauche.
10h00 — Chaleur insupportable. Toujours quelques coups de fusil de part et d’autre. Il doit y avoir quelque boche grimpé dans un arbre, car
à plusieurs reprises différentes, des balles viennent s’aplatir sur le sol : il veut nous canarder à merci ; jusqu’ici il n’a pas fait de victime.
12h00 — Il fait une chaleur effrayante et pas d’ombre. Il y a un cadavre français dans nos lignes que l’on n’a pu encore ensevelir et qui est couvert de mouches ; on jette une toile de tente sur lui.
13h00 — Il y a un homme qui dit avoir descendu un boche de dedans un arbre. Est-ce vrai ? Je ne l’ai pas vu.
14h00 — Un homme de mon escouade a le sommet de la tète traversé par une balle et il saigne beaucoup. Il ne doit être que légèrement atteint car il n’a pas perdu connaissance. Un sergent le panse rapidement et il part accompagné.
15h00 — Je reçois l’ordre d’accompagner un lieutenant du Génie près du nouveau barrage ; il doit être chargé d’entreprendre des travaux dans ces positions : je le conduis près de l’officier qui est dans le boyau. A peine sommes nous arrivés là que l’homme qui gardait le barrage pousse un cri affreux ; il se sauve dans le boyau, la main affreusement mutilée : deux doigts pendent, sanglants ; il est atteint également à la figure. Un tel
spectacle nous retourne le cœur. Cette blessure a dû être causée par l’éclatement d’un pétard allemand ; pourtant je n’ai pas distingué d’explosion et c’est peut-être l’œuvre d’une balle.
16h30 — Des officiers du ...ème Régiment prennent les consignes ; je pense que nous serons relevés avant la nuit.
17h00 — La soupe mangée (on l’apporte ici au prix de mille dangers, puisque sur environ trois cents mètres il n’y a qu’un petit parapet de terre qui garantit), je prends la garde dans le boyau repris depuis hier.
18h00 — La relève arrive. Sans nous faire prier, nous passons les consignes aux remplaçants, puis mettons sac au dos et partons. Arrivés dans le boyau qui conduit à l’arrière, la file s’arrête, puis longtemps reste stationnaire. C’est incompréhensible qu’au moment de la relève on ne puisse laisser les boyaux entièrement libres, car bientôt on se presse, on s’entasse, et un seul obus tombant à quelques pas de là causerait des pertes effrayantes.
19h00 — Enfin, avec bien du mal, nous arrivons en seconde ligne, puis en troisième, et c’est là que nous allons passer la nuit. Nous croyions aller plus loin, mais nous sommes contents d’être là, car on y est presque entièrement en sécurité (si ce n’est quelques
obus). Les tranchées sont larges et la surveillance moins sévère ; les allemands sont à un kilomètre et il y a des troupes entre eux et nous.
20h00 — Nous mangeons un peu, puis on s’étend. Je parle pour les autres en ce moment, car je dois prendre la garde jusqu’à 23h30.
22h00 — Je fais quelques rondes pour m’assurer que l’on veille.
23h30 — J’éveille le caporal qui me relève et m’étends à mon tour à la belle étoile, et je ne tarde pas à m’endormir.
Dimanche 4 juillet 1915
5h00 — Café au lait concentré ; c’est très bon. J’ai dormi comme un loir, la tête sur mon sac. Il y a eu une attaque vers 2h, parait-il, je n’ai rien entendu.
6h00 — Le bruit court que nous retournons aux tranchées ce matin. Veulent-ils donc notre peau ? Ils ont pourtant la graisse et nous avons bien besoin de repos.
8h00 — « Sac au dos ! » Nous retournons aux tranchées, non pour surveiller, mais pour taire les corvées d’eau, de munitions, etc... Ce sera sans doute fatigant, mais moins énervant, et nous aurons la nuit tranquille, espérons-le !
8h30 — Nous arrivons entre les deuxiéme et troisième lignes, où se trouvent les gourbis dans lesquels nous logerons en attelant les ordres de corvées. Ce sont des gourbis bizarres que ceux-ci, et dont je n’aurais jamais supposé l’existence. Ils sont blindés, et lorsque l’on arrive à l’intérieur on se figurerait entrer dans le métro, par exemple, iI y fait un noir complet. Les plaques d’acier qui recouvrent les parois ont une épaisseur de cinq millimètres environ et les gourbis étant à us mètre cinquante ou deux mètres sous terre, il y a peu de danger des cous. On a établi deux étages pour le couchage et on a recouvert les planches de branchages pour que ce soit moins dur. Voilà notre couche pour ce soir... et peut-être les nuits suivantes également.
10h00 — Il y a déjà des corvées qui partent, pour transporter des cartouches ce la poudrière aux premières lignes.
14h00 — Chaleur torride.
18h00 — Toujours des corvées ; c’est moins énervant d’être ici qu’en ligne, mais c’est aussi dangereux puisque nous faisons ces corvées en première ligne, et c’est fatigant car on transporte des pare-balles en acier pour placer sur les tranchées.
20h00 — Au moment où la nuit tombe, je reçois l’ordre d’accompagner une corvée dans un certain secteur qui m’est complètement inconnu. Arrivé au poste de commandement où mes hommes doivent déposer les créneaux qu’ils apportent,
on m’ordonne de les porter plus loin, sur l’emplacement où ils doivent être utilisés. C’est un bon kilomètre plus loin, à travers des tranchées tortueuses et étroites.
20h30 — Mon reçu signé, nous revenons, quand se déclenche une attaque : la fusillade est très vive et le canon donne à son tour ; nous sommes obligés de nous asseoir et d’attendre que le calme soit revenu pour retourner à l’arrière, car sur une très longue distance on est à découvert, et nous risquerions fort d’être atteints par les projectiles ennemis.
21h00 — Canon et fusils se sont tus ; nous reprenons le chemin du retour, mais il fait nuit, et j’ai beaucoup de peine à m’y reconnaitre dans le dédale des sentiers qui courent à travers bois. Mes hommes veulent savoir le chemin mieux que moi ; finalement je retrouve le chemin par lequel nous sommes venus. Avant de rentrer, je compte mes hommes : dix au lieu de douze ; je fais attendre ; au bout d’un quart d’heure les deux retardataires arrivent et nous rentrons tous ensemble.
22h00 — On est très mal couché sur les feuillages, les branches sont trop fortes et vous entrent dans le dos.
Lundi 5 Juillet 1915
5h00 — Le café arrive. J’ai dû bien dormir car une corvée de quatre-vingts hommes est partie à 23h, est rentrée à 3h du matin, et je n’ai rien entendu. Je me suis éveillé les côtes en long. Verrons-nous la relève aujourd’hui ?
9h00 — Départ des premières corvées. Le temps est moins chaud aujourd’hui. Il y a un régiment entier (celui de Tulle) qui vient relever les première et deuxième lignes. Nous restons toujours là.
14h00 — L’ordre est donné de confectionner deux cents chevaux de frise à la Compagnie. Les chevaux de frise sont destinés à mettre le devant des tranchées en état de défense. Ils se composent de trois piquets reliés ensemble par leur milieu de manière à ce que, dans quelque position qu’ils soient placés, ils reposent toujours sur trois pieds. Les extrémités sont reliées entre elles par du fil de fer barbelé qui constitue la vraie défense. Ils ont un mètre de haut en général et on ne peut les franchir que difficilement. Placés en ligne devant le parapet des tranchées, ils sont une entrave à l’attaque ennemie. Pendant que celui-ci les franchit, il est canardé à merci par les créneaux.
16h00 — La confection des chevaux de frise en reste là, car des corvées sont commandées. Il faut transporter des gabions, des fusées, des cartouches, des pétards, dans toutes les directions.
19h00 — J’accompagne une corvée de fil de fer en deuxième ligne.
21h00 — Je suis étendu sur mon feuillage rempli de vermine. Il y a là plusieurs bataillons de poux et de puces.
Mardi 6 juillet 1915
5h00 — La nuit a été tranquille : pas une seule attaque. Les allemands ont sans doute renoncé à leur offensive en Argonne. Quelle nuit exécrable
j’ai passée ! Je me suis démangé toute la nuit. Comme je voudrais être au repos pour changer de linge et détruire la vermine. Et nous sommes tous dans le même cas. Il n’est plus question de relève !
7h00 — La confection des chevaux de frise recommence et est menée activement. Je m’égratigne les doigts en entortillant le fil de fer barbelé autour des piquets.
7h30 — L’Etat-major d’un régiment de coloniaux vient reconnaître le secteur. Ce régiment est- il pour nous relever ? N’espérons pas trop vite !
10h00 — Les corvées continuent ; je n’en fais pas partie. C’est là que l’on sent l’avantage d’un petit galon : non seulement le caporal ne porte rien lorsqu’il accompagne une corvée, mais il n’en fait pas le quart des hommes.
12h00 — Les hommes sont partis en corvée, je suis étendu sur les planches. Le bruit court que nous retournerons encore en première ligne avant d’aller au repos. Décidément on ne sait que penser d’un si long séjour aux tranchées. S’il faut retourner en ligne, je crains que l’on ne dorme au lieu de surveiller.
17h00 — On ne parle plus ni de relève, ni de première ligne. J’accompagne une corvée d’eau à Vienne-le-Château, puis rentre. À mon retour j’apprends qu’à
l’instant vient d’arriver l’ordre de relève. Nous serons remplacés dans le courant de la nuit par un bataillon du ...ème Colonial
et nous irons au repos à Florent. C’est une heureuse nouvelle qui se colporte rapidement. Du coup, les hommes partent en corvée beaucoup plus gaiement. Un des hommes de notre Section est disparu depuis 4h de l’après-midi ; qu’est-il devenu ? S’est-il égaré au retour d’une corvée, ou a-t-il été blessé ou tué ?
20h00 — Le nettoyage du cantonnement et des alentours se fait comme la nuit tombe, puis les sacs sont bouclés. Le Chef de Bataillon qui vient de passer a dit que nous serions relevés entièrement à 3h du matin. Cette fois la nouvelle est bien officielle et nous allons prendre la direction de l’arrière.
23h00 — Je ne puis m’endormir ; à droite et à gauche j’entends des ongles sur la peau ; nous sommes tous dévorés. Deux hommes partent pour préparer les cantonnements au repos.
Mercredi 7 juillet 1915
1h30 — Tout le monde est debout et s’équipe, c’est le départ ; il fait encore nuit. On se presse, pourtant on est fatigué et le Commandant le sait car il s’est renseigné sur les hommes que l’on doit exempter de sac.
1h45 — Nous partons ; l’homme de corvée disparu n’a toujours pas reparu. Nous croisons le bataillon qui relève le nôtre et arrivons à Vienne-le-Château.
2h30 — Le jour vient comme noua atteignons Le Ronchamps ; on doit faire une pause à cause des nombreux traînards qui viennent derrière.
3h30 — La Fontaine Ferdinand ; bivouac du même genre que La Croix Gentin. Beaucoup d’artillerie lourde et de campagne. Le nombre des traînards augmente : la route est accidentée et fatigante à suivre.
5h00 — Sommes arrivés à quatre cents mètres de Florent et faisons une pause prolongée, les cantonnements ne sont sans doute pas encore répartis.
6h00 — Entrons dans Florent l’arme sur l’épaule et au pas cadencé. Le Bataillon défile devant son Commandant, puis se rend aussitôt dans son cantonnement. Nous habitons dans un grenier ordinaire où est étendue une épaisse couche de paille plus ou moins propre.
7h00 — Le café arrive ; nous le buvons en mangeant un peu de confiture que nous avons pu déjà nous procurer.
8h00 — Je gobe deux œufs frais : quel régal ! Nous trouvons aussi du vin blanc à quatre-vingts centimes, il est bon. Nous trouvons du beurre et des petits-beurres. Si nous pouvions cette fois ne plus être alertés ! Nous nous proposons
de préparer un chocolat au lait excellent ce soir.
10h00 — Chacun boit et mange des gâteries. Quelle différence avec la vie de première ligne. 15h00 — Je vais et viens, nettoie mon fusil et essaie de dormir.
16h00 — Je me rends à une source éloignée d’environ un kilomètre, et procède là à un nettoyage sérieux ; justement, j’ai touché une chemise et un caleçon neufs et je change de linge. Qu’il fait bon se mettre les pieds et les jambes à l’eau.
18h00 — Je fais une tournée dans Florent et achète une demi-douzaine d’œufs frais que je mange crus ensuite. Nous n’avons pu préparer le chocolat au lait, ce sera pour demain.
20h00 — Je suis étendu sur l’épaisse couche de paille et attends le sommeil. Comme c’est drôle d’entendre le canon si loin !
Jeudi 8 juillet 1915
6h00 — Je suis éveillé comme la plupart du temps au repos par le cri de « au jus ! ». Je remarque qu’au repos il n’y a pas de sucre dans le café. À 8h il y aura revue d’armes par le chef armurier en vue des réparations nécessaires.
7h00 — Tout le monde est occupé après son fusil et sa baïonnette. La toile émeri, le papier de verre sont d’un usage courant pour l’astiquage ; en temps de paix, leur emploi nous vaudrait de la prison. Combien de choses tolérées ! Il ne
pourrait en être autrement d’ailleurs.
8h00 — Revue d’armes. Fusil en bon état.
10h00 — Soupe. Nous trouvons des tartes et en faisons une ample consommation. Il est assez facile également de se procurer du vin. Est-ce utile de dire que certains en abusent ?
14h00 — Départ de la Compagnie pour l’exercice de lancement de pétards et grenades. Les caporaux sont exempts (avantage du petit grade).
15h00 — Etendu sur ma toile de tente, je rêvasse. Je ne suis même pas bien sûr que je ne m’ennuie pas : il faut vraiment qu’on n’ait plus tout son bon esprit ! A propos de toile de tente, je crois ne pas exagérer en disant que c’est l’objet le plus nécessaire au troupier et il le sait bien. On voit beaucoup d’hommes sans chaussettes, on en voit beaucoup plus sans chemise, mais on n’en voit pas sans sa toile de tente. Est-on au bivouac en plein air par un beau temps, on passe la nuit enveloppé dans la toile de tente : pleut-il, on est dessous ; est-ce de jour par un beau soleil, on se garantit de celui-ci et des mouches avec la toile de tente. Est-ce cette fois dans un gourbi, la toile sert de portière ; pleut-il et le toit est-il perméable, la toile sert de plafond. Dans la tranchée de deuxième ligne par un grand
soleil, placée sur quatre piquets elle sert d’ombrelle. Elle sert de manteau s’il pleut très fort. Le matin on balaie le cantonnement et l’on enlève les ordures, toujours dans la toile de tente, et le hasard voudra que ce soit justement sur cette même toile qu’à l’heure de la soupe le cuisinier dépose le pain. Joue-t-on aux cartes au repos, c’est la toile de tente qui sert de tapis ; manque-t-il des boutons au pantalon, on découd les boutons qui sont sur ses côtés et servent à la rattacher à d’autres toiles semblables. Est-on blessé au bras ou à la cuisse, un morceau déchiré en hâte de la toile de tente sert de ligature. Est-on grièvement blessé cette fois, et le brancard n’est-il pas sous la main, la toile de tente en fait office. Elle a donc bien des usages, cette toile de tente ; eh bien, elle en a encore un, bien pénible hélas : elle sert de cercueil au malheureux soldat qui
tombe dans la tranchée. Voila l’utilité de cette toile jaune imperméable de deux mètres de côté. Quand on lit cette énumération, il y a une chose qui saute immédiatement à la vue : cette toile de tente qui sert à tant de choses ne sert jamais à ce à quoi elle est, d’après son nom, destinée, à monter une tente. En effet je n’ai jamais vu de tente montée à l’aide de cette fameuse toile. D’ailleurs des piquets
spéciaux sont nécessaires : ces piquets, on les touche au dépôt avant de partir, mais la coutume veut qu’on les sème au courant du trajet en chemin de fer, et de fait, je n’en ai jamais vu arriver jusqu’ici. Brave toile de tente, je crois que tu serviras au troupier jusqu’à la fin ; je prévois qu’attachée par les quatre coins au bout d’un bâton, tu lui serviras de baluchon le jour de la libération.
16h00 — Corvée de paille. 0 bizarrerie ! C’est dans des toiles de tente que les hommes transportent la paille.
17h00 — Préparons un chocolat au lait, tout ce qu’il y a d’appétissant.
21h00 — Une nouvelle fois nous nous étendons pour passer une bonne nuit si possible.
Vendredi 9 juillet 1915
3h00 — Alors que je dormais profondément, je suis éveillé en sursaut. Il faut boucler le sac, s’équiper, nous partons à 4h. Décidément nous n’avons pas de chance dans nos périodes de repos. Où va-t-on nous conduire à nouveau ? Retournons-nous en ligne ou allons-nous plus à l’arrière ?
3h45 — Le Bataillon est sur pied ; on attend ; nul, même pas les officiers, ne sait quelle direction nous prenons. Il était écrit que nous n’aurions pas deux nuits tranquilles. Cette situation sera-t-elle de longue durée encore ?
4h00 — L’ordre arrive de former les faisceaux et d’attendre. L’ordre de départ n’est pas arrivé. Les bruits les plus divers courent, comme d’habitude ; celui qui est le plus écouté est qu’hier le ballon d’observation a annoncé l’arrivée en auto d’une brigade allemande sur le front. En cas d’attaque, nous devons nous tenir prêts.
5h00 — Le Commandant passe et ordonne de se déséquiper, mais de se tenir toujours prêts à un départ prochain. Je m’assieds sur une borne ; à part nous autres qui sommes là, personne dans les rues. Les postes, l’Etat-major, le ravitaillement, tous les services militaires enfin, sont fermés et j’envie le bonheur des mobilisés qui, à cette heure matinale dorment encore bien tranquilles, dans un lit, derrière les volets clos.
6h00 — Pas de changement. Toutefois quelques fenêtres s’ouvrent et laissent voir des figures ensommeillées encore d’officiers d’administration.
7h00 — J’entre au cantonnement puis m’étends sur la paille en vue de dormir un peu, si possible.
9h00 — L’ordre est donné de rentrer sacs et fusils. L’alerte est passée ; nous rentrons, heureux d’en être quittes avec seulement trois heures de sommeil en moins.
11h00 — Soupe. Chaleur très forte.
15h00 — L’après-midi se passe comme hier, à rêvasser.
19h00 — Sieste sur l’herbe, autour d’un gâteau, en attendant la nuit.
21h00 — Nous reposons et espérons cette fois passer une nuit tranquille.
Samedi 10 Juillet 1915
6h00 — Café. Je suis prévenu qu’à 7h je dois me rendre avec une corvée de dix hommes au Major du cantonnement. À la hâte je me prépare et préviens à mon tour les hommes, car pendant les périodes de repos, ceux-ci ne trouvent rien de mieux que de s’esquiver dès le petit jour, pour éviter les corvées.
6h45 — Je rassemble ma corvée et me rends à l’endroit indiqué. J’y trouve un lieutenant de la territoriale qui s’occupe des corvées de quartier : ce doit Être un ancien gendarme à voir la façon dont il nous reçoit, ou bien il se figure que nous venons en punition. Bref, mes dix hommes reçoivent des pelles et des pioches, et tous ensemble nous gagnons le cimetière qui est tout près du village. Il y a là une immense fosse qui n’est pas encore creusée suffisamment et ce sera notre ouvrage de la terminer. Nous voici donc passés fossoyeurs ; nous sommes même obligés, avant de commencer les travaux, de remonter six cercueils vides. Le travail terminé, nous pourrons rentrer au cantonnement ; aussi les hommes s’y mettent avec ardeur.
Moi-même, je prends la pelle et la pioche pour passer le temps et me faire les bras.
9h00 — L’ouvrage avance rapidement. Il sera terminé d’ici une demi-heure. Le cimetière de Florent prend des proportions considérables ; là sont enterrés de nombreux officiers amenés du front ; beaucoup de soldats sont là aussi, qui sont morts de leurs blessures en passant au poste de secours de Florent.
9h40 — Le lieutenant territorial vient constater la bonne marche des travaux et nous dit de partir dès que tout sera terminé, ce qui n’est pas long.
10h00 — Nous déposons les outils au magasin et rentrons au cantonnement. Fendant notre absence a eu lieu une revue de bataillon : nous ne regrettons pas d’avoir été en corvée. Le 1er Bataillon du 94 vient d’arriver à Florent, au repos, et je rencontre une foule de camarades de la 31ème de Guer. Comme nous ils en ont vu de dures, de plus dures que nous même, car ils ont fait plusieurs charges à la baïonnette et leurs pertes sont assez sensibles.
11h00 — La soupe mangée, j’apprends qu’à 13h je dois retourner avec les sèmes hommes au Major du cantonnement ; ça n’est pas fait pour me déplaire, car le reste de la Compagnie fera l’exercice jusque 17h.
Je remarquerai simplement que pour un repos c’est bien du service. D’un sens c’est notre faute ; il y avait hier soir, paraît-il, de nombreux cas d’ivresse, et pour empêcher les hommes de s’enivrer on les emmène au-dehors : ce sont toujours les bons qui pâtissent pour les mauvais.
13h00 — Cette fois c’est pour creuser une tranchée destinée à recevoir les ordures ménagères que nous sommes emmenés au dehors du village, toujours par le même lieutenant. Il fait très chaud et les hommes murmurent, se plaignent de l’insuffisance de repos ; j’essaie de leur faire comprendre que la Compagnie étant de jour, c’est nous qui aujourd’hui devons faire les corvées ; c’est en vain. Il me semble pourtant qu’il est plus agréable de creuser des tranchées étant au repos que d’être en première ligne.
15h00 — Le travail avance relativement vite.
16h00 — Tout près de nous une compagnie fait des essais de pétards et de bombes ; c’est pour familiariser les nouveaux arrivés avec tous ces engins.
16h30 — Le travail est terminé ; un sergent de territoriale nous permet de rentrer. Nous remettons les outils au magasin.
17h00 — Nous mangeons la soupe. Des bruits circulent sur le jour de notre départ aux tranchées ; ils sont divers, mieux vaut ne pas les écouter.
18h00 — Je fais une promenade en compagnie de plusieurs camarades du 1er Bataillon. Nous nous racontons nos aventures. Il paraît que le 2e Bataillon serait relevé cette nuit et arriverait demain à Florent. Tout le Régiment serait ainsi au complet, à moins que nous ne partions d’ici là.
19h00 — Un Bataillon du ...ème de ligne part aux tranchées.
21h00 — Je suis à peine couché que quelqu’un passe et annonce que nous partirons à 3h du matin. Ce n’est pas officiel, mais ce n’est pas impossible non plus.
Dimanche 11 Juillet 1915
6h00 — Je suis encore sur la paille, donc nous ne sommes pas partis à 3h. Le café arrive. Une autre compagnie, celle de jour, envoie une corvée pour la fabrication des gabions : les hommes doivent comprendre cette fois que c’est chacun son tour. Je me prépare en vue d’aller à l’église ; je ne sais pas à quelle heure il y a une messe, mais je vais bien voir.
7h00 — J’entre à l’église ; une messe basse commence justement. L’église de Florent est une de ces petites églises de campagne, vieille, mais proprette, et où le calme est tel qu’on s’y croirait séparé de tout le monde extérieur. Il y a quelques officiers et des
hommes.
8h00 — Je rentre au cantonnement. Quelle n’est pas ma surprise en voyant apparaître bientôt Marcel Trousset, qui, revenu au front pour la troisième fois, est adjudant au 2ème Bataillon qui vient d’arriver à Florent. Il vient de faire cinq jours de première ligne à Marie-Thérèse. Je sors avec lui et rencontrons d’autres sous-officiers du 2ème Bataillon revenus nouvellement au front ; tous s’accordent à dire que la guerre de tranchées qu’ils retrouvent est toute différente de celle qu’ils avaient laissée ; elle est beaucoup plus terrible et plus meurtrière. Les torpilles aériennes (minens) sont ce qu’ils redoutent le plus ; ils n’ont pas trop souffert des mines. Tout le Régiment est au complet à Florent, il faut s’attendre à une revue du Colonel.
9h00 — Je ne fais pas dix pas dans la rue sans retrouver de nouveaux camarades ; les uns m’apprennent que certains sont blessés, les autres que certains sont tués. Le 2ème Bataillon semble croire qu’il faudra retourner sous peu aux tranchées en vue d’une attaque générale en Argonne.
10h30 — Soupe. Rassemblement de la Compagnie à 14h pour aller à l’exercice ; que chacun se tienne prêt.
14h00 — Nous gagnons un champ de manœuvre improvisé au pas cadencé et l’arme sur l’épaule. Heureusement, sacs et musettes sont restés au cantonnement.
15h00 — L’exercice n’est pas terrible, il consiste principalement à rester couché auprès des faisceaux et à faire la pause ; c’est ce qui me confirme que si on nous amène ici, c’est dans le but unique de nous tenir éloignés des marchands de vin.
15h30 — Petit exercice de tirailleurs avec lancement de pommes vertes. On entend le canon assez loin dans la direction de Bagatelle.
16h00 — Le Chef de Bataillon arrive, monté, et demande les gradés à lui. Il nous fait une petite théorie sur ces exercices de tirailleurs, puis, changeant de conversation, nous demande de donner aux hommes du « cran et de l’élan » ; il faut éviter la panique, car elle cause les pertes ; si l’on tient bon, l’ennemi ne pourra avancer et c’est lui qui subira les pertes les plus sensibles. Il nous parle également des dernières opérations en Argonne ; si nous avons dû céder du terrain là, c’est qu’une partie de notre artillerie avait été transportée dans la région d’Arras ; elle est revenue maintenant. Il dit quelques mots des obus asphyxiants que nous allons employer, parait-il fil y a déjà si longtemps qu’il en est question).
16h45 — Nous rentrons au cantonnement. Tout le long du chemin il y a des territoriaux qui travaillent
sur la route et font des rigoles sur les côtés, sans doute en vue de l’écoulement des eaux pendant l’hiver prochain. On rencontre des civils endimanchés, ils semblent perdus dans la foule des uniformes.
18h00 — En compagnie de quelques camarades du 1er Bataillon, je sors. Devant l’habitation du maire, où se tient l’Etat-major de la brigade, l’automobile du Général de Division stationne. Bientôt arrivent deux généraux qui prennent place dans la voiture qui part aussitôt. Il a dit y avoir ce soir entrevue des commandants de secteur et autres ; peut-être vient-on de prendre une décision sur les opérations ultérieures.
18h30 — Il y a deux soldats qui font les pitres sur la place. Bien entendu la foule des militaires les entoure.
20h00 — Je rentre pour me coucher. De la paille nouvelle a été étendue à ma place par dessus l’autre ; pourquoi avant de renouveler la litière, ne pas faire enlever l’ancienne où la vermine pullule ? Une corvée de gabions est commandée pour demain, c’est que nous restons encore.
21h00 — La tète sur mon sac et les jambes enfilées dans la toile de tente, j’attends le sommeil ; devant la porte il y en a qui bavardent sans cesse. Si je distingue bien, c’est sur les permissions que la conversation roule. Il parait en effet que dés maintenant il est possible
d’obtenir des permissions. Ceux qui sont sur le front depuis très longtemps et à qui ces permissions reviennent de droit discutent à qui mieux mieux et m’empêchent de dormir. Il est à craindre avec ces permissions que les premiers n’en abusent et n’en fassent ainsi priver ceux qui viendront ensuite.
Lundi 12 juillet 1915
5h00 — Je suis éveillé par le départ de la corvée de gabions ; on cherche des serpes, on crie, on ne trouve rien. Est-ce que cela ne devrait pas être prêt depuis hier ?
6h00 — Café au lait. À 9h30 nous aurons une revue d’armes par les Chefs de Section.
9h00 — Nous descendons nos armes et nous rassemblons ; la revue est rapidement faite par un sergent. Le Lieutenant demande les caporaux et nous prie de lui dire si nous avons des plaintes à formuler au sujet de la cuisine et du vin. Sur notre réponse négative, il s’en va. 13h00 — Rassemblement de la Compagnie pour l’exercice. Comme hier, c’est plutôt la pause que nous faisons.
17h00 — À notre rentrée de l’exercice, j’apprends que nous partons demain à 3h45 du matin pour La Harazée ; notre repos tire donc à sa fin.
17h30 — Pendant que la soupe est distribuée, j’entends une conversation a voix basse. C’est ce soir à 8h que le Bataillon
retourne aux tranchées et non demain. Rapidement la nouvelle circule et chacun s’empresse de monter son sac.
18h00 — Il arrive des casques en acier pour l’infanterie, qui sont distribués aussitôt. Ils se composent d’une calotte en acier épaisse de sept millimètres, entourée d’une bordure en tôle ; sur le dessus quelques ornementations, entre autres une grenade avec les initiales R.F. Certes ce casque sera très utile en cas de bombardement ; il nous garantira jusqu’à un certain point des éclats d’obus, et les balles ayant perdu de leur vitesse glisseront peut-être sur l’acier ; il reste à ce casque à faire ses preuves. Sa couleur est grise et sensiblement la même que celle de notre tenue. Je crains qu’il ne soit lourd à la tète et n’occasionne la chute des cheveux. Nous conservons nos képis qui serviront au repos.
19h00 — Ayant bouclé mon sac, je sors un instant faire mes adieux aux camarades des autres bataillons ; eux aussi croient partir bientôt, cependant que leur repos a été plus court que le nôtre.
19h45 — Rassemblement. Tous affublés du casque, nous défilons devant le Colonel, puis prenons la formation de revue ; le Général de Division va remettre la Médaille Militaire à deux soldats. À cet effet la musique du 94 est présente et exécute la « Marche du 94 », puis la « Marseillaise ».
L’instant est assez émotionnant. Les officiers, sabre au clair, et les troupes, baïonnette au canon, écoutent la lecture des citations ; ensuite, le Général épingle la médaille sur la poitrine des deux militaires et leur donne l’accolade.
20h15 — Toujours au son de la « Marche du 94 », nous quittons Florent au milieu de l’étonnement général de voir défiler des fantassins en casque.
21h00 — La nuit est venue et nous avançons rapidement. Dans la direction du front, tout semble calme ou relativement calme. Il parait que les allemands auraient bombardé La Harazée avec des obus asphyxiants pendant l’après-midi. Si c’est exact, nous pouvons préparer nos lunettes et nos masques.
22h00 — Nous avançons toujours. Sur les côtés de la route, dans l’herbe, il y a une foule de vers luisants qui me rappellent ceux qu’autrefois j’allais chercher le long du canal à Sillery ; là- bas, comme ici, le canon et les fusils n’ont pas dû les empêcher de briller.
22h30 — En avant de nous apparaît brusquement un immense brasier ; c’est un village que nous allons traverser qui est incendié par les obus boches.
23h00 — Nous passons près du brasier, d’où s’élève une forte fumée, au pas de gymnastique pour être le moins longtemps possible dans la zone éclairée.
Par endroits, la route est labourée par les obus et nous nous tordons les pieds à chaque instant. Il règne une petite odeur de gaz asphyxiants, mais qui ne tarde pas à disparaître.
23h30 — Traversons La Harazée, puis arrêtons sur le côté droit de la route ; quelle direction allons-nous prendre maintenant ? Au bout d’un instant, l’ordre arrive de nous coucher si nous voulons, nous allons bivouaquer là ; sans en écouter davantage, chacun s’étend à même sur la route. Cette fois c’est bien la nuit à la belle étoile, et l’on peut dire que le soldat dort là où il s’arrête.
Mardi 13 juillet 1915
0h00 — J’étais bien endormi lorsqu’on nous fait lever, pour nous conduire soi-disant dans des gourbis. Cahin-caha, ne voyant pas à trois pas devant nous, nous avançons ; nous trouvons bien des gourbis, mais tous sont occupés. Le fourrier alors, nous dit que nous devons coucher dans les allées qui relient les gourbis ; nous n’en demandons pas plus et nous installons comme nous pouvons.
3h00 — Le froid m’éveille, je déboucle mon sac et enfile ma veste, puis me recouche.
5h00 — Le café arrive. Il paraît que les 1er et 2ème Bataillons sont en route ; si c’est exact, ils n’auront pas eu autant de repos que nous. Je crois que l’on
craint une recrudescence d’activité chez l’ennemi à cause du 14 juillet.
7h00 — Pas d’ordres ; nous allons et venons sans nous éloigner beaucoup. Une forte odeur de gaz asphyxiant se fait sentir. Chacun met ses lunettes pour éviter de pleurer. Une corvée part à la Brigade, je reste là.
8h30 — La corvée est à peine rentrée que nous recevons l’ordre de nous équiper et de nous rassembler. Depuis un instant le canon tonne et la fusillade ne cesse ; nous partons sans doute en renforts.
8h45 — L’alerte n’était pas pour nous ; nous regagnons nos allées. J’ai l’occasion de parler avec un « territorial » qui me dit avoir beaucoup à faire, parce que son régiment fait les corvées pour la première ligne. Enfin eux sont à peu près en sûreté et ne combattent jamais.
9h00 — Rassemblement à nouveau, mais cette fois nous partons. De nombreux blessés défilent, plus ou moins grièvement atteints. Avant de gagner le boyau qui mène à la tranchée, nous suivons un long ravin balayé par les obus. Sur une distance d’environ vingt pas, une forte odeur de gaz asphyxiant m’oblige à respirer à travers mon tampon à la bouche. Le boyau est peu large, nous avançons avec peine ; pourtant faut-il laisser la place aux blessés qui ne cessent de descendre ; l’un d’eux a les jambes criblées de balles de mitrailleuses.
9h00 — Nous avançons le long de l’interminable boyau ; les obus tombent par ci, par là, mais n’atteignent aucun de nous.
10h00 — Nous nous espaçons dans la deuxième ligne (qui ne doit pas offrir une grande résistance). Les pétards et les obus ne cessent d’éclater, c’est un vacarme épouvantable, mais où nous sommes il n’y a rien à craindre. D’après des renseignements obtenus d’un homme du ...éme d’infanterie, ce régiment a dû ce matin évacuer une tranchée, rendue intenable par les jets de pétrole enflammé lancés par l’ennemi, mais le boyau de communication entre la seconde et la première ligne n’ayant pas été abandonné, il faut le tenir coûte que coûte, et c’est pourquoi notre Compagnie est appelée en renfort.
10h15 — Nous quittons la deuxième ligne pour aller dans un gourbi de repos en attendant qu’on ait besoin de nous.
10h30 — Nous sommes tranquilles dans le gourbi, mais la fusillade, la canonnade et l’éclatement des bombes de toutes sortes forment un bruit terrible qui semble ne pas vouloir cesser. Nous causons de choses et d’autres ; si on nous a fait venir, c’est qu’il faut sans doute reprendre la tranchée perdue ce matin.
11h00 — Toujours même situation. Le combat ne cesse pas.
11h30 — Le Lieutenant commandant notre Section est appelé au Lieutenant commandant la Compagnie, il faut s’attendre
à aller bien certainement à l’attaque, mais attendons les ordres du Chef de Section avant de se faire des idées sur l’emploi de notre Compagnie.
12h00 — L’homme de liaison de notre Section arrive en courant nous prévenir de mettre sac au dos et d’aller retrouver notre Chef de Section ; il va certainement se passer quelque chose d’anormal, nous le sentons intérieurement, sans nous en ouvrir la bouche réciproquement. Nous gagnons le boyau, retrouvons notre Chef de Section qui prend des notes, puis avançons lentement ensuite, ne sachant où nous allons. Actuellement, c’est ce boyau qui sert de tranchée, puisque la première ligne nous a été enlevée ce matin par l’ennemi ; on n’a pas encore eu le temps de l’aménager pour le combat, et il est difficile de se rendre compte des
opérations de l’ennemi, à moins de se lever au-dessus du parapet, mais de s’exposer ainsi à être fusillé par les allemands. Les bombes pleuvent à droite, à gauche, en avant, en arrière. Nous avançons lentement. Toujours beaucoup de blessés ; plusieurs entre autres de notre Compagnie, appartenant à une section venue directement en ligne. Vacarme assourdissant ; nous avançons toujours lentement. Il faut gagner, parait-il, le barrage élevé entre nos positions et celles des boches, puis le percer et avancer autant que possible ; c’est une attaque et une terrible même, car
si nous parvenons à avancer, ce sera la lutte corps à corps dans le boyau. Le Chef de ma Section marche à quinze pas devant moi et je ne suis séparé de lui que par une dizaine d’hommes de la Section. Nous sommes massés là, les yeux dirigés partout pour voir si des projectiles n’arrivent pas ; si par malheur l’un d’eux venait à tomber dans le boyau, le massacre serait affreux, car nous sommes trop serrés pour pouvoir chercher refuge derrière quelque abri. Soudain nous arrêtons ; de bouche en bouche passe l’ordre : « Baïonnette au canon ! ». On s’exécute, on charge même l’arme par précaution, puis on fait dix pas encore. Je distingue alors le commandement de notre Chef de Section : « Allons ! en avant, en avant ! ». Instinctivement nous avançons, nous nous poussons les uns les autres sans savoir exactement de quoi il retourne. Mais j’entends des gémissements et j’aperçois deux hommes : le Sergent Féron et le Caporal Costes, tous deux de ma Section, en emporter un troisième qui n’est autre que le Chef de Section qui a le genou et le bras droit brisés. Ils passent prés de moi, suivis par deux, trois, puis dix camarades de la Section, blessés plus ou moins grièvement et se rendant au poste de secours. Il y a des faces couvertes de sang, des fronts, des poitrines, des jambes qui
saignent, et au milieu du vacarme des bombes, on n’entend que le gémissement des mutilés. Je sens mes nerfs se tendre à la vue de cet horrible spectacle ; je me rends compte que des bombes ont éclaté au milieu du groupe des premiers hommes de ma Section, les atteignant tous ; je ferme les yeux ; un instant je ne sais si je dois reculer ; ce sont maintenant des blessés des autres sections, il y en a qui se traînent sur les genoux, leurs pieds ne pouvant plus les supporter, d’autres tenant d’une main leur autre main affreusement mutilée. Je ne vois plus que du sang partout et l’éclatement des bombes me rend fou ; pourtant je reprends mon sang-froid et comprends qu’il faut avancer pour remplacer ceux qui sont blessés. Je cours, d’autres me suivent, nous reformons un groupe compact. Par moments le boyau est tellement défoncé qu’il faut ramper sur le sol pour progresser. Où allons-nous ? Un sergent fait dire à l’arrière que l’on ne peut progresser au-delà du barrage ; l’ordre revient qu’il faut progresser coûte que coûte ; pourtant nous restons sur place ; sur toutes les faces on lit l’énervement et peut-être aussi l’appréhension ! Et puis voilà que le calme renaît
mais non, c’était un calme trompeur ; le claquement sec d’une mitrailleuse résonne prés de moi et ceux qui me précédent font demi-tour, et affolés, veulent fuir ; que faire ? Je ne sais ce qui se passe en avant, mais l’ordre n’est-il pas passé qu’il fallait progresser ; je veux résister, mais la poussée m’entraîne et je fais trente pas en arrière, puis me baisse pour attendre ; c’est alors seulement que je comprends pourquoi il fallait reculer. L’ennemi avait eu l’audace inouïe d’amener une mitrailleuse jusque devant le boyau et, après nous avoir laissés nous masser là, il avait ouvert un feu d’enfer devant lequel nul n’aurait pu tenir. Nous avons perdu une vingtaine de mètres ; à nouveau les blessés arrivent nombreux ; notre Section reçoit l’ordre de revenir en arrière, elle est remplacée par une autre ; je recule donc. Le calme, et l’ordre surtout, reviennent ; j’apprends que Vasnier, Costes, Basine, Bonnard, Vernes, Hugot, et beaucoup d’autres encore sont blessés, tous des camarades de la Section. On ne sait où jeter les yeux pour se tenir à temps hors d’atteinte des projectiles. Quel moment horrible venons-
nous de traverser ; j’en tremble encore d’énervement. Cette fois on transporte dans des toiles de tente des blessés qui n’ont pu
gagner le poste de secours de leurs propres forces ; il y en a que l’on emporte sur le dos et leur évacuation est difficile, car le boyau est étroit, et ceux qui restent ne doivent pas reculer. L’ordre arrive de faire un nouveau barrage, hors d’atteinte de la mitrailleuse et c’est aussitôt la chaîne pour le transport des sacs de terre qui serviront à la construction du barrage. Dès que nous commençons le barrage, les bombes pleuvent ; pourtant nous continuons sans avoir trop de pertes, et la tâche est menée à bien. À chaque instant l’ordre vient de demander les brancardiers et ceux-ci n’arrivent pas. Que leur veut- on ? Ne pouvons nous évacuer nos blessés nous-mêmes ? Entre le barrage allemand et le nôtre, il y a cinq des nôtres, paraît-il, tués par les bombes ou la mitrailleuse ; on ne peut les reprendre ! Dans une petite sape, on a déposé un homme de la Compagnie qui a les deux jambes coupées, c’est pour lui que l’on a demandé les brancardiers, mais ceux-ci ne peuvent arriver, et au poste de secours doivent arriver de nombreux blessés, car il n’y a pas que dans notre secteur que l’on combat, et les brancardiers doivent être appelés de partout.
14h00 — Notre Section ayant souffert des pertes trop importantes, elle se tient à quatre- vingts mètres en arrière du barrage et n’aura à intervenir qu’au cas où la section qui la précède viendrait à céder. Le calme n’est jamais complet, toujours quelques bombes, quelquefois le combat recommence, puis cesse pour reprendre ensuite. Sans cesse on se tient sur le qui-vive. Qui sait si les allemands n’ont pas l’intention d’attaquer le boyau qui reste entre nos mains ? S’ils parvenaient à gagner la gauche de ce boyau, nous serions tous tués ou faits prisonniers. Il y a toujours des blessés qui retournent, alors chaque fois on progresse d’un pas. À chaque instant il faut faire la chaîne pour faire parvenir des pétards et des bombes aux hommes qui défendent le nouveau barrage. A droite et à gauche, assez loin déjà, le canon gronde et la fusillade crépite, signe que tous les secteurs sont aujourd’hui en lutte ; c’est sans doute la préparation du 14 juillet. Le 75 tire quelquefois sans arrêt, et ses obus rasent le para-pet du boyau avec un sifflement qui vous fait courber l’échine.
15h00 — Nous attaquons les allemands sans sortir de la tranchée, mais à coups de pétards et de grenades ; si nous pouvions porter notre barrage plus loin ! Mais
chaque fois que l’on enlève un sac de terre pour tenter d’avancer, la mitrailleuse reprend son « tac, tac, tac » bref et tout est à recommencer.
15h30 — Les boches contre-attaquent. Nous lançons des pétards pour les empêcher de sortir de leur tranchée, notre fusil, baïonnette au canon et approvisionné à portée de notre main, au cas où l’ennemi parviendrait à avancer. Heureusement il n’en est rien et l’attaque cesse rapidement, mais nous avons encore quelques blessés.
16h00 — C’est seulement maintenant que l’on peut emmener le pauvre diable qui a les jambes coupées. Il n’a pas perdu connaissance, et plein de courage, il ne gémit même pas.
18h00 — Depuis hier soir les cuisiniers n’ont pu venir et nous n’avons pour ainsi dire rien mangé ; mais on a bien autre chose à faire que manger.
19h00 — Notre Section reprend la place en avant, c’est moi qui vais garder le barrage avec cinq hommes. Je fais venir un grand nombre de pétards afin da pouvoir riposter à une attaque ennemie éventuelle. On n’y est pas très à l’aise derrière ce barrage ; c’est un trou creusé par
une torpille aérienne et dans lequel donnait l’ancien boyau pris en enfilade par la mitrailleuse, ce
matin. C’est à l’entrée de ce boyau que s’élève le fameux barrage, haut de un mètre soixante environ, et au milieu duquel on a aménagé un créneau afin de pouvoir jeter de temps à autre un coup d’œil dans la direction de l’ennemi.
20h00 — Nous sommes installés là. En cas d’attaque, nous n’avons pas la meilleure place. je fais amorcer des pétards à l’avance afin de n’avoir plus qu’à les jeter en cas d’alerte. De temps en temps, nous en lançons un ou deux pour montrer à l’ennemi que l’on veille.
22h00 — L’ennemi se tient tranquille ; lorsqu’il lance une bombe, elle éclate à deux mètres devant le barrage et nous n’en ressentons pas les effets. Par contre, voilà la pluie qui tombe et l’endroit ne permet pas de s’abriter ; nous recouvrons bien vite les pétards afin qu’ils ne prennent pas l’humidité.
23h00 — Je suis trempé ; le soleil serait le bienvenu. Il faut être soldat pour ne pas attrapper de mal par un temps pareil ; enfin, nous logeons tous à la même enseigne.
Mercredi 14 juillet 1915
00h00 — La situation ne change pas, je voudrais être relevé afin de pouvoir me sécher un peu dans un coin, mais il n’y a personne pour me remplacer.
2h00 — Le jour est venu ; cette fois on vient me relever, mais je dois encore rester en arrière dans le boyau.
4h00 — Des hommes du ...ème d’infanterie arrivent ; nous pensons que nous allons être relevés, mais nous ne tardons pas à reconnaître notre erreur, ce sont seulement des pionniers. Chose bizarre, ceux-ci portent de petites échelles avec eux et les déposent le long du boyau. Tout d’abord je ne vois pas bien quelle peut être l’utilité de ces échelles dans la tranchée, surtout en aussi grand nombre ; mais je ne tarde pas à éclaircir le mystère : il s’agit d’une attaque à la baïonnette et les hommes grimperont sur le parapet au moyen des échelles. Les pionniers installent les échelles à leurs places respectives, puis se retirent, nous assurant que c’est une compagnie de chez eux qui ira à l’attaque.
5h00 — De fait, une compagnie du ...ème arrive et se masse dans le boyau où nous autres étions déjà trop serrés ; un lieutenant répartit les hommes par échelles, et au signal donné, tous bondiront sur la tranchée et s’élanceront sur les lignes allemandes en lançant des bombes à main puis en chargeant à la baïonnette. Pendant que tout ceci aura lieu, nous autres du 94ème resterons dans le boyau, paraît-il ; ceci me semble bien louche ; il est vrai qu’avec les pertes subies hier, il ne faut pas compter sur une attaque de notre part, mais seulement sur un peu d’aide.
6h00 — Aucun signal d’attaque n’a encore été donné. L’encombrement dans les tranchées est très grand, à cause des troupes en surnombre. Il me semble que cette
attaque aurait dû être menée plus promptement ; au lieu de cela, les hommes attendent et les allemands, qui semblent se douter de quelque coup de notre part, deviennent plus énervés et tiraillent sans cesse ; n’aurait-il pas été préférable de les surprendre ? Mais je n’ai pas voix au chapitre.
7h00 — Toujours rien. Par exemple on a augmenté le nombre des pétards et des bombes en vue de l’attaque et en prévision d’une contre-attaque de l’ennemi. L’artillerie française commence à taper sérieusement sur les premières lignes allemandes, c’est le prologue connu de l’attaque ; maintenant les boches sont certains que nous allons les attaquer, ils n’ont plus qu’à se tenir prêts derrière leurs créneaux. Pourquoi les prévenir ainsi ?
7h30 — L’artillerie cesse brusquement ; immédiatement les hommes du ...éme sautent sur les échelles, s’élancent sur la tranchée en lançant bombes et pétards en quantité. Nous qui sommes restés en bas en faisons autant. La mitrailleuse allemande commence à cracher par saccades ; les hommes du ...ème restent blottis derrière des taillis, beaucoup ne peuvent plus gravir l’échelle, à cause de la mitraille qui fauche tout. Un petit sous-lieutenant grimpé sur le parapet, revolver au poing, ordonne à ses hommes de monter : il tombe, frappé d’une balle au ventre ; on le
tire dans la tranchée puis on l’emporte. Ceux qui sont montés sur le parapet et ceux qui sont restés en bas lancent les bombes avec fureur, les allemands nous répondent non moins furieusement, et leurs engins éclatent soit devant nos lignes, soit dedans, et alors les blessés sont nombreux et recommencent à faire queue dans le boyau. A genoux à l’entrée d’un boyau formant poste d’écoute, j’amorce des pétards que je passe ensuite aux hommes pour les lancer. Les détonations se succèdent sans interruption et forment avec le sifflement des obus et le claquement des mitrailleuses un bruit assourdissant qui par instants vous fait entrer la tête dans les épaules. Beaucoup de blessés à la tête. Les hommes du ...ème n’ayant pu progresser, redescendent dans la tranchée ; leur caporal fourrier a été tué à cinq mètres des allemands, alors qu’il s’était aventuré jusque là. Pas un seul instant l’attaque ne semble vouloir se calmer ; les pétards détonent sans discontinuer et notre canon continue à démanteler les positions ennemies. Il faudrait pourtant reprendre la tranchée que l’ennemi a occupé en brûlant les occupants, mais de tous côtés ses mitrailleuses fauchent les assaillants, et il faudra s’y reprendre à un moment plus propice. L’essentiel maintenant est de contenir l’ennemi, car ayant vu notre attaque faiblir, il va sans doute à son tour essayer d’avancer ; mais
non, il se contente de répondre à nos projectiles par les siens, et il nous fait de nombreuses victimes. À nouveau le sol du boyau est rouge de sang et les mutilés défilent, les uns en courant, les autres, trop grièvement atteints, en rampant. Nos mitrailleuses cette fois balayent le parapet ennemi et interdisent ainsi aux boches de sortir de leurs positions. Pourtant le tir des canons semble ralentir et les grosses bombes allemandes tombent moins dru. Par intermittence, le combat reprend, puis cesse à nouveau, mais devenant de moins en moins fort ; enfin les explosifs cessent complètement et les fusils seulement font entendre leur détonation sèche qui vous fend le tympan. Notre attaque a donc échoué, mais notre ardeur à faire pleuvoir sur l’ennemi nos projectiles de toutes sortes a dû causer à celui-ci des pertes supérieures aux nôtres. Le calme revenu, on met un peu d’ordre dans la tranchée et on espace beaucoup plus les hommes, puis on attend à nouveau qu’une attaque se déclenche, soit d’un ciité, soit de l’autre.
10h00 — Les cuisiniers ne viennent toujours pas, nous n’avons pour ainsi dire pas mangé depuis lundi soir. Le bombardement presque continuel de l’arrière par l’ennemi doit entraver notre ravitaillement.
12h00 — Il tombe toujours quelques grosses bombes allemandes qui de temps à autre blessent un homme, ou deux, ou pas
du tout.
12h30 — Situation inchangée ; des bombes, des pétards, qui éclatent un peu partout, mais pas de combat acharné dans notre secteur.
13h00 — Les cuisiniers viennent d’arriver avec un peu d’aliments qu’il nous faudra nous partager tant bien que mal ; ils n’ont pas pu faire mieux et il est très difficile de venir en première ligne, les allemands bombardant les boyaux de communication sans interruption. La fusillade n’est pas très forte, mais elle ne cesse guère ; on sent que des deux côtés on est énervé, et que l’on craint à chaque instant une attaque par surprise. Nous sommes là, debout dans le boyau, les yeux parcourant le dessus du parapet pour voir si l’ennemi n’approche pas. De distance en distance, montés sur les échelles, des guetteurs surveillent en avant et préviendraient en cas de danger ; leur tâche est dangeureuse : sont-ils repérés, ils sont certains de mourir d’une balte en pleine tête ; mais ils se dissimulent derrière ces branchages et les allemands ne peuvent les distinguer.
14h00 — D’un seul coup, avec la rapidité de l’éclair, une fusillade des plus vives éclate à notre gauche, puis les bombes y détonent, le canon tonne.
Instinctivement, nous saisissons nos fusils et des pétards, car enfin c’est peut-être un simulacre d’attaque à gauche pour nous surprendre de face. Je dirige mon fusil vers le parapet, la baïonnette est au bout. De fait, la fusillade rapproche, l’attaque gagne sur nous, les premières bombes éclatent prés de nos positions, puis enfin l’attaque a lieu chez nous. Il serait impossible de donner une idée de la fusillade et du bruit cause par l’explosion des obus et des bombes. Et puis nous n’avons pas ce créneaux et impossible de savoir si l’ennemi s’avance ; dresser la tête au-dessus du parapet serait s’exposer aux balles des mitrailleuses. Je suis là, énervé, les yeux rivés sur le haut du parapet, la main droite sur la détente du fusil, croyant voir arriver d’une seconde à l’autre le flot allemand ; il me semble qu’ils vont sortir de dessous les branchages, au mépris des pétards qui éclatent partout. Nos blessés défilent, je vois passer derrière moi mes meilleurs camarades ; pas même le temps de leur serrer la main ; une odeur intense de poudre nous grise et la poussière soulevée par les bombes nous aveugle ; nous sommes là comme des
véritables machines, nous attendant à un combat corps à corps. Pourtant le 75 siffle au-dessus de nos têtes, formant un tir de barrage qui doit arrêter net la marche de l’ennemi ; le sifflement des obus nous tend les nerfs, les balles viennent s’aplatir sur le parapet derrière ; des bombes éclatent dans les tranchées, on se demande comment on ne devient pas fou. Puis, là a gauche, où l’attaque s’est déclenchée, le calme revient ; l’ennemi a-t-il avancé ? ou nous ? qui sait ? Sur notre secteur la fusillade ralentit : des blesses circulent toujours, gagnant le poste de secours ; l’un d’eux meurt devant moi : son sang gicle par trois fois de ses reins et il s’abat ; quelle mort affreuse ! Enfin le calme se rétablit avec cette fusillade presque constante qui prouve un énervement réel dans les deux camps. Nous restons sur le qui-vive, des pétards à la main ; nos rangs qu’il y a un instant encore, étaient assez serrés, se sont maintenant éclaircis : il n’y a plus qu’un homme tous les trois pas ; si au lieu de nous masser au début comme on l’a fait, on nous avait donné cette formation, il est probable que nos pertes seraient
sensiblement moins élevées. Je circule dans le boyau, vais de l’un à l’autre, demande ce qui s’est passé ; les hommes le savent à peine, ils se sont avancés là pour remplacer ceux qui étaient tombés. Sur le parapet, plus rien, le sol est à nu, tous les petits branchages, les arbustes qui y seraient encore ont été fauchés par la mitraille. J’avance de quelques pas encore vers l’endroit où le combat a été le plus acharne ; sur le sol et le corps d’un malheureux que je ne reconnais pas ; il n’est pas mort, mais porte des blessures affreuses : le crâne est atteint, la
lèvre supérieure est enlevée, sa main droite est déchiquetée et il a encore la force de la soulever. On n’a personne pour l’enlever, les brancardiers ne sont pas là ; vite on le place dans une toile de tente et deux soldats l’emportent au poste de secours. Quand ils reviennent j’apprends avec stupeur que celui que l’on vient de transporter n’est autre que le camarade Ponsard : le sang qui lui coulait de partout l’avait rendu méconnaissable. Au poste de secours on le pansa rapidement, mais il mourut lorsqu’on le replaça sur le brancard, à ce que racontent les deux hommes qui l’ont emporté. C’était un fusilier marin reversé au 94 ; il avait
l’estime de tous ses camarades de la Section ; il ne craignait rien, tout en étant très prudent.
16h00 — C’est assez calme sur tout le secteur ; loin à gauche il doit cependant y avoir une attaque, c’est sans aucun doute à Bagatelle. Le Sergent m’appelle et m’envoie dire au Caporal Quintin de relever un sergent du ...ème, moi je devrai revenir en arrière, pour encadrer la Section dans le boyau ; je vais trouver Quintin qui se prépare à se rendre à son poste, je lui apprends la mort de Ponsard ; lui, Quintin, vient de descendre du parapet comme guetteur, c’est miracle qu’il n’ait pas été touché. Je le quitte, fais dix pas à peine, puis, sans savoir pourquoi, je me retourne : je ne puis décrire alors ce que je ressens, je vois mon pauvre Quintin s’abattre, une balle en plein front ; de ma vie je n’oublierai cette vision ; je me rapproche de lui, il est étendu là, sur le dos, les yeux fixant quelque chose qu’ils ne voient plus. Il est mort, déjà, la balle lui a traversé la tête et son casque est brisé ; par sa bouche s’échappe un mince filet de sang. Je deviens comme fou et cours vers le Sergent pour le prévenir ; il me dit de prendre le poste de Quintin ; j’y cours et pour cela suis obligé d’enjamber le corps de mon pauvre camarade.
Arrivé à l’endroit désigné, je m’étends à terre, car lever la tête à un mètre du sol serait la mort certaine, le boyau étant défoncé. Là, je parviens à retrouver mon sang- froid. Je jette un regard sur le corps de Quintin et je puis à peine croire à la triste réalité : c’était mon meilleur camarade à la Compagnie ; dés le premier jour de mon arrivée au front nous étions devenus amis et depuis nous nous quittions rarement : sur la paille des cantonnements, sur la terre humide des tranchées, nous couchions côte à côte ; sur les routes qui mènent de l’arrière au front nous marchions l’un prés de l’autre ; de tout ce que nous possédions, nous faisions part à deux, l’un se serait privé pour l’autre. Jamais aucune discussion ne s’était élevée entre nous. Et maintenant le voilà étendu prés de moi, je n’ai même pas pu le secourir. Mais lui est vraiment mort en soldat, alors qu’il regardait au-dessus du parapet si les allemands ne venaient pas nous surprendre en rampant ; il était non seulement un brave, mais un héros, il avait déjà la Croix de Guerre pour avoir sorti d’un poste d’écoute un soldat qui avait la jambe sectionnée, et être revenu ensuite reprendre le combat pour parvenir à construire entre nous et
l’ennemi un barrage de sacs. Il était sans exagérer le meilleur caporal de la Compagnie, toujours calme et franc ; c’était à lui que revenait d’office la prochaine nomination de sergent. Il va aller retrouver maintenant tous ceux tombés hier et aujourd’hui et son nom passera à la Compagnie comme celui des autres, mais dans le cœur de ses nombreux amis, il y aura toujours un souvenir.
18h00 — J’établis la liaison entre notre 1ère et notre 3ème Section. Je voudrais faire enlever le corps de Quintin, mais une attaque semble vouloir commencer et il serait imprudent de s’aventurer dans le boyau.
18h10 — Deux fortes détonations à notre droite et une immense fumée noire s’élève ; qu’est- ce encore ? Un vif combat s’engage à droite, on entend le crépitement des mitrailleuses, mais sur notre côté on se contente d’échanger quelques pétards. On apprend aussitôt que nous
venons de briller les boches dans leurs trous et la fumée noire était causée par l’inflammation du pétrole. Notre ter Bataillon a repris deux lignes et nous fortifie ainsi sur la droite. Le calme revient. Je fais transporter Quintin par deux hommes, il y a sous sa
tète une mare de sang épais.
18h45 — Le calme dure et ma Section va prendre quelques heures de repos dans un gourbi à quelques pas en arrière, toujours prête à intervenir en cas d’attaque. Je m’étends et suis à moitié endormi, quand j’entends vaguement que l’on vient chercher le brancard pour un sergent ; on se renseigne : c’est le Sergent Delaforge qui lui aussi vient de tomber d’une balle en pleine tête ; du coup je suis éveillé. Comment, après Quintin, Delaforge, le petit sergent avec qui j’avais tait le voyage de Vitré à Sainte-Menehould et que sa femme avait accompagné à la gare en lui disant : « Reviens avec deux jambes en moins si tu veux, mais au moins, reviens ! ». C’est à se demander comment on ne perd pas la tête dans de tels instants ; sortirons-nous jamais vivants de cette guerre ? Notre tour de mourir n’est-il pas proche ?
20h00 — J’apprends la mort de l’Adjudant Anciaux, un rémois aussi, une balle en plein cœur. C’est épouvantable, ces deux journées des 13 et 14 juillet 1915 resteront dans l’histoire des combats de Marie-Thérèse comme deux des plus ensanglantées. Et pourtant, quel résultat avons-nous obtenu ? Aucun, et c’est le plus terrible à constater ; quelle inutile tuerie, et
elle dure depuis dix mois.
22h00 — Brisé par la fatigue et les émotions, je m’endors enfin.
Jeudi 15 juillet 1915
2h00 — C’est le tour de la Section de prendre la veille et le mien à prendre le barrage. Lentement, nous relevons nos camarades qui vont se reposer ; je gagne le barrage, à dix ou quinze mètres des boches : là, le silence doit être le plus complet si l’on ne veut pas s’attirer une pluie de bombes et de grenades. Il pleut un peu, les hommes qui m’entourent recouvrent les pétards avec des toiles de tente ; un caporal m’a fait passer une couverture pour me garantir de la pluie. Nous avons tous l’air de fantômes dans le jour qui vient. On se parle à l’oreille, puis on guette sans cesse si une tête de boche n’apparaît pas au-dessus du parapet.
4h00 — La pluie tombe très fort maintenant et le poste d’écoute formant cuvette, il y a déjà au milieu un beau lac dans lequel nos pieds reposent ; fait-on un pas, que l’on glisse ; et puis on ne peut se mouvoir que replié sur soi, tant le barrage est peu élevé.
5h00 — On nous fait parvenir du café. Par bonheur, tout est calme. Les allemands, dans leurs trous, doivent être aussi malheureux que nous sous la pluie et ne songent pas à nous attaquer. Ma
couverture est trempée et me mouille autant que la pluie.
6h00 — La pluie tombe moins fort ; je tords mes manches qui sont trempées, mes bras et mes cuisses sont tout frais ; par bonheur, j’ai pu me garantir le dos avec un sac à terre vide et sec. Mais, mes hommes et moi, nous sommes des blocs de boue, jusqu’à mi-cuisse on ne distingue plus s’il y a un pantalon, des jambières et des chaussures, tout est de la même couleur jaune ; les bras qui sans cesse frottent les parois sont tout pareils ; quant à la capote, nous nous asseyons dessus, et elle est encore plus sale que tout le reste.
7h00 — Je me suis mis au créneau et j’observe le secteur ennemi : les boches ont travaillé pendant la nuit, leur barrage est renforcé par des pieux, et derrière ils creusent une nouvelle tranchée, car on voit la terre, lancée par les pelles, retomber sur le parapet. Je suis comme cloué au créneau, je voudrais savoir ce qui se passe dans la tranchée en face. On vient m’avertir que cinq boches viennent d’être aperçus portant de gros rondins ; je cherche partout, mais par mon trou je ne puis découvrir qu’une largeur limitée et je n’aperçois rien des cinq hommes ; mais si, voilà un boche qui sort de sa tranchée et fait quelques enjambées ; j’épaule mon fusil, mais au moment de tirer, il disparaît dans un trou. Ah, cette fois, je puis
dire que j’ai vu un boche. Il portait la tenue ordinaire, avec le petit calot, et n’avait pas d’équipement. J’en suis encore à mes réflexions qu’un autre sort et disparaît à son tour, mais je l’ai moins bien vu. Alors cette fois je tire un coup de fusil dans la direction où je les ai vus disparaître et je me dispose à tirer sur celui qui maintenant viendrait à se montrer ; mais j’en suis pour mes frais, la terre vole toujours, mais d’homme, point. Je quitte le créneau car on peut me guetter de l’autre côté.
8h00 — Il ne pleut pas, mais la boue est épaisse. Nous commençons à gratter le sol pour nettoyer d’abord, pour creuser ensuite, afin d’être un peu mieux à l’aise dans le poste d’écoute. On nous fait passer des sacs à terre vides que nous emplissons, puis posons sur le parapet pour le surélever ; le travail marche rapidement, car nos habits trempés nous collent sur le corps et nous cherchons à nous réchauffer. Patience, à 10h nous serons relevés. Tout est calme, mais si calme qu’on se demande s’il n’y a pas encore quelque embûche de préparée.
8h30 — Ancelle, celui qui avait vu les cinq boches ce matin vient d’être tué à l’instant, victime également
d’avoir laissé trop longtemps la tête au-dessus du parapet. La cervelle est éparpillée sur le sol. Lui aussi était un des meilleurs. Que va-t-il rester à la Section ? Pour le moment je suis le seul caporal qui reste et nous ne sommes plus que deux à l’escouade. Sur quatre sergents, il n’y en a plus qu’un.
10h00 — On me relève. Nous allons prendre huit heures de repos dans un gourbi, si aucune attaque ne se produit. Tous, au bout d’un instant nous dormons profondément tant la fatigue est grande.
12h00 — La soupe arrive ; on la mange et on dort à nouveau.
17h00 — J’ai dormi tout le temps entre les deux soupes. Rapidement nous mangeons celle du soir car le service reprend à 18h. Le calme est complet, décidément les allemands ne voulaient que nous faire passer un 14 juillet exécrable ; ils y ont réussi, mais je crois que sur notre droite, notre 1er Bataillon leur a servi un plat à sa façon.
18h00 — Nous reprenons la garde, mais cette fois non plus au barrage, mais un peu plus en arrière, à quinze mètres des boches toutefois. De temps à autre passent des sacs de terre, des sacs de pétards, demandés par ceux qui occupent le trou du barrage. Quelques
balles, quelques bombes, mais l’énervement a bien diminué. Quand la nuit arrive, j’ai des hommes qui peuvent à peine se tenir éveillés. Je dois faire des rondes fréquentes, moi-même je sens bien que je m’endormirais facilement.
22h00 — Tout est tranquille, quelques fusées éclairent le ciel ; il y en a de nouvelles qui sont de véritables pièces d’artifice.
Vendredi 16 juillet 1915
2h00 — Nous sommes relevés et allons nous reposer au gourbi du Commandement de la Compagnie. Je suis à peine étendu que je m’endors.
4h30 — « Lasalle ! » Je m’éveille en sursaut, que me veut-on déjà ? Tant bien que mal, le Sergent m’explique qu’avec quatre hommes, je dois occuper un élément de tranchée creusé hier dans la nuit par le Génie. Je m’y rends et m’y installe, non sans trouver que c’est exagéré de me faire reprendre la garde après avoir eu seulement deux heures de repos ; et puis, quelle tranchée, à quarante centimètres à peine au dessous de terre. J’y suis venu en rampant et reste couché à un endroit un peu plus profond, certainement les allemands nous ont vus circuler dans ce boyau.
6h00 — Je me demande à quoi peut bien
servir notre poste, il y a toute une ligne occupée par nous en avant. Sur le ventre, je fais une ronde, tous mes hommes dorment ; quoi d’étonnant à cela, ce n’est pas deux heures de repos qui leur suffisaient.
6h30 — Un caporal me relève, les hommes aussi sont remplacés. Je reviens au gourbi, mais puis à peine dormir, le va-et-vient est continuel, ce sont des ordres qui arrivent et partent sans cesse.
10h00 — L’heure étant venue, je me réinstalle au barrage et comme le calme continue, nous poursuivons les travaux commencés la veille ; bientôt on pourra se tenir debout derrière le barrage et ce sera un grand avantage. Il y a un boyau qui part à notre droite, allant dans une direction inconnue. Le Commandant de Compagnie qui vient de venir voudrait savoir où il conduit ; c’est facile d’y aller voir, mais revenir est une autre chose. Le Lieutenant vient d’envoyer deux caporaux dans ce boyau, ils devront se diriger sur la gauche qui est la direction boche, puis il me fait appeler et m’ordonne d’aller sur la droite avec un homme. La première mission est certes plus dangereuse que la mienne, mais cette dernière est de beaucoup plus longue et a aussi ses risques ; bref, il n’y a pas à tergiverser, je pars précédé d’un homme qui a son fusil en main et tout en allant je fais un
topo du boyau. J’espère bien ne pas faire de mauvaise rencontre avec un boche, car enfin ce n’est pas bien certain que ce boyau n’est pas occupé. Tout d’abord nous tombons dans un vaste trou de minenwerfer, mais un rapide coup d’œil me permet de voir que de tous côtés je suis caché aux vues indiscrètes par des parapets de terre. Je prends ensuite la direction fixée et suis le fameux boyau ; rien à y trouver ; depuis bien longtemps ce boyau n’a pas dû être occupé, car la terre est retombée et des arbres cassés entravent la circulation. Par moments nous devons ramper pour pouvoir progresser ; à droite, à gauche, nous trouvons des gourbis, tous en mauvais état, et je les inscris sur mon dessin. Après une demi-heure de cette marche dans l’inconnu, nous tombons dans une sorte de puits très bien creusé, ayant deux mètres cinquante de diamètre et autant de profondeur, et notre boyau s’arrête là ; où aller maintenant ? Devons nous revenir sur nos pas ? Un coup d’œil à ras de terre tout en me dissimulant et je vois à ma gauche un tas de terre fraîchement remuée, et ceci sur une grande longueur ; ceci me porte à croire qu’il y a là une nouvelle tranchée, et
tout me fait supposer que c’est celle dans laquelle le montais la garde ce matin avec quatre hommes. Par là, je rentre au poste du Commandant de Compagnie, mais il y a cinq mètres de terrain à découvert à franchir, et je ne doute pas que les boches tiennent l’endroit sous le feu de leurs fusils. Bref, ce serait dommage de ne pas mener la mission à bien ; l’homme qui me précède
toujours fait un bond, je le suis, et nous tombons... sur le dos de trois hommes du Génie qui terrassent et qui nous entendant remuer depuis un instant, croyaient voir arriver des boches. Je suis le boyau tout en en faisant le croquis, et arrive enfin à l’endroit d’où je suis parti. Je vais trouver le Lieutenant commandant la Compagnie et lui donne tous les renseignements qui pourraient lui servir et dresse un croquis au clair de l’itinéraire suivi avec quelques points de repère nécessaires. Le Lieutenant m’a tout l’air d’être satisfait du résultat qu’il va transmettre au Chef de Bataillon, et je regagne mon poste près du barrage où l’on commençait à s’inquiéter sur mon sort, ne me voyant pas rentrer. Les caporaux partis dans l’autre direction viennent également de rentrer ; quoique ayant poussé leur reconnaissance très loin, ils n’ont pu obtenir un résultat satisfaisant, ce qui n’est pas étonnant, vu la proximité de J’ennemi, et surtout le réseau de boyaux dans lesquels on s’y reconnait difficilement.
17h00 — Tout est calme, le temps est beau ; croirait-on qu’il y a deux jours il y avait une véritable boucherie en cet endroit si tranquille maintenant.
18h00 — Je suis relevé avec les hommes, et la Section va au repos dans un gourbi ; les hommes se plaignent de la soif et voudraient que l’on envoie une corvée à l’arrière pour ramener de l’eau. L’un d’eux va demander la permission au Lieutenant, qui l’accorde pour 20h.
Comme je suis le seul caporal qui reste, je serai obligé d’accompagner la corvée et cependant j’ai grand besoin de repos.
20h00 — Je dormais profondément quand on m’appelle ; les hommes de la corvée sont prêts, nous partons. La nuit tombe et on trébuche dans des hommes étendus dans la tranchée. Le chemin est long et se met bientôt à descendre, et puis la tranchée est creusée dans la pierre et tout est si bien disposé qu’on se croirait dans des excavations naturelles. Quand nous en sortons, nous sommes à flanc de coteau, sur un chemin fait de rondins, en pleine forêt ; les balles sifflent un peu partout, mais à intervalles espacés ; encore dix minutes de marche et nous atteignons Fontaine-aux-Charmes, où nous prenons l’eau qui coule par de petits tuyaux. Que l’eau paraît fraîche, lorsque comme nous depuis trois jours on n’a bu que quelques gouttes de vin lourd. Les bidons une fois pleins, nous prenons le chemin du retour ; cette fois la nuit est venue et la lune luit ; sa pâle clarté donne, avec les pierres des boyaux et les feuillages qui les recouvrent à certains endroits, un décor féérique. Nous rentrons bientôt, tous s’empressent autour de nous pour se rafraîchir. Je m’étends et m’endors, car à 2h il faut prendre la garde.
Samedi 17 juillet 1915
2h00 — Nous reprenons le service dans le poste d’écoute. La pluie ne tarde pas à tomber assez fort, on se couvre comme on peut tout en veillant
sur l’ennemi qui se tient tranquille.
4h00 — Mon sac que j’avais da déposer sur un parapet à notre arrivée ici, est maintenant disparu ; hier soir il y était encore. Beaucoup de camarades, pour ne pas dire la totalité, sont dans le même cas ; le ...ème qui est près de nous s’est emparé de nos sacs pendant que nous
gardions le barrage et les a vidés complètement ; par bonheur, j’avais eu soin d’en retirer mes provisions à l’avance, et je ne perds que quelques objets de lingerie. C’est égal, il faut un certain sans-gêne pour dérober ce que possèdent les camarades d’un autre régiment ; il paraît qu’à Ypres ça a déjà été la même chose. Je cherche un nouveau sac et en trouve un vieux sale ; comme il m’en faut absolument un, force m’est de prendre celui-ci ; je saurai maintenant que ce qu’on a de précieux doit rester sur soi, car le sac peut disparaitre d’un moment à l’autre.
8h00 — Les boches ne bougent pas, mais la pluie tombe. Il parait que nous allons être relevés dans la journée, ça ne serait pas dommage, car nous sommes fatigués ; de fait, des officiers du ..éme prennent les consignes.
10h00 — Nous sommes relevés, mais seulement pour aller au gourbi de repos, et puis c’est mon tour à monter la garde avec quatre hommes dans la tranchée en terrassement, et pour quatre heures. La soupe arrive bientôt, on n’est pas trop à l’aise pour la manger car la tranchée n’est pas profonde, et Fritz le boche peut nous apercevoir. Je trouve que la relève est longue à venir, heureusement il ne pleut plus.
12h00 — Je suis toujours aplati dans ma tranchée ; un vent violent souffle et fait tomber les branches des arbres déjà touchées par les balles ou les obus. C’est un vrai temps de novembre et je me demande si ce n’est pas déjà le commencement de la campagne d’hiver. J’ai de la boue jusqu’en haut.
13h00 — Voilà que les allemands bombardent et leurs obus éclatent à quelque cent mètres en arrière de nous, ça n’est pas le moment de lever la tète ; d’un autre côté, si on se couche, le sommeil vous prend car on tombe de fatigue.
14h00 — Enfin je vois arriver les camarades de la relève et je ne tarde pas à rentrer au gourbi en rasant le sol pour me dissimuler.
15h00 — J’ai dormi une demi-heure à peine, mais tous causent autour de moi et m’éveillent ; c’est qu’il est fortement question de la relève, et dame !, chacun se tient prêt à quitter ce secteur où nous avons laissé tant des nôtres ; le régiment qui tenait à notre gauche est relevé maintenant ; je crois même que deux sections de chez nous sont déjà parties. Nous mettons sac au dos, mais le signal du départ n’arrive pas.
15h30 — Nous sommes toujours là, et cependant la relève est faite : c’est incompréhensible que les autres sections aient reçu des ordres et que nous restions là.
16h30 — Enfin nous sommes dans un boyau, mais y stationnons un quart d’heure ; le Chef de Section ne sait où nous allons ; c’est inouï, vouloir nous conduire quelque part quand on n’a pas de but
fixé. Mais que rait donc la liaison ? Est-ce que l’homme de liaison de la Section ne devrait pas être en tête, car lui doit connaître le chemin, c’est son rôle ; mais non, il vadrouille quelque part : voilà des gaillards qui dorment la nuit et le jour ne prennent jamais la garde, et quand leur service serait nécessaire on ne les trouve plus. Nous avançons de deux cents mètres, puis stationnons à nouveau ; je suis dans le milieu de la file par un, et ne me rends pas compte de ce qui se passe aux extrémités. Bientôt passe l’ordre : « Demi-tour ! » et nous refaisons le même chemin en arrière, puis repartons dans une autre direction. Et cette
manœuvre recommence trois fois et nous amène finalement devant un boyau où il y a quarante centimètres d’eau boueuse et qu’il faut franchir. Je me demande si nous savons où nous allons exactement et à cet effet questionne le Chef de Section : « Au poste du Commandant », répond-il. « Au poste du Colonel », répond un sergent. Alors c’est l’un ou c’est l’autre, mais ils ne connaissent même pas le chemin ni de l’un ni de l’autre. Nous pataugeons dans un lac de boue, mes brodequins sont pleins d’eau et mes pieds sont frais par conséquent ; et dire que nous ne savons même pas où nous allons ; ceci m’exaspère qu’on se soit mis en route sans ordre précis. Tant bien que mal, à travers des boyaux inondés que nous aurions pu éviter, j’en suis certain, nous arrivons dans le boyau central dans lequel il n’y a plus cette fois de danger de s’égarer. Malheureusement des compagnies du ...ème viennent en relève du 94
et la marche redevient lente, nous nous montons sur les pieds réciproquement et le boyau est si étroit qu’il faut se mettre de côté pour passer. Enfin le bout du boyau arrive et il paraît que c’est le poste du Colonel ; je n’ose y croire et je me demande en sème temps comment il se peut que nous ayons trouvé le chemin. Mais ce n’est pas tout, nous ne sommes pas bien certains que c’est ici que nous devions nous rendre ; nous en sommes même si peu certains qu’un homme est dépêché sur le champ au poste de commandement pour y demander des ordres. Pendant ce temps, nous faisons la sieste et grattons à l’aide de nos couteaux la boue jaune qui nous couvre jusqu’à la ceinture ; je nage dans mes chaussures, mais je suis bien sûr de ne pas attraper de fluxion de poitrine.
18h00 — L’homme parti en mission ne rentre pas. Les boches bombardent activement, nous nous réfugions derrière un abri à munitions : est-il une plus mauvaise place pour se garer des obus ? L’un d’eux viendrait à éclater sur le gourbi, nous sauterions avec les pétards, les bombes, les cartouches, qui sont amassés là. Nous sommes de modernes Gribouille qui nous abritons des éclats d’obus au milieu des explosifs. Il est un fait curieux à remarquer, c’est que derrière le plus frêle des abris, on se sent plus en sûreté et on s’y réfugie en cas de danger.
18h30 — Les ordres arrivent. Nous devons nous rendre à La Harazée où la soupe sera mangée ; il faudra se tenir prêts à instant, car il est probable que nous partons au repos
ce soir même. Cela nous remet du baume dans le cœur et c’est d’un pas allègre que nous franchissons à travers bois la courte distance qui nous sépare de La Harazée. Deux compagnies du Bataillon sont déjà réunies là et mangent la soupe ; on n’a pas de nouveaux ordres, mais vues les pertes subies, il n’est pas douteux que le Régiment entier aille au repos pour être reformé.
20h00 — À 9h nous partirons pour Florent. Itinéraire inconnu. Le bruit court avec persistance qu’après Florent nous irons beaucoup plus loin, je n’ose y croire. J’ai toujours les pieds gelés et je voudrais que l’on parte maintenant pour me les réchauffer un peu.
21h00 — « Sac au dos ! » Nous partons dans la direction du Four de Paris ; tout le long de la route, des ravitaillements circulent, ainsi que des compagnies de relève dont on ne peut lire les numéros. Dans la direction du front c’est calme, mais des fusées ne cessent de sillonner la nue. Nous dépassons le Four de Paris au pas de course, car sur une longue distance, la route se trouve sous le feu des canons boches et si Fritz se doutait de notre présence, il nous saluerait à sa façon. Nous faisons la pause après que le Bataillon tout entier est sorti de la zone dangereuse. D’une route adjacente arrivent deux compagnies du 1er Bataillon du 94 ; lui aussi est donc relevé, et c’est ce qui semble confirmer que tout le Régiment va prendre du repos.
Nous atteignons La Chalade, on n’y voit goutte. À chaque instant des convois d’artillerie nous
croisent ou nous dépassent ; par bonheur, il a plu et la poussière reste au sol. Le Claon, pas une lumière, on aperçoit toutefois encore les fusées du front qui éclairent le ciel, mais lorsqu’elles s’éteignent la nuit semble plus noire encore. En quittant Le Claon la route monte, monte, monte vers Florent, et on se dispute pour savoir s’il y a deux ou cinq kilomètres. J’ai toujours remarqué pendant les marches, que lorsqu’il y a une discussion sur les distances, c’est que l’on commence à être très fatigué, et nous le sommes et ça monte toujours, et on marche vite, et on est en sueur. Enfin on atteint les premières maisons de Florent et là on fait halte. On fait halte, pourquoi je me demande ? Nous sommes en sueur, ne serait-il pas préférable qu’on nous conduise immédiatement dans nos cantonnements ; mais au fait, j’y pense, s’est-on occupé de ces cantonnements à l’avance ? Oui, mais pas suffisamment tôt et maintenant nous nous refroidissons à l’entrée de Florent. Pour la seconde fois aujourd’hui j’ai à déplorer le manque d’organisation : une fois nous avons pris des boyaux où l’on avait de l’eau jusqu’aux cuisses, et maintenant nous sommes là à grelotter, parce que l’on ne sait pas et nous loger. Et les officiers font les mêmes réflexions. Mais si quelqu’un se doutait que les cantonnements n’étaient pas prêts, pourquoi ne pas nous avoir fait monter la côte à allure modérée, plutôt que de courir comme nous l’avons fait,
pour attendre ensuite ? Enfin, après une demi-heure nous avançons et cette fois on nous conduit dans une grange assez vaste où il y a une épaisse couche de paille ; là, il y a de l’ordre, c’est nettoyé, la paille est en abondance ; le troupier n’en demande pas plus pour être content : une litière propre et épaisse, il ne regarde ni aux trous percés dans le mur, ni aux toiles d’araignées qui pendent du plafond.
23h00 — À deux nous mangeons une boîte de sardines avant de nous endormir. Demain, à 5h du matin, nous partirons pour une destination inconnue : c’est presque officiel. Et puis il est question d’aller en autobus et non toujours à pied, comme à l’habitude. Je dirais qu’on s’endort très heureux.
Dimanche 18 juillet 1915
6h00 — L’autobus de 5h n’arrive pas vite : c’était un rêve probablement. Le café est exécrable, le pain dur ; c’est tout qui s’enchaine. Il parait que c’est l’autobus de 10h que nous prendrons.
7h00 — Je gratte et brosse mon pantalon, mes jambières, mais la boue n’est pas encore sèche. Je fais une tournée dans le village et fais quelques achats.
9h30 — On ne donne pas vite l’ordre de se tenir prêts, je crains bien que l’autobus de 10h soit décommandé.
10h00 — Ordre est venu de se tenir prêts pour 16h. De rage, je sors sans brosser ma capote ; j’arrive sur la place juste pour voir une compagnie du 155ème défiler avec le Drapeau du Régiment que tous nous saluons. La musique joue la « Marche du 155ème » et ceci me fait souvenir qu’il y a cinq jours on nous
jouait aussi de la musique, sur cette même place, avant de nous envoyer à la tuerie. Brave 155ème, je te souhaite d’être plus heureux que nous, à Marie-Thérèse ou ailleurs.
11h00 — Je cherche un camarade du 1er Bataillon que je ne trouve pas et rencontre un maréchal-des-logis de Chasseurs d’Afrique qui me questionne sur mon casque (il faut dire que force m’est de porter celui-ci, mon képi étant disparu avec mon sac à Marie-Thérèse). Il trouve
qu’il n’est pas trop lourd et doit garantir contre les éclats d’obus : c’est juste, mais il ne faut pas que ceux-ci soient trop gros ; quant aux balles, elles traversent comme dans du beurre, à preuve : Quintin.
12h00 — En rentrant au cantonnement j’apprends par un ordonnance qui me le glisse mystérieusement à l’oreille que nous partirons certainement ce soir à 16h. C’est un « tuyau » dit-il. Espérons que c’est un tuyau « qui ne crève pas » comme on dit en langage militaire. Bref, je réfléchis qu’on m’a raconté que les morts du front étaient ramenés actuellement au cimetière de Florent, pour être inhumés dans les fosses dans le genre de celle que nous avions creusée lors du dernier repos. Peut-être pourrais-je voir la tombe du pauvre Quintin et celles des autres ? Je me rends au cimetière en compagnie d’un autre camarade. Ce qui saute à la vue immédiatement, c’est le nombre des officiers tombés les 13 et 14 juillet ; je reste ahuri de lire les noms de Migeon, Ulrich et d’autres, tous des chefs de mérite que leurs hommes adoraient et auraient suivis partout ; eux, pas plus que nous, ne sont exempts de l’impôt du sang, en voilà bien la preuve.
Je cherche, je cherche, mais ne trouve pas les camarades de la Compagnie. Mais les fosses sont pleines au fond du cimetière ; c’est là sans doute que, côte à cite, ils reposent ; pas un nom, pas une fleur : peut-être que plus tard une petite croix rappellera vaguement l’endroit où dorment Quintin, Delaforge, Anciaux..., mais jamais leur famille ne pourra les faire exhumer et c’est triste de penser que beaucoup, trop pauvres, ne pourront même pas venir prier sur la tombe du cher disparu. Et dire que l’Argonne est un vaste cimetière !
14h00 — Je fais un tour dans le village, puis entre à l’église où l’on célèbre les vêpres. Beaucoup de militaires y assistent.
16h00 — Nous mangeons la soupe et devons nous tenir prêts pour 17h30. C’est à Vieil- Dampierre que nous allons, parait-il.
17h30 — « En tenue, sac au dos, tout le monde dehors ! » Cette fois je crois que nous partons. On se rassemble rapidement et on masse deux bataillons sur la place, ainsi que les mitrailleuses et la musique du Régiment (le 2ème Bataillon n’est pas là, déjà parti ou encore en ligne). Bientôt le 1er Bataillon défile, se rendant à l’emplacement où les automobiles attendent ; lorsque les quatre compagnies sont passées, par groupes de seize hommes (ce que l’on peut transporter dans chaque voiture), je pense que nous allons suivre, mais non, nous restons là. Mieux, je surprends une conversation à voix basse entre officiers, ce n’est qu’a 20h que nous devons partir, ceci ne m’étonne nullement ; ils nous ont fait poireauter toute la journée, autant nous faire poireauter jusqu’au bout.
18h15 — Contre-ordre sans doute, car nous partons, par groupes
de seize nous aussi. À la sortie du village, le long de la route de Moiremont, stationne une longue file de camions automobiles ; cette fois c’est sérieux, l’autobus est là, il n’y a plus qu’a monter ; le sac ne pèse plus rien, on court et on grimpe à seize dans une voiture ; c’est beaucoup, mais en s’installant bien, on y est à l’aise. Mon petit grade me permet de me tenir à l’arrière d’où l’on voit le paysage. Le contentement est grand, on le lit sur toutes les faces et n’y a-t-il pas lieu de se réjouir d’un grand repos après la semaine affreuse que nous venons de vivre. Mais la voiture trépide et nous partons enfin au milieu des hourras et des chants. Ne serait la pensée que beaucoup de camarades restent à Florent à jamais, la joie serait parfaite. La longue file d’autos
avance rapidement, nous passons sous la « saucisse » (le ballon d’observation), prise aux allemands pendant la Marne et dépassons Moiremont. Ce n’est pas sans un certain plaisir que nous voyons au loin, vers le nord, les Bois de la Gruerie disparaître peu à peu. Les soldats qui se trouvent sur notre chemin nous demandent où nous allons. Ils semblent envier notre sort, mais leur tour viendra.
20h30 — Nous traversons Sainte-Menehould et aussitôt c’est un paysage de paix qui s’ouvre à nos yeux ; au lieu d’un dédale de boyaux et de tranchées, à perte de vue c’est la plaine, avec ses champs de blé et d’avoine, avec ses javelles et ses douzaines alignées, quelle différence avec la vie des jours précédents. Et puis les civils sont nombreux, des femmes surtout
et puis des vieillards et des petits enfants.
21h00 — La nuit est venue ; on fait une pause pour allumer les phares et l’on repart plus loin. C’est maintenant sur la route une interminable file de lumières qui avancent. Daucourt, Vieil- Dampierre ; on arrête, mais nous ne devons pas descendre ; le 1er Bataillon seul met pied à terre, c’est là qu’il va cantonner, aussi nous ne pourrons pas aller beaucoup plus loin. Bournonville, c’est notre tour de descendre, chacun étire ses membres engourdis, puis notre 1ére Section est emmenée dans une grange et un brave paysan nous accompagnant avec une de ces lanternes de ferme, nous montre que notre couche est un haut tas de foin, sur lequel on monte par une échelle. Trois sauts et l’on est en haut avec tout son fourniment, on s’installe, on mange un peu, et puis on s’endort vite dans le foin.
Lundi 19 Juillet 1915
6h00 — On s’éveille pour prendre le café, la tête lourde, car le foin entête, mais ça n’est rien, le soleil est radieux et l’air frais, et on se remet vite. Rapidement un petit tour pour reconnaître les lieux, puis je commence le nettoyage de ma capote.
8h00 — Un brave homme nous a prêté un seau, nous nous lavons du haut en bas, changeons de linge, puis nettoyons le sale.
10h00 — En rentrant au cantonnement, j’apprends qu’a 15h nous aurons une revue d’effets et d’armes. Allons, c’était
écrit que nous ne serions pas tranquilles toute la journée. Les fusils sont très sales et rouillés après les journées de pluie que nous avons traversées ; heureusement que l’on ne nous demande pas qu’ils luisent, mais seulement qu’ils fonctionnent.
12h00 — La soupe mangée, tous sont installes à terre, les pièces du fusil démonté entre les jambes, en train de frotter à qui mieux mieux. Puis c’est le tour des effets.
15h00 — Rassemblement en tenue quelconque. Le Sergent passe la revue des armes avant l’arrivée du Lieutenant commandant la Compagnie. Ce dernier arrive bientôt et à son tour voit quelques fusils ; puis il nous prie de nous tenir correctement pendant toute la durée du repos et surtout de ne pas abuser de la boisson. Il va s’entendre avec le Sergent-major, dit-il, pour employer une partie du boni à l’amélioration de l’ordinaire.
16h00 — Je viens d’apprendre à faire les liens chez le cultivateur chez qui nous cantonnons et nous sommes à une dizaine de soldats après ce travail qui marche rapidement. Je les fais très
bien, paraît-il, il ne m’a fallu qu’un instant pour m’initier à cette nouvelle tâche qui m’intéresse et m’amuse en même temps.
18h00 — La soupe nous oblige à quitter notre occupation. Nous nous raisons préparer à deux une bonne salade chez ce même cultivateur.
20h00 — Etendu sur l’herbe, sous un gros poirier, je réfléchis qu’on est heureux ici et que c’est affreux de penser qu’on s’entre-tue tout près de là.
21h00 — Je me prépare à rentrer. On avait l’intention de
faire un petit concert avant de se coucher, mais la plupart des acteurs sont ivres : c’est insensé, par rapport à ces gens là on nous fera peut-être faire l’exercice toute la journée, demain et les jours suivants. Pourquoi ne pas profiter du repos pour bien manger et bien boire, mais sans excès cependant.
21h30 — Je m’endors malgré les discussions idiotes des ivrognes que j’entends autour de moi.
Mardi 20 juillet 1915
6h00 — Le jus arrive : on peut le qualifier de « jus ». Il n’y a rien de prévu à l’emploi du temps ; c’est pourquoi, aussitôt nettoyé, je vais m’étendre sous un arbre pour écrire.
8h00 — Combien je me sens heureux, au milieu des champs et des jardins, par cet air frais qui vivifie et ce soleil qui réchauffe. On entend un peu le canon, mais je n’y pense pas ; je n’écoute que le chant des oiseaux, il me semble que je suis transporté à deux cents kilomètres du front. Sur la route, passent sans cesse des moissonneurs, aidés de soldats ; ceci me rappelle l’ancien temps et la guerre ne m’en paraît que plus abominable. Alors que partout les bras manquent, je ne puis me figurer que tout prés on tue des hommes inutilement. On est même honteux de songer à cela : avons-nous été placés sur la terre pour nous entre-tuer, ou pour la faire produire ? Chez nous tous, on retrouve les mêmes pensées, c’est partout ce même désir de paix qui se fait sentir
et pourtant la haine contre les allemands est des plus vives.
10h00 — Un homme arrive. Il me cherche depuis un quart d’heure, il paraît qu’il y a prise d’armes à 9h, avec remise de décorations. D’abord je me moque de lui, car s’il faut être à la revue pour 9h, il est grand temps qu’il s’y prenne. Mais il n’est pas bien certain de l’heure et je rentre pour me renseigner. Les autres se préparent, mais des ordres précis ne sont pas encore parvenus. En toute Fine, je change mes chaussures de repos contre celles de fatigue, les graisse puis m’équipe : il n’y a rien que je déteste plus étant au repos que ces alertes, quand on pourrait nous prévenir un jour à l’avance. Je crois que s’il faut habituer quelqu’un aux alertes, ce n’est plus tout à fait nous surtout depuis ces derniers jours.
11h00 — On entend la « Marseillaise », la « Marche du 94 ». Que diable, la revue est en route, et s’il n’y a pas d’ordres nous concernant à cette heure-ci, c’est que nous n’y assistons pas.
11h15 — Un homme qui rentre et qui vient de la place dit qu’il s’agissait seulement d’une remise de Médaille Militaire à un mitrailleur. Là, tout s’explique, mais c’est égal, nous sommes tenus au courant de ce qui
se passe, à merveille.
12h00 — Avec Seulfond nous mangeons une omelette aux pommes de terre monstre, suivie d’une salade et d’un morceau de tarte, toujours dans la même maison.
14h00 — Etendus sous les arbres, nous dormons une heure et ensuite allons faire un tour dans les champs. Il fait très beau et même très chaud.
18h00 — L’après-midi s’est passé sans incident.
Mercredi 21 juillet 1915
6h00 — Le jus n’est pas excellent, décidément les cuisiniers n’auront pas de compliments.
7h00 — Des vêtements et différents objets de fourniment sont arrives au bureau de la Compagnie pour être distribués aux hommes qui en ont le plus besoin. Les sergents sont servis les premiers, ils sont habillés à neuf ; ensuite les cuisiniers arrivent ; là, comme c’était à craindre, des plaintes s’élèvent aussi bien parmi les caporaux que parmi les hommes ; en effet, les combattants ne méritent-ils pas plus de toucher des habits neufs que les cuisiniers qui restent constamment à l’arrière ? C’est une injustice flagrante. Mon tour de passer arrive, mes besoins sont restreints : des molletières, des chaussettes, une chemise, un caleçon, un képi ; je suis bientôt servi et laisse la place aux autres. Lorsque les hommes passent, il ne reste plus pour les satisfaire entièrement ; c’est regrettable que les compagnies ne touchent pas
d’équipements en nombre suffisant pour rééquiper tous leurs effectifs.
9h00 — Nous achetons une boite de pois en conserve et la faisons préparer pour midi.
10h00 — Chacun a enfilé les vêtements que, tant bien que mal, il a pu toucher, et je puis remarquer que tous les complets neufs sont en velours bien peu solide, c’est encore une nouvelle tenue. On ne peut se figurer le nombre de tenues différentes que l’on rencontre dans une compagnie, je ne sais pas s’il y a deux hommes qui portent la même. Quel est le but poursuivi par les gouvernants, en créant ainsi une armée bigarrée ? Ne serait-il pas préférable d’avoir une tenue uniforme ? J’ai vu bien des prisonniers allemands au camp, tous avaient la même tenue réséda ; mais ici, il y a du bleu clair, du bleu ciel, du vert sombre, du gris, du bleu foncé, du rouge, du kaki, autant dire une armée de polichinelles. Il doit y avoir quelque chose qui cloche là-dessous ; encore le manque d’ordre et de réflexion. Dans le même ordre d’idées, je parlerai du casque, ou de la « casserole » comme on dit ici. Sur le front, tout marche par divisions, nous sommes de la « 42e volante » ; on a distribué ces casques au 94, mais les autres régiments de la Division ont conservé leurs képis ; pourquoi ne pas
attendre que l’on ait assez de casques pour en distribuer à toute la Division. On dirait qu’on se dépêche de fabriquer cinquante casques pour les envoyer au front. J’ose espérer que ceci n’existe que parce que les casques n’en sont qu’à leurs essais.
12h00 — Les pois sont excellents, surtout arrosés de bon vin clairet.
14h00 — Etendu sur l’herbe, j’attends que la chaleur ronce taire un tour dans les champs.
16h00 — Tout en me promenant, je vais jusqu’au « château », un pavillon de peu d’importance que l’on appelle château ici, situé à cinq cents mètres du village. C’est là qu’habitent les
officiers du Bataillon. Tout prés, je retrouve le cultivateur dans un champ, à faucher et lier le blé, avec des hommes de ma Section ; je me mets en route à leur donner un coup de main pour m’amuser.
19h30 — Nous mangeons toujours au même endroit ; après le repas, chacun pousse sa petite romance et ceci menace de s’éterniser, lorsque l’on vient me chercher pour faire l’appel. L’appel ? Il n’en avait jamais été question jusqu’à ce jour. Mais pourquoi s’étonner ? Il faut s’attendre à tout au régiment : il se produit chaque jour des changements sans qu’on en soit averti au préalable. Je me rends au cantonnement, fais un appel sommaire, renseigne le
Sergent, puis m’assieds sur un banc en attendant que la nuit soit complète avant de me coucher.
Jeudi 22 juillet 1915
6h00 — Le café pris, je me mets en mesure de changer de linge lorqu’arrive Marcel Trousset qui m’invite à déjeuner à Vieil-Dampierre. C’est une promenade de deux kilomètres avec un bon repas au bout, ça ne se refuse jamais ; mais il me faut une permission en règle pour quitter Bournonville. Ce n’est pas à cette heure-ci que je puis trouver un officier, mais j’ai grandement le temps, je ne pense pas partir avant 9h30.
7h00 — Le Commandant de Compagnie par intérim passant justement près du cantonnement, je lui demande ma permission. Il ne demande pas mieux que de me l’accorder, mais veut voir le Chef de Bataillon auparavant ; dans ce but, je l’accompagne au « château », et après avoir attendu un bon quart d’heure devant la porte, ma permission m’est enfin remise.
8h00 — J’apprends qu’il va y avoir dans les champs un service religieux pour un lieutenant de mitrailleurs tué durant les dernières opérations. En vue d’y assister, je me rends vers l’endroit indiqué : de nombreux militaires, mitrailleurs pour la plupart, sont assemblés là, devant un autel construit provisoirement entre un pommier et un poirier. Des soldats ont préparé cet autel et l’ont garni de feuillages et de drapeaux, le chœur est encadré de faisceaux de fusils et
de baïonnettes. Un aumônier dit la messe, deux soldats chantent, un fourrier est servant. De nombreux officiers, tous ceux du Bataillon pour ainsi dire, le Colonel du 94 également, sont présents. Après la messe, l’aumônier rappelle en quelques paroles émouvantes la vie du Sous- Lieutenant Douot. Ce service dans un décor aussi simple est bien aussi touchant que la plus belle des messes avec accompagnement d’orgues dans la plus belle des cathédrales.
9h30 — Ma permission en poche, je prends le chemin de Vieil-Dampierre. La chaleur est insupportable déjà, et deux arbres seulement le long de la route en fait d’ombre.
10h00 — Vieil-Dampierre. Je passe à la station occupée par des territoriaux où nul ne m’arrête. Je cherche la 8ème Compagnie que je trouve bientôt. Avant le déjeuner nous allons faire un tour dans le village. Il est adossé à un coteau ; les maisons très espacées sont entourées d’immenses vergers. Tout en haut de la colline s’élève l’église, une toute petite église au clocher d’ardoise. De là on découvre la plaine en bas, où court un petit ruisseau, peu large, et la voie ferrée.
12h00 — Nous sommes attablés à une table formée de quatre pieux et de trois planches. Une vraie table de petits galonnés, dont je suis moi-même le plus petit.
On y raconte mille anecdotes des derniers combats, les unes gaies, les autres tristes, et on discute sur la durée du repos.
14h00 — Je me prépare à regagner Bournonville car ma permission ne me permet pas de rentrer au cantonnement après 15h. Le soleil est toujours très chaud et je rentre au cantonnement pour m’étendre sous les arbres. Je me renseigne si quelque chose est arrivé, mais non ; d’ailleurs toute la Section est dispersée.
16h00 — On entend chanter : c’est une répétition en vue d’une soirée qui doit avoir lieu sous peu ; il y a trois francs pour chacun des artistes, plus un prix de vingt-cinq francs à répartir entre les trois meilleurs chanteurs. C’est tentant pour ceux qui se sentent la voix claire et le gousset vide.
17h00 — Deux hommes, blessés légèrement le 14 juillet et qui n’avaient été évacués que jusqu’à La Grange-aux-Bois, rentrent à la Section. L’un d’eux est le troisième camarade de nos repas de gala de Moiremont et de Florent ; il avait un pressentiment, dit-il, de la mort de Quintin.
18h00 — Je me régale d’un litre de lait chaud.
20h00 — Le soir est si beau que je reste assis très longtemps
au grand air.
22h00 — Je me couche enfin, beaucoup ne sont pas encore rentrés, ou couchent dans un autre endroit.
Vendredi 23 juillet 1915
3h00 — Le canon tonne violemment, je ne saurais dire si c’est dans la direction de Perthes ou de l’Argonne.
5h00 — Le canon tonne toujours. Une équipe de bombardiers part pour La Neuville-aux-Bois pour un exercice de lancement de bombes. Ils rentrent un instant après ; ils ont été arrêtés par le Chef de Bataillon à cause d’un service religieux qui doit avoir lieu à Vieil-Dampierre et auquel assistera qui voudra. La pluie tombe, malheureusement, et il faut rester dans la grange.
6h00 — La pluie tombe toujours. Vers 14h il y aura revue par le Commandant de Compagnie. Je nettoie mon fourniment qui en a bien besoin.
8h00 — Un sergent légèrement blessé le 14 juillet rentre également.
9h00 — J’apprends de source officielle que je suis nommé Sergent ; ceci n’est pas sans me causer un certain plaisir, surtout que je ne m’y attendais pour ainsi dire pas. Je suis maintenant le plus jeune sergent de la Compagnie.
11h00 — Je vais déjeuner au mess des sous-officiers, puisque je fais partie maintenant de l’honorable corporation. Le repas est succulent, il y a une grande différence avec l’ordinaire des hommes. Les nouveaux promus offrent le vin blanc et les cigares.
14h00 — La revue a lieu sommairement, c’est plutôt pour affecter les nouveaux promus et quelques hommes de renfort. Le Lieutenant nous félicite. Je reste à ma Section, ce que je préfère, en connaissant tous les hommes. Profitant du rassemblement, nous faisons un état des parties du fourniment manquant à chaque homme, pour le remettre au bureau de la Compagnie. Demain, il y aura revue par le Général de Brigade, et il faudra être luisants.
15h00 — Etant libre maintenant et ne sachant que faire, je vais à Vieil-Dampierre y voir Marcel Trousset, qui justement se trouve rassemblé avec tout son Bataillon en dehors du village pour la revue du Général. Il me fait remarquer que ça fait un joli troupeau de boucherie ; c’est pourtant bien vrai. Le Général interroge tous les gradés et de nombreux hommes. Je rentre à Bournonville car le temps menace.
17h00 — Diner au mess. Il n’y a pas encore d’ordres concernant la revue de demain.
19h00 — La pluie tombe très fort et chacun rentre au cantonnement puis se couche.
Samedi 24 juillet 1915
5h00 — Un coup d’œil au dehors, le soleil ne luit pas, la pluie menace même. Les bombardiers et grenadiers sont rassemblés pour aller à La Neuville-aux-Bois.
Il parait que je suis passé Sergent-grenadier de Compagnie suppléant, je ne sais pas en quoi consiste exactement cet emploi, mais je ne vais pas à l’exercice des grenadiers.
5h30 — Les grenadiers partent et ne reviennent pas comme hier immédiatement.
7h00 — Les sous-officiers ont le chocolat le matin, servi na « salle à manger » (une grande salle de ferme dans laquelle on a installé des planches entre des futailles pour faire des tables).
8h00 — Nous travaillons tous au nettoyage des armes et cuirs, en vue de la revue par le Général de Brigade, qui doit avoir lieu dans le courant de l’après-midi.
12h00 — Tout est prêt, la revue doit avoir lieu à 14h45 et nous nous rassemblerons vers 14h.
14h00 — La Section est prête, nous jetons un dernier coup d’œil sur les hommes pour nous assurer que rien ne cloche. Au dernier moment, l’ai pu toucher une capote neuve en remplacement de celle que je portais depuis mon départ du camp. L’ordre était que les hommes soient en casque, mais moitié n’en n’ont pas ; cette diversité des coiffures frappe aux yeux.
14h15 — La Compagnie va se placer sur le terrain où doit avoir lieu la revue. Les trois autres compagnies du Bataillon viennent se placer là à leur tour. Le temps est couvert et la
pluie menace de tomber.
14h30 — Tout le Bataillon se trouve massé et la pluie commence à tomber très fort. Le Général va-t-il passer la revue par un temps pareil ?
14h45 — Pas de Général.
15h00 — Ordre est donné de nous faire défiler devant le Général qui se trouve à l’entrée d’une grange, parait-il, dans le village. Nous défilons, baïonnette au canon, par la pluie battante. Ce n’est pas un général, mais un colonel, fonctionnaire général de brigade. Nous rentrons au cantonnement où aura lieu la revue en détails.
15h30 — Le Général s’attarde auprès des autres compagnies. La pluie tombe moins fort.
15h45 — Nous sortons des granges pour nous placer en lignes de sections déployées le long de la rue, toujours baïonnette au canon.
16h00 — Le Général n’est toujours pas là, mais on l’attend d’un moment à l’autre.
16h20 — Alors que la pluie recommence à tomber très fort, le Général arrive et passe devant nous qui présentons les armes, puis il tait rassembler en groupes séparés, les sous-officiers, les décorés de la Croix de Guerre et les derniers arrivés en renfort. Il commence sa revue par les sous-officiers et pose de nombreuses questions.
Arrivé prés de moi, il me demande depuis quand je suis sergent, je lui réponds que c’est depuis deux jours ; alors il me demande quelle était ma situation militaire au début de la campagne et sur ma réponse que j’appartiens à la classe 1915, il a l’air étonné et me questionne sur mes occupations dans le civil, sur mon recrutement, sur la date de mon arrivée au front et avec quel grade, puis il passe au suivant, puis aux décorés.
17h00 — Le Général est passé à la compagnie voisine.
18h00 — Nous nous dirigeons vers la grange où a lieu la soirée prévue. C’est en plein air qu’elle devait avoir lieu, mais le mauvais temps oblige acteurs et spectateurs à se réfugier dans une grange. La scène est faite de bottes de paille et la salle possède quelques chaises pour les officiers et quelques bancs pour les civils qui ont été invités spécialement. L’élément militaire de petite classe restera debout. La représentation est commencée depuis quelques instants quand arrive le Colonel ; on continue par des chansons comiques, des chansons dramatiques, de la tragédie, de l’opéra. Il y a de bons chanteurs et de bons déclamateurs, mais il y en a aussi de bien piètres
et la soirée n’a pas, en général, l’éclat qu’on voulait lui donner.
20h30 — Le Colonel trouvant sans doute le temps long, bien qu’il eût l’air de s’amuser, fait lever la séance, et la sortie a lieu au son d’un pas redoublé joué par la musique du 94. Chacun rentre au cantonnement puis se couche.
Dimanche 25 juillet 1915
8h00 — Je me rends dans une grange où doit avoir lieu une messe, et je vois en arrivant qu’il s’agit d’un service à la mémoire des morts du 94. Dans une immense grange, on a dressé sur la plate-forme d’une batteuse, un magnifique autel, entouré de sapins très verts et de fleurs
diverses prêtées par des habitants. Un soldat est le servant de l’aumônier ; quelques chantres, tous militaires. Des chaises sont réservées aux officiers qui assistent nombreux à la messe ; des civils sont là aussi ; nous autres resterons debout, face à l’autel. À la fin de la messe, l’aumônier nous rappelle la fin glorieuse de tous nos camarades du 94 tombés sur les champs de bataille ; la France a encore besoin de tous ses enfants, dit-il, car il faut chasser l’ennemi de chez nous et venger ceux qui sont morts. Ces paroles pleines de patriotisme, sont très belles et très bien dites,
tous nous l’avons la ferme volonté de repousser l’ennemi, mais il faut voir quelle est la situation ; il ne faut pas oublier que nous et les allemands sommes terrés face à face, ceci depuis dix mois, et le plus gros des efforts ne nous permet pas de gagner plus que quelques lignes de tranchées que l’on se dispute ensuite des semaines entières en tuant des hommes sans but bien important. Il faut bien comprendre que cette nouvelle méthode de faire la guerre, si elle ne nous lasse pas, n’est pas faite non plus pour nous encourager beaucoup. Et chez les allemands, c’est la même chose, et voilà pourquoi on stationne ; voila pourquoi tout en voulant faire son devoir, on comprend trop bien que les pertes sont beaucoup trop élevées, vus les résultats obtenus. S’il nous est donné de nous trouver un jour face à face avec les allemands en rase campagne, je ne doute pas un seul instant que notre moral à tous ne se trouve immédiatement relevé ; il faut entendre les anciens du 94, ceux qui ont fait la Marne, raconter la joie qu’ils éprouvèrent lorsqu’ils sentirent qu’ils ne reculaient plus ; ils ne demandaient plus qu’à foncer sur l’ennemi, disent-ils, et ce serait la même chose maintenant, si nous ne sentions pas tant de tranchées en face de nous, qui sont autant de forteresses dont la prise ne permet
que de progresser d’un pas.
13h00 — Le déjeuner pris, nous partons, tous les sous-officiers ensemble, à travers bois à la recherche d’une rivière problématique où nous comptons bien attraper notre repas du soir. Nous sommes munis de lignes plus ou moins bonnes, et je ne doute pas que nous ne rentrions sans un seul poisson, mais nous aurons passé le temps et pris l’air, c’est l’essentiel. Nous errons longtemps, pour revenir finalement sur nos pas, lorsque nous sommes surpris par une ondée qui nous oblige à chercher refuge dans les troncs creux des saules. La pluie passée, nous continuons notre chemin et trouvons la rivière. La première ligne est à peine à l’eau que l’on remonte un poisson de moyenne grosseur, devant lequel nous tombons en extase, tant nous sommes surpris d’un résultat aussi rapide. Encouragés, nous jetons toutes les lignes à l’eau, et restons là deux heures : cette fois, plus rien, et l’heure avançant, force nous est de revenir à Bournonville avec notre unique poisson dont on se promet de faire vingt parts au repas du soir. Comme on est gosses tout de même en certains instants. Il me semble que j’éprouverais du plaisir à m’occuper d’un travail de tête intéressant.
21h00 — Au moment de me coucher, j’apprends que demain
à 5h20 du matin, je dois commander l’équipe des grenadiers à l’exercice de lancement de pétards et de bombes à La Neuville-aux-Bois.
Lundi 26 juillet 1915
5h00 — Le café aussitôt bu, je saute du tas de foin pour prévenir mes bombardiers, mais je suis à peine dehors que j’apprends qu’il y a contre-ordre, et que toute la Compagnie doit prendre part à une marche d’entraînement de dix kilomètres, avec chargement complet (les sergents ont l’avantage d’aller à l’exercice sans sac). Nous nous tenons prêts pour 6h30.
6h30 — La Compagnie est rassemblée pour la marche lorsqu’arrive l’ordre de rentrer, le maitre-armurier venant d’arriver et devant passer une revue d’armes à 9h. Les hommes acceptent ce contre-ordre avec plaisir.
7h00 — Nettoyage des armes.
9h00 — L’armurier fait fonctionner tous les fusils et ordonne les réparations nécessaires.
10h00 — Cette fois il va y avoir revue d’armes démontées par le Commandant, et les soldats se mettent à nettoyer à nouveau et à démonter les fusils pièce à pièce.
10h30 — Le travail terminé, la soupe arrive, la revue est supprimée. C’est le métier militaire de faire et défaire à chaque instant.
15h00 — La pluie tombe, l’après-midi se passe au cantonnement.
19h00 — Le cahier de rapport nous apprend que demain à 6h30 il y aura exercice de lancement de bombes à La Neuville-aux-Bois ; vivement je préviens les hommes qui doivent y assister et que je dois d’ailleurs conduire moi-même.
20h00 — Réunis dans une bicoque inhabitée, nous faisons un petit concert entre sergents.
20h30 — Notre réunion est interrompue brusquement par l’arrivée d’un messager venant du Lieutenant, demandant tous les sous-officiers à Lui. Nous nous empressons de nous rendre à sa chambre, anxieux de savoir pour quelle raison il nous fait appeler à une heure aussi tardive. Nous sommes bientôt près de lui : le hasard veut que ce soir là ii passe sans tous les cantonnements, et bien entendu, il n’y trouve aucun sergent et il voulait savoir où nous étions. Après quelques explications, il nous congédie et nous terminons, dans la tranquillité cette fois, notre petite fête, et rentrons ensuite nous coucher.
Mardi 27 Juillet 1915
5h00 — Le café bu, je m’empresse de voir les bombardiers pour leur donner des ordres en vue de l’exercice qui doit avoir lieu à La
Neuville-aux-Bois.
6h30 — Les pionniers et les bombardiers rassemblés, nous partons, cependant que la pluie menace. Le reste de la Compagnie se prépare au départ pour une marche militaire de neuf kilomètres. La distance qui sépare Bournonville de La Neuville-aux-Bois n’est que de deux kilomètres et demi et nous arrivons bientôt.
8h00 — Nous sommes sur le terrain d’exercice et les hommes écoutent la théorie que leur fait un sergent de la partie ; pendant ce temps je rencontre plusieurs camarades d’un fameux bataillon de marche du 94 qui est au repos dans le village. Voilà trois mois que ces camarades sont sur le front et ils ne sont jamais allés dans les tranchées ; ceci est bizarre et je les questionne sur le rôle de leur bataillon, ils ne savent que répondre : à leur avis, on s’attendait à une grande offensive de notre part et ils nous auraient soutenus, mais cette offensive n’ayant pas eu lieu, ils restent là à ne rien faire pour ainsi dire.
9h00 — La pluie commence à tomber très fort, mais les essais ce bombes n’en sont pas supprimés pour cela ; dans les tranchées creusées à cet effet, les futurs bombardiers essayent les différentes variétés
d’engins. Il y a entre autres un nouveau pétard, appelé « pétard d’assaut » qui n’est pas chargé à mitraille, et qui par conséquent ne tue pas, mais qui explose avec un bruit si fort qu’il commotionne les occupants de la tranchée sur plusieurs mètres de rayon. Plusieurs pétards lancés ainsi dans la tranchée ennemie permettent d’attaquer celle-ci à la baïonnette avec moins de risques, mais il faut pour cela que les pétards tombent bien dans la tranchée, et dame !, on est bien obligé de les lancer un peu au hasard. Aprèss avoir tenté un assaut avec des pétards ordinaires, le clairon senne le rassemblement, et c’est sous la pluie qui ne cesse de tomber que nous prenons le chemin du retour.
11h00 — Les camarades sont allés au Chemin, un petit village à cinq kilomètres d’ici ; c’était une petite marche d’épreuve, mais d’autres plus importantes doivent suivre, parait-il.
15h00 — Décidément ce n’est pas de chance, la pluie tombe toujours ; on serait heureux cependant de passer ses heures de loisir sous les arbres.
18h00 — Après la soupe nous faisons une promenade d’une demi-heure, car la pluie a cessé. À
notre retour, le fourrier nous apprend qu’il y aura demain une revue en tenue de campagne par le Général de Division, à un endroit qui n’est pas très bien déterminé. Nous transmettons l’ordre aux hommes.
21h00 — Tout le monde dort afin demain d’être prêts dès la première heure.
Mercredi 28 juillet 1915
5h00 — Toutes les compagnies sont debout. Le départ pour la revue est à 7h30, la revue elle- même aura lieu à 8h30, on ne sait toujours pas exactement où, mais peu importe. Chacun frotte, astique, boucle son sac, car tout devra être en ordre.
7h00 — Chacun est prêt et attend le signal du rassemblement. Pour la première fois depuis plusieurs jours, le temps a l’air de vouloir se maintenir.
7h15 — La 9ème Compagnie défile, vite nous nous rassemblons pour suivre. Pour ceux qui en ont un, le casque est de rigueur. Ceux-ci, noyés dans les képis, jettent une note discordante.
7h30 — Nous prenons le chemin de Vieil-Dampierre. Tout le Bataillon est là, et il s’agit certainement d’une revue de tout le Régiment, puisque les deux autres Bataillons sont à Vieil- Dampierre et que c’est là que nous allons.
8h15 — Nous nous massons dans un immense champ, au
nord de Vieil-Dampierre, et les 1er et 2ème Bataillons, ainsi que les mitrailleurs, les téléphonistes et le corps sanitaire du Régiment nous suivent. Tout le Régiment est là : pour la première fois je le vois tout entier, il forme une masse imposante.
8h30 — La sonnerie du « Garde à vous » retentit, suivie immédiatement du Chef de Bataillon : « Baïonnette au canon ! » — « Présentez armes ! ». C’est le Drapeau qui arrive et la sonnerie « Au Drapeau » suivie de la « Marseillaise » se fait entendre. J’ai beau m’écarquiller, je ne vois rien, qu’une forêt de baïonnettes qui s’étend très loin. Nous reposons les armes.
8h45 — Cette fois, le Général arrive. « Présentez armes ! » à nouveau. Le Général D. passe devant nous au triple galop, suivi de sa suite. Alors qu’il passe devant les mitrailleurs, un officier de l’Etat-major tombe de cheval ; le corps sanitaire s’empresse auprès de lui, le Général met pied à terre, sa suite en fait autant ; un ordonnance apporte un brancard, mais l’on relève l’officier qui, soutenu par deux infirmiers, regagne à pied le village. Maintenant les Bataillons s’ébranlent et prennent la formation en carré ; les trois bataillons forment trois côtés, le quatrième est occupé par le Général et son Etat-major.
Le Drapeau est au centre du carré. Les Chefs de Bataillon sont alignés derrière la garde du Drapeau. Le Général met pied à terre, s’avance vers le Drapeau dont il s’arrête à vingt pas. Il appelle ensuite le Capitaine F., commandant intérimaire de notre 3ème Bataillon et lui remet à la fois la Croix de Guerre et la Légion d’Honneur ; ensuite c’est le tour du Colonel Commandant le 94, à qui il remet la Croix de Guerre seulement. Puis le Général parle, assez longuement même, mais le vent souffle, des chevaux hennissent, et je ne parviens à entendre que quelques mots : « ... votre 94 est un des régiments de France qui a eu le plus de pertes et aussi le plus d’honneur... » Malgré toute mon attention, je ne puis entendre le reste. « Demi-tour ! » Tout le Régiment va se masser en haut du champ pour le défilé final. En colonne double de compagnies, nous défilons devant le Général d’abord, puis devant le Drapeau et nous reprenons sans nous arrêter le chemin de Bournonville, mais nous arrêtons bientôt, le Général ayant convoqué à la suite de la revue les officiers, adjudants et sergents-majors, et nous attendons ceux-ci pour rentrer.
10h00 — Les officiers et les sous-officiers supérieurs rentrent. Je serais curieux de savoir ce que le Général leur a raconté. Mais nous le saurons au déjeuner.
11h00 — Rentrée à Bournonville. Chacun est heureux de quitter son sac, ses musettes et son équipement. Puis la pause sur le terrain et la marche ont creusé les estomacs. Nous courons à la soupe que les cuisiniers, restés à cet effet, ont préparée. Immédiatement la question est posée aux adjudants et sergents-majors : « Que vous a dit le Général ?". Tout d’abord il leur a dit qu’il fallait beaucoup de courage et de ténacité « car la guerre n’est pas encore commencée ». Le mot est salué par une salve de « Ah ! » ébahis, mais la suite nous intéresse plus. Notre repos doit durer quinze jours si le front d’Argonne reste tranquille. Si l’ennemi n’attaque pas, non seulement notre repos sera plus long, mais nous quitterons le secteur ; nous ne retournerons plus aux Bois de la Gruerie. « Ah ! » d’espérance cette fois. Depuis la campagne, le 94 a eu 16 000 hommes hors de combat (tués, prisonniers et grands blessés inaptes à combattre à nouveau), a dit le Général. Nombre impressionnant, si l’on songe qu’il faut ajouter à cela tous les blessés, qui sont revenus une, deux, ou même trois fois, renforcer le Régiment après guérison et séjour au dépôt. Le Général a parlé des réformés rappelés qui renforcent actuellement nos bataillons et a dit qu’ils n’étaient pas des soldats comparables aux jeunes de l’active, ceci n’a pas besoin
de commentaires : des hommes reconnus autrefois impropres au service armé ne peuvent assurément devenir maintenant des soldats de premier ordre. Il ajouta, parait-il, que ces hommes cherchent à se faire évacuer par tous les moyens possibles : personnellement je ne le crois pas. Certainement, j’ai vu de ces cas, même étant au dépôt, mais je ne crois pas que ce soit la généralité. Enfin le Général a terminé en disant
que l’on avait nommé des sous-officiers qui pouvaient être très courageux, très braves et excellents dans les tranchées, mais qui ne savaient pas commander, et que pour ceux-là justement, ainsi que pour les hommes qui n’ont pas eu une instruction militaire suffisante, il fallait faire, au repos, l’exercice. J’aurais mauvaise grâce à nier qu’en temps de paix je ferais un piètre sergent, je le sais parfaitement. En temps de paix, on est sergent au bout de douze et quinze mois et je n’ai fait que cinq mois de classes ; je ne suis forcément pas à la hauteur ; mais les temps ont singulièrement changé, et m’est avis qu’actuellement ce ne sont pas des soldats de parade qu’il nous faut. De toute cette conversation entre le Général et les officiers et sous-officiers, je déduis que le Général a parlé avec ceux-ci très ouvertement, et même amicalement, et ceci est d’une grande importance, car j’ai toujours remarqué que de bonnes
paroles prononcées par un supérieur à son subordonné produisent toujours sur ce dernier une excellente impression.
15h00 — Nous avons liberté pleine et entière, aucun ordre. Le temps est assez beau et on peut s’étendre à nouveau sur l’herbe.
20h00 — L’après-midi s’est passé tranquille. Un appel très sérieux est fait, puis on apprend officiellement qu’il y aura demain marche de quinze kilomètres.
Jeudi 29 Juillet 1915
5h00 — Le café est pris rapidement, puis les hommes bouclent leurs sacs et se préparent pour la marche.
6h30 — Départ de la Compagnie, direction Passavant. Le temps est très beau et il fait bon marcher sous les arbres. Nous passons à Villers-en-Argonne, puis laissons à un kilomètre à gauche Passavant, passons au Chemin, puis rentrons à Bournonville, pas trop fatigués. Ces marches sont, paraît-il, des marches d’entrainement. Elles ne sont pas trop goûtées des hommes, ce que je comprends, car je connais le poids du sac.
10h00 — La soupe est prête. Rien n’est prévu pour l’après-midi.
15h00 — Je passe l’après-midi sur l’herbe à lire.
20h00 — Demain, marche à nouveau.
Vendredi 30 juillet 1915
6h30 — Départ pour la marche, direction Sivry-sur-Ante. Au cours de notre marche, nous rencontrons toutes les compagnies du Régiment, ce qui prouve que tout le Régiment a reçu l’ordre de faire des marches.
10h00 — À notre rentrée à Bournonville, nous recevons l’ordre de nous tenir prêts à partir et de ne pas quitter les cantonnements, car nous devons embarquer le soir même. Stupéfaction générale, on était loin de s’attendre à un départ aussi précipité, mais il n’y a qu’à se conformer aux ordres et se tenir prêts à partir.
11h00 — Les discussions vont leur train. Chacun veut savoir la direction que nous allons prendre ou le secteur que nous allons occuper, mais a vrai dire nul ne sait, c’est peut-être même aux Bois de la Gruerie que nous retournerons.
14h00 — Pas de nouveaux ordres. On n’est même plus certains que c’est par chemin de fer que nous voyagerons.
16h00 — Le bruit court que nous allons encore au repos. On croit que c’est au Camp de Mailly que nous allons.
17h00 — Ordre est donné que le rassemblement ait lieu a 21h pour que le départ soit à 21h15.
17h30 — Pendant le dîner la conversation roule sur notre départ. Le Sergent-major nous apprend que l’heure du départ est remise à 22h45 et que l’embarquement en chemin de fer aura lieu a Vieil-Dampierre à 1h du matin.
20h00 — Je fais mes adieux à la famille chez laquelle nous cantonnions. Ces braves gens paraissent peinés de notre départ.
22h00 — Les corvées de chargement des wagons et la garde de police partent à l’avance.
22h45 — Rassemblement des compagnies puis départ immédiat. Nous suivons exactement le Sème itinéraire que pour la marche de ce matin, jusqu’à Ante. Nous sommes éclairés par un clair de lune magnifique et tous les hommes sont gais et chantent pour s’entraîner. On est très bien, il ne fait pas froid à marcher.
Samedi 31 juillet 1915
0h00 — Minuit. La nuit est devenue plus froide, nous nous dirigeons vers Vieil-Dampierre dont nous apercevons déjà les lumières de la gare.
1h00 — Nous faisons halte, croyant à une pause de courte durée et nous étendons dans l’herbe qui est humide. Je sommeille d’abord puis m’éveille, gelé, on n’a pas encore donné le signal du départ. Vraisemblablement il y a encombrement dans la gare et notre embarquement s’en trouve retardé ; les officiers eux-mêmes ne savent pas à quelle heure nous embarquerons.
2h00 — Nous sommes toujours sur la route à faire les cent pas, car le froid est très vif. C’est bizarre qu’on nous laisse aussi longtemps dans cette situation. Les voitures du Bataillon et les chevaux des officiers sont embarqués déjà, comment se fait-il qu’on nous laisse là ?
4h00 — Enfin, l’ordre est donné de mettre sac au dos, ce que l’on exécute vivement, car on ne demande qu’a partir. Nous entrons dans la petite gare, puis gagnons le quai le long duquel sont rangées les voitures qui doivent nous emmener. Ce sont de vulgaires wagons à bestiaux sans paille ni bancs, d’où j’en déduis que le trajet à effectuer sera court. Nous nous casons comme nous pouvons à quarante par wagon, et le train part presque aussitôt dans la direction de Sainte-Menehould où nous arrivons bientôt. Nous attendons tous anxieusement quelle
direction nous allons prendre maintenant : Châlons ou Verdun ? C’est Châlons, mais ceci ne nous dit toujours pas où nous allons.
— Valmy. Beaucoup de soldats, gare régulatrice pour les blessés.
— Somme-Bionne. Somme-Tourbe : le pays est rasé et présente un aspect affreux, on dirait qu’une trombe monstrueuse est passée là, brisant tout sur son passage. De nombreuses maisons de planches, toutes du même style et bien alignées, ont été construites
à peu de distance de l’ancien village pour recevoir les familles sans abri.
— Suippes. Le village est assez éloigné de la gare et est cache par des arbres, mais on distingue cependant qu’il a beaucoup souffert du bombardement.
— Cuperly. Toujours des territoriaux qui se sont construit des gourbis et qui vont et viennent dans les champs. Ici nous apprenons par des hommes du génie que notre 2ème Bataillon est débarqué ce matin à Saint-Hilaire-au-Temple, c’est donc que ce serait là le terme de notre voyage ; cependant nous traversons cette station, puis Bouy, à grande vitesse, et je voudrais que le train ne s’arrêtât plus avant Sillery ; malgré cela, je sais parfaitement que l’on ne peut dépasser Mourmelon, et suis tout heureux de me sentir plus près de la maison.
7h00 — Mourmelon. Le train est aiguillé sur la voie de garage et le débarquement commence et est très activement mené. Trois pas seulement me séparent d’Ambonnay où est papa, et je distingue facilement Verzy et les taches blanches que forment les carrières de terre sulfureuse au sommet de la Montagne de Reims. Etre si près de chez soi et ne pouvoir y aller, c’est un vrai supplice de Tantale. Mais je me sens le cœur plus
léger d’être dans ma région. Peut-être le hasard voudra-t-il que je combatte mur notre propre sol. Je le souhaite.
8h00 — Etendus sous les arbres le long de la route qui va au Grand Mourmelon, nous attendons des ordres pour gagner un cantonnement quelconque et mangeons quelques vivres. Je trouve un ravitaillement d’aviation qui va a Ambonnay et lui remets un mot pour papa.
10h00 — Départ. Traversons le camp jusqu’à Mourmelon-le-Grand, puis ce village également, et marchons à travers le camp sous un soleil bridant et dans une plaine sans arbre. Brisés par la chaleur, nous cheminons vers l’inconnu, les officiers eux-mêmes semblent ne pas savoir exactement où ils nos conduisent.
11h00 — Pause d’un quart d’heure, toujours en plein soleil.
12h00 — Arrivons près de gourbis en construction, c’est là que nous allons cantonner ; il faudra aménager ces habitations, d’ailleurs il n’y a de la place que pour la moitié de la Compagnie et le reste devra coucher sur le gazon, sous les sapins. On s’installe comme on peut, je me mets a même sur la terre pour dormir un peu car je n’ai pas fermé l’œil la nuit dernière.
14h00 — Pour la première fois depuis que je suis sur le front, je vois, a l’aide des toiles de tente et de piquets, confectionner des tentes, qui, dans les bois, serviront d’abris à ceux qui
ne peuvent habiter dans les gourbis.
Moi-même, avec un adjudant, un sergent et leur ordonnance, je me construis un abri de ce genre pour Être moins à l’air pendant la nuit. D’ailleurs la chaleur est telle qu’un orage est à craindre et bien que nous soyons étrangement habitués aux douches célestes, nous aimons à être à couvert.
20h00 — Aucun ordre. On ne sait rien sur ce qui doit avoir lieu demain.
Dimanche 1er août 1915
5h00 — Je m’éveille les pieds gelés. Nous prenons le café.
7h00 — L’ordre est donné de construire de nouveaux gourbis pour les sections non abritées la nuit dernière, et de faire disparaître les toiles de tente qui nous font repérer par les avions. Immédiatement, les hommes se mettent à l’œuvre, arrachent des mottes de gazon pour en faire un mur, et notre gourbi est en bonne voie lorsque l’ordre arrive de déménager pour se rendre dans d’autres gourbis, presque terminés, à quatre cents mètres de là. On s’exécute, les officiers casent les sections et le Commandant de notre Compagnie nous désigne un gourbi, qui est très vaste en effet, et où tous les sergents tiendront à l’aise, mais qui se compose en tout et pour tout d’un mur haut de cinquante centimètres : voilà notre habitation et il ne faut pas compter sur les hommes pour
en continuer la construction, les leurs ne sont pas terminées et il faudra les agrandir. Enfin nous nous abriterons comme nous pourrons, et je crois bien qu’envers et contre tout, il faudra employer les toiles de tente recouvertes de branchages.
8h00 — Il n’y a toujours rien. Nous ne savons ce que nous ferons les jours prochains. Il pleut et nous couvrons en hâte notre soi-disant gourbi avec six toiles de tente.
Lundi 2 août 1915
7h00 — Des hommes désignés dans chaque section commencent à bâtir notre gourbi, en empilant des mottes de gazon. Le travail va très lentement et le mur est branlant. Nous avons de piètres maçons.
15h00 — Le Général remet la Médaille Militaire à deux sergents des 9ème et 11ème Compagnies, et à cet effet ces deux compagnies sont passées en revue. À la suite de la prise d’armes, le Général réunit tous les officiers du Régiment.
16h00 — Le Général aurait dit aux officiers que demain nous partons pour cantonner à Mourmelon-le-Petit, et que les jours suivants nous irions creuser un boyau très long et très large, du côté de Baconnes, boyau qui permettra d’évacuer en voiture les blessés du front.
18h00 — Notre gourbi est loin d’être terminé et nous coucherons à l’air encore cette nuit.
Mardi 3 août 1915
8h00 — Le temps n’est pas très beau, mais à 8h30 nous aurons rassemblement pour aller à l’exercice.
9h00 — École de compagnie, ensuite rapport sous la pluie battante ; le Lieutenant nous apprend que la nuit prochaine, à 2h, nous partirons poursuivre les travaux de terrassement que les deux premiers bataillons ont commencés. Le travail sera dur, parait-il, et il compte sur notre bonne volonté. Le travail sera de huit heures avec une heure de pause pour manger les vivres que l’on touchera avant le départ. La pluie tombe avec une telle force que l’on est obligé de se disloquer et de rentrer dans les gourbis au pas gymnastique.
15h00 — Chacun fait la sieste car les heures de repos cette nuit seront courtes.
19h00 — Tout le monde est au nid. D’après des camarades du 1er Bataillon qui sont allés au boyau, le chemin est long et les boches envoient des obus de temps à autre.
20h00 — Les quelques militaires se trouvant au front depuis six mois consécutifs, et ayant droit à une permission, sont prévenus de se tenir devant le bureau du Colonel à partir de 1h du
matin ; ils avaient déjà été avertis officieusement, mais c’est si bizarre au Régiment!.. Enfin cette fois c’est certain, ils partent, aussi ne se sentent-ils plus de joie.
Mercredi 4 août 1915
1h00 — Je suis éveillé par la distribution des vivres. Les permissionnaires sont déjà partis. Nous touchons un morceau de viande très petit, puis un litre de café. La Compagnie est ensuite rassemblée ; on s’y reconnaît à peine tant la nuit est noire ; je crains que nous n’ayons de la pluie en route.
2h00 — Départ à travers le camp. Nous passons à Mourmelon, puis revenons sur nos pas pour nous diriger ensuite vers le front ; je crois que celui qui nous conduit n’est pas très sûr de lui.
3h00 — Pause. On s’aperçoit que deux compagnies sur quatre manquent à l’appel. Encore le manque de liaison.
3h30 — Les deux compagnies retardataires étant enfin retrouvées, nous reprenons la marche en avant. Le jour monte, on marche plus sûrement sous les sapins, pour se dissimuler aux vues de l’ennemi qui occupe les crêtes en face.
4h25 — Après bien des allées et venues sous bois, nous sommes enfin arrivés sur l’emplacement du travail. Le boyau à continuer est très large. Nous allons chercher les outils, pelles et
pioches, et le travail commence immédiatement. À peu de distance, six cents mètres environ au nord, on aperçoit devant un groupe de sapins de petite taille une ligne blanche qui se prolonge indéfiniment à gauche et à droite ; c’est le parapet crayeux de notre première ligne. Beaucoup plus loin maintenant, à quatre ou cinq cents mètres des nôtres, on distingue les lignes allemandes ; dans le fond c’est la butte de Moronvilliers où s’étagent des tranchées et des tranchées allemandes.
9h00 — Trois obus tombent derrière nous et presque aussitôt nous apprenons qu’un adjudant et un sergent de la lierne Compagnie ont été blessés. Un dragon passe près de moi ; je sais que c’est son régiment qui tient une partie du front que nous avons devant nous et je lui pose
quelques questions. Depuis février ils n’ont eu aucun combat et par conséquent leurs pertes sont pour ainsi dire nulles ; il y a des fusillades de temps à autre, mais la distance séparant les deux lignes ne permettant pas d’employer les torpilles aériennes, les crapouillots, les bombes et toute la série infernale des engins, il ne se produit jamais de boucherie comme à Bagatelle ou à Marie-Thérèse. Un tel secteur serait pour nous un paradis. Pour le moment nous n’avons pas à nous
10h00 — Pause d’une heure pour prendre quelque nourriture.
12h00 — Départ. Le retour se fait par une chaleur accablante et là où nous passions sous bois ce matin, nous passons à la lisière maintenant qu’il fait bien clair ; je ne comprends pourquoi et me demande si les allemands ne nous voient pas des crêtes de derrière. Au lieu de prendre un chemin de traverse qui se trouve à l’abri de l’ennemi et qui nous raccourcirait d’une demi- heure, nous allons à nouveau passer dans Mourmelon.
14h00 — Enfin nous arrivons. Coup sur coup, je vide trois quarts de café froid qui restait dans un seau, puis prends quelque repos ainsi que tous les camarades qui n’en peuvent plus. Les hommes qui ont, eux, travaillé sept heures, doivent être exténués.
19h00 — On se couche déjà. Demain, repos avec petit exercice l’après-midi.
Jeudi 5 août 1915
5h00 — Réveil. Café. Pas d’ordres, on fait la grasse matinée.
7h00 — L’ordre paraît maintenant que la soupe sera mangée à 9h et que le départ pour le boyau en cours de terrassement aura lieu à 10h. Le repos est supprimé. Tous les sergents n’étant pas nécessaires, cette fois nous
établissons un tour, je suis du nombre de ceux qui restent aujourd’hui.
10h00 — La soupe prise « sur le pouce », les camarades partent. Le soleil est toujours très chaud.
15h00 — Rien de nouveau ; on sommeille dans les gourbis aérés par dix ouvertures.
20h00 — On s’étend. C’est notre tour demain d’aller au fameux boyau. La manutention de Mourmelon est en train de brûler, paraît-il, suite de bombardement.
22h00 — J’entends vaguement les camarades qui rentrent. Il y aurait eu deux nouveaux blessés, mais aucun de la Compagnie.
Vendredi 6 août 1915
6h00 — On fait la grasse matinée, avant de partir à notre boyau du côté de Baconnes.
9h00 — La soupe est prise rapidement, puis on s’équipe.
10h00 — Départ, mais cette fois sans passer par Mourmelon. Il fait une chaleur accablante.
15h00 — Le travail avance rapidement. Ce matin il y a eu deux tués et six blessés à la 3e Compagnie par suite du bombardement.
20h00 — Aucun incident à signaler. Nous n’avons pas reçu d’obus. Le retour s’effectue en silence.
22h00 — Rentrée au cantonnement.
Samedi 7 août 1915
8h00 — Je vais trouver le Commandant de Compagnie pour obtenir une permission de la journée de demain, pour voir mon père à Mourmelon. Le Lieutenant m’accorde cette dernière, mais je dois retourner au boyau aujourd’hui même afin d’être libre demain.
10h00 — Je reprends le chemin du boyau. Il fait toujours aussi chaud.
12h00 — Le travail commence ; nous recevons quelques obus, mais sans nous occasionner de pertes.
22h00 — Nous rentrons au cantonnement et je trouve sur mon sac une permission de la journée pour demain.
Dimanche 8 août 1915
8h00 — Je suis debout et me nettoie comme je puis avec de l’eau qui me reste dans un bidon. Il y a une assez grande distance de nos gourbis à la pompe la plus rapprochée.
8h00 — Je pars pour Mourmelon. J’avais hier remis une lettre à un ravitaillement dans laquelle je fixais un rendez-vous à papa ; je n’y trouve personne et vais et viens en attendant.
10h30 — Enfin je vois arriver papa et je cours à lui ; il désespérait déjà de me trouver. Lui aussi m’avait fixé un rendez-vous par l’entremise d’un ravitaillement, mais ni l’un ni l’autre nous n’avions reçu les lettres. L’essentiel est que nous soyons maintenant ensemble ; je
n’aurais jamais songé il y a quelques semaines à peine que nous aurions pu nous rencontrer au cours des hostilités ; nous sommes des privilégiés. Après nous être promenés longuement malgré la chaleur accablante, nous déjeunons à l’Hôtel de l’Europe, luxe inconnu pour moi depuis longtemps. Il y a beaucoup d’embusqués qui déjeunent là également. Le repas terminé, nous prenons la direction de Mourmelon-le-Petit, faisons une longue sieste sur l’herbe, puis gagnons la gare. Un gendarme, bon enfant celui-là, me permet d’accompagner papa sur le quai. Nous espérons nous revoir avant mon départ de la contrée. Pour ma part, je compte bien obtenir une permission pour Ambonnay. Après le départ du train, je rentre au camp où j’apprends que cette nuit à 2h, je vais au boyau avec la Compagnie.
21h00 — J’essaie de m’endormir pour être dispos à l’heure du départ.
Lundi 9 août 1915
2h00 — Départ pour le boyau.
9h00 — Comme à l’habitude, le travail marche activement. Le boyau est creusé par petits secteurs, les parties se trouvant dans des clairières sont laissées pour être creusées de nuit.
12h00 — Nous quittons l’ouvrage ; la chaleur est très forte.
Le 1er Bataillon qui arrive pour nous relever a l’air harassé ; le soleil ne nous ménage vraiment pas. Par bonheur les canons restent muets.
14h00 — Rentrée au cantonnement. Les hommes se jettent sur les seaux d’eau préparés à leur intention et je ne sais ce qui me retient d’en faire autant, tellement j’ai la gorge sèche.
17h00 — Chacun se repose ; cette nuit, les hommes retournent au boyau ; c’est mon tour de rester ici.
18h00 — J’apprends qu’il y a eu hier à Mourmelon grand conseil de la Division, mais bien entendu, les résultats ne nous sont pas communiqués. Le Général Sarrail qui commandait notre Armée est passé au commandement des troupes de l’Expédition d’Orient. Il est question qu’il nous emmènerait avec lui ; je crois que c’est un bruit douteux.
21h00 — Chacun se repose.
Mardi 10 août 1915
2h00 — Je suis éveillé par les camarades qui vont au boyau, mais je ne tarde pas à m’endormir à nouveau.
9h00 — J’ai pu obtenir une permission de la journée pour demain, pour me rendre à Ambonnay. Je ne puis compter sur une bicyclette, aussi je devrai partir tôt de crainte d’être obligé de faire la route à pied.
14h00 — Les hommes rentrent du boyau.
18h00 — Rien de nouveau. Nous nous demandons comment il se fait qu’on nous laisse aussi longtemps sans combattre. Que nous prépare-t-on ? Des troupes sont massées ici au camp et sont occupées aux mêmes travaux que nous, à d’autres endroits du même secteur. On ne peut appeler ce séjour ici du repos, car c’est très fatigant pour tous d’aller au boyau et d’y travailler sept heures.
Mercredi 11 août 1915
5h30 — Je m’éveille et me tiens prêt à partir, car je ne veux pas perdre un seul instant. Alors que tous les camarades sont encore endormis, je quitte le bivouac et gagne Mourmelon-le- Grand aussi vite que possible. Passé cet endroit, j’ai la chance de pouvoir monter dans une voiture de ravitaillement qui m’emmène à Mourmelon-le-Petit. A peine descendu, je remonte
en autobus jusqu’à Livry ; là, je fais trois cents mètres à pied, puis remonte en auto jusqu’à Vaudemanges ou je retrouve une voiture pour Ambonnay. J’ai vraiment toutes les chances et je m’étonne en arrivant là qu’il ne soit que 8h. La journée se passe le plus agréablement du monde, au bureau, au cellier, à la cave. Je suis reçu à bras ouverts, si j’ose dire. Le petit-fils du propriétaire nous
photographie mon père et moi. L’heure du départ arrive, Mr. Cochet pousse l’amabilité jusqu’à me reconduire en voiture jusqu’à Mourmelon-le-Petit. Arrive là, je fais deux kilomètres à pied, puis retrouve une ambulance qui m’amène tout près du bivouac.
21h00 — Je m’étends sur la paille, heureux de ma journée et regrettant seulement de ne pouvoir recommencer.
Jeudi 12 août 1915
9h00 — Le temps n’est pas très engageant ; chacun reste dans son gourbi à se reposer et faire sa correspondance.
15h00 — Dans les gourbis on écrit toujours ; dehors sous les sapins il y a des joueurs de cartes. Cette nuit à 2h, je pars une nouvelle fois pour le boyau. Des ordres très sévères ont été donnés pour que les hommes marchent en ordre, car il a été remarqué que les jours précédents, des traînards restaient derrière chaque section.
20h00 — Ceux qui doivent partir cette nuit se couchent ; les autres continuent d’interminables parties de cartes.
Vendredi 13 août 1915
2h00 — Les distributions des vivres pour la journée sont faites. Nous partons par une nuit très noire, on voit à peine à quelques pas devant soi ; heureusement la colonne marche lentement et on parvient à rester en liaison.
3h00 — Halte sous bois. La nuit est toujours aussi noire.
3h30 — Nous rencontrons des équipes de terrassiers qui ont travaillé pendant la nuit. Le jour commence à paraître.
4h00 — Arrivée sur les lieux. Distribution des outils et mise en marche du travail.
9h00 — La pluie tombe à flots et nul gourbi où se réfugier. Bon gré, mal gré, il faut se laisser tremper. La pluie cesse quand je commence à sentir la fraîcheur sur les épaules.
12h00 — Retour. Marche lente qui nous permet de faire marcher les hommes en ordre. 14h00 — Arrivée au cantonnement. On se déséquipe.
14h10 — « Equipez-vous ! ». Il y a prise d’armes et remise des citations à l’ordre du jour.
14h30 — Le Bataillon est réuni en carré. Le Commandant lit les citations. Le Commandant de notre Compagnie est cité à la suite des combats des 13 et 14 juillet. Un sergent de chez nous est également cité, puis un caporal qui a été tué et un homme qui a eu les deux pieds coupés : triste compensation.
15h00 — Cette fois nous pouvons nous reposer, un peu de bouillon est distribué aux hommes afin de
leur permettre d’attendre la soupe de 17h.
18h00 — La pluie m’interdit une promenade projetée au 2ème Bataillon. Des bruits courent que nous n’allons plus rester bien longtemps ici.
Samedi 14 août 1915
6h00 — Réveil ; la journée ne s’annonce pas très belle. Le départ de la Compagnie pour le boyau n’aura pas lieu à 10h ce matin comme on le prévoyait, mais à 18h ce soir, pour travailler de nuit.
9h00 — Le temps s’élève. Dans le camp, des compagnies font l’exercice ; dans toutes les directions, on entend les clairons et tambours qui s’exercent, les musiques des différents régiments qui répètent, et on se demande si c’est bien la guerre. Les quelques coups de canon, très espacés d’ailleurs, que l’on entend au loin, passent presque inaperçus. Des bruits persistants de départ prochain circulent.
14h00 — Il paraît que nous partons demain ou après pour Athis ou Condé-sur-Marne. Doit-on ajouter foi A ces bruits ? Peut-être, car il est bien certain que nous ne pouvons nous éterniser ici.
16h00 — Revue en capote et brodequins graissés, passée par un sous-lieutenant. Ensuite rassemblement privé des caporaux par le Commandant de Compagnie intérimaire qui leur
fait un assez long discours, dont nous ne pouvons savoir la teneur. 16h30 — Les fusils sont portés à l’armurier du 94 qui retouche rapidement l’auget pour permettre l’emploi des balles de mitrailleuses.
18h00 — La Compagnie est rassemblée pour le départ. Ce n’est pas mon tour de marcher. 19h00 — La Compagnie est toujours là, on attend des ordres, parait-il.
20h00 — La Compagnie vient seulement de partir ; la nuit ne passera pas sans pluie. Dimanche 15 août 1915
6h00 — J’ai été éveillé plusieurs fois cette nuit par la pluie qui tombait. Les camarades ne sont pas encore rentrés, ils ont dû être trempés.
7h00 — La Compagnie rentre ; rien de nouveau. Il faut s’attendre à partir d’un moment à l’autre ; il paraît que le ravitaillement ne viendra pas ce soir : signe de changement de
« domicile ». C’est jour de tète aujourd’hui, et je ne pense pas qu’il soit bien différent pour nous de tous les autres.
10h00 — On ne sait rien quant au départ. Les bruits les plus divers circulent ; d’après les uns nous allons à Athis, d’après les autres à Condé-sur-Marne.
11h00 — Notre caisse des sous-officiers ayant du boni, le caporal d’ordinaire nous a préparé un déjeuner des plus « relevés » : saucisson et beurre, hure de sanglier avec pommes en salade, veau rôti, cassoulet, abricots, crème à la vanille, brioche, vin fin de Bourgogne. Quelle différence avec nos repas « par cœur » des 13 et 14 juillet. Le Sergent-major qui arrive à l’instant nous lit une note qu’on vient de lui faire parvenir. C’est assez embrouillé, je crois toutefois comprendre que nous allons avoir une période de repos durant laquelle nous ferons l’exercice tant et plus, afin de terminer l’instruction des cadres et des hommes. Les sections vont être organisées sur de nouvelles bases. Attendons les évènements !
15h00 — Dernier tuyau, nous partons demain pour Baconnes. Aucun détail sous la main. Quelle vie tout de même ! Ne jamais savoir ce qu’on fera le lendemain !
17h00 — La Compagnie partira à 18h30 pour le boyau ; j’y vais cette fois. Il n’y a pas d’ordres concernant un prochain départ.
18h30 — La Compagnie est rassemblée ; un dernier appel pour s’assurer que personne ne manque, et on part. Ma section ferme la queue de la colonne, derrière moi
il n’y a plus que le Major et la voiture d’ambulance. La nuit tombe bientôt ; heureusement la marche est lente, ce qui nous permet de rester tous en liaison. Quand nous arrivons vers 20h30, il fait nuit noire et le Commandant de Compagnie me désigne un endroit problématique ou je dois me rendre avec ma section pour le terrassement. Je finis par trouver l’emplacement, mais les outils manquent ; j’en envoie chercher, et pendant ce temps, je recherche l’orientation du boyau, car celui-ci n’est pas commence et c’est en rampant que je trouve les pieux servant de points de repère. Il est 22h quand mes hommes sont installes ; dés que je vois que le travail est en train, je vais m’étendre sur l’herbe humide dans la clairière, me recouvre avec la capote d’un terrassier, puis m’endors.
Lundi 16 août 1915
3h00 — Après avoir dormi un peu et fait quelques rondes le jour est venu. Le parapet est rapidement recouvert de terre noire pour être rendu invisible aux avions, puis les outils sont rassemblés, ensuite les hommes, et on part alors qu’il fait bien clair.
5h00 — Arrivée au cantonnement, on s’endort.
9h00 — C’est bien vrai que nous partons la nuit prochaine pour cantonner à l’ouest de Baconnes.
Nous resterons là quatre ou cinq jours pour effectuer certains travaux, ensuite nous retournerons à l’arrière.
11h00 — Des camarades qui rentrent de Mourmelon racontent qu’ils y ont vu le Général Joffre et son Etat-major.
15h00 — Rapport. Nous quitterons le camp à 5h30 demain matin ; l’ordre de marche est donné. Nous n’avons aucun détail sur les travaux à faire là-bas.
17h00 — Les sacs sont montés ; on attendra le dernier moment pour rouler les toiles de tente qui servent de toiture.
21h00 — Il y a contre-ordre concernant le départ, paraît-il ; nous irions sur Épernay.
22h00 — Le fourrier m’éveille pour me dire que nous partons à 3h du matin pour cantonner une nuit à Ambonnay où est papa. Ce serait vraiment de la veine si c’était la vérité.
Mardi 17 août 1915
1h30 — Réveil ; rapidement, la toiture est démontée, on fait les derniers préparatifs en vue du départ.
2h30 — Le Régiment entier, avec ses voitures et tout son fourniment est rassemblé pour le départ. Il fait une nuit très noire.
3h00 — Départ ; le jour vient. Nous traversons les baraquements militaires de Mourmelon, les casernements du 46ème d’artillerie, puis ceux du 106ème d’infanterie. Nous atteignons Livry et
prenons la route d’Épernay.
9h00 — Grand’halte. La soupe qui est cuite pendant la marche dans les cuisines roulantes, est distribuée. Nous sommes maintenant à trois kilomètres d’Ambonnay.
10h30 — Nous partons pour la dernière étape. Courte pause avant d’entrer dans le village.
11h30 — Nous défilons dans les rues bondées de civils et de dragons, nous présentons les armes au Drapeau pendant que la musique joue, et nous sommes dirigés sur les cantonnements. Aussitôt déséquipé, je vais retrouver papa que j’ai eu à peine le temps d’embrasser pendant le défilé. Nous allons ensemble chez quelques connaissances.
14h00 — La famille Cochet a l’amabilité de mettre une baignoire à ma disposition et j’en profite pour me nettoyer des pieds à la tête. Ce soir je vais coucher dans un lit, chose qui ne me sera pas arrivée depuis avril dernier. Les chasseurs et dragons qui cantonnaient ici depuis six mois partent demain pour l’Alsace. Des troupes nombreuses sont massées dans toute la région. Presque tout l’ancien 6ème Corps est rassemblé ici. Notre but est-il d’attaquer ou de repousser une attaque éventuelle de l’ennemi ? Pour l’instant les russes reculent, reculent, et
ce sera peut-être bientôt notre tour à faire connaissance avec l’offensive allemande.
19h00 — Nous dînons. Repas très gai. Conversation variée, sur les classes de tous âges qui forment actuellement les régiments, sur notre entraîne — ment, sur notre moral, etc..
20h00 — Retraite par les tambours et clairons.
21h00 — Je repose dans le lit et ne sais de quel côté me tourner. Le départ n’a lieu que demain à 5h30, on peut donc faire une bonne nuit.
Mercredi 18 août 1915
4h30 — Réveil. Je quitte le lit à regret, mais il faut partir. Vite, je m’habille, puis gagne le cantonnement de ma section où je m’équipe.
5h30 — Rassemblement. Départ musique en tête, Drapeau déployé. J’espère bien revenir à Ambonnay avant de quitter la région
.
6h30 — Bouzy, défilé au pas. Tours-sur-Marne, défilé l’arme sur l’épaule. Pause à deux kilomètres d’Athis où nous allons cantonner. C’est le siège de l’Etat-major du 32ème Corps d’Armée et les consignes les plus sévères nous sont données concernant la tenue en ville et dans les cantonnements.
9h00 — Athis. Défilé devant le Drapeau.
Sommes conduits ensuite au cantonnement par le fourrier. Notre 2ème Section est bien logée dans une vaste ferme. Pour les quatre sous-officiers de la section, il y a une petite pièce pour loger ; nous n’y serons pas trop mal, mais toujours sur la paille bien entendu.
15h00 — Sieste. Il fait très chaud.
20h00 — Grande retraite aux flambeaux ; tambours, clairons, musique. « Marche du 94 », « Sambre-et-Meuse ». Civils et militaires suivent en chantant. Le vin n’est pas sans égayer un peu les esprits. L’effet produit par cette retraite me semble très bon.
21h00 — Extinction des feux. On s’étend sur la paille. L’adjudant et le plus ancien sergent de la section ayant pu se procurer un lit, nous ne restons qu’à deux sergents dans la baraque, ainsi que le caporal d’ordinaire qui y a élu domicile.
Jeudi 19 août 1915
6h00 — Je suis éveillé par le cuisinier qui apporte le café.
8h00 — Grand nettoyage du cantonnement. Construction de tables, râteliers d’armes. Nettoyage des cuirs, sacs et brodequins. Le Lieutenant tient à ce que la Compagnie soit dans une tenue irréprochable et nous passera une revue détaillée ce soir à 16h à cet effet.
11h00 — Rapport. Détails sur les exercices des jours
prochains : le matin, marche ; l’après- midi : jeux, sauts et causeries.
16h00 — La revue est passée très rapidement, le Lieutenant complimente la Compagnie sur sa bonne tenue.
20h00 — Retraite : clairons et tambours seulement, sans flambeaux.
Vendredi 20 août 1915
5h30 — Réveil. L’exercice commence à 6h.
5h50 — Rassemblement du Bataillon sur la route d’Épernay, puis départ. Quelques manœuvres assez ma) réussies.
7h30 — Déploiement en tirailleurs. Marche en colonne par quatre, en ligne de sections sur deux et en ligne d’escouade par un.
9h00 — Rassemblement et retour au cantonnement.
12h00 — Sieste jusqu’à 14h.
14h15 — Départ et marche jusqu’à une distance d’environ un kilomètre du village. Jeu de barres. Repos sous les arbres au bord de ta rivière. Maniement d’armes.
16h30 — Retour.
18h00 — Demain à 6h30, départ pour un « essai de revue ». Les détails manquent totalement.
20h00 — Retraite comme hier soir ; elle est de moins en moins suivie.
SEPTEMBRE 1915
Avec les premiers jours de septembre se termine la période de repos. En trois étapes, par Matougues, La Veuve et le Camp de Châlons, nous arrivons à l’arrière du front de Champagne. Trois jours passent encore à nettoyer les armes, les effets, le cantonnement. Le soir, nous allons sur le front creuser des tranchées entre les lignes allemandes et françaises, chaque fois nous sommes salués par des coups de canon. Il est à remarquer que ce front est beaucoup moins tranquille que la première fois que nous y étions venus ; le bombardement surtout est intense et chaque jour les équipes de travailleurs de nuit subissent des pertes plus ou moins fortes. De nombreuses troupes sont massées dans le camp, l’artillerie surtout est nombreuse ; on s’attend à un fort coup de tampon de notre part, mais la date et les conditions sont bien entendu inconnues. Chacun espère que cette fois les lignes allemandes seront percées et que nous obligerons ainsi l’ennemi à reporter son front plus en arrière.
Lundi 6 septembre 1915
— Ce soir nous partons pour les tranchées de première ligne que nous devrons tenir quatre jours. Nous partons à 4h, la majeure partie de la distance est parcourue dans un boyau assez
large creusé dans La craie champenoise. Ce boyau est d’une longueur inaccoutumée et nous n’atteignons le bout que vers 7h ; cette marche sinueuse entre deux parois blanches est fatigante et monotone. À ta sortie du boyau, nous sommes à quelque cent mètres de la
Suippe, et nous faisons la pause là. Nous attendons le retour des officiers partis pour reconnaître les secteurs.
20h00 — Partons en ligne, il est difficile de se diriger, tant la nuit est noire. Le chemin est long, nous ne sommes pas installés avant 23h. Peu de coups de fusil, mais le canon ne cesse guère sur un point ou sur un autre.
Mardi 7 septembre 1915
— Dès que le jour est venu, nous reconnaissons le secteur occupé depuis la veille. Les boches sont relativement éloignés et la distance séparant les lignes ne permet pas, comme en Argonne, l’échange presque continuel de bombes et grenades ; par contre les obus tombent en première ligne ; celle-ci n’est pas entièrement creusée et il faut se casser en deux pour y circuler.
— Les obus tombent un peu partout dans le courant de la journée ; nous n’avons aucun blessé. Le soir des chasseurs à pied devaient venir creuser la tranchée, mais ils ne viennent pas. La nuit est tranquille ; assez loin à droite il y a un bombardement
avec emploi de gros calibres.
Mercredi 8 septembre 1915
— Quelques obus tombent toujours, malgré cela, on est assez tranquille. Le soir, les chasseurs viennent faire des travaux en première ligne : ils font peu de travail et dorment presque toute la nuit. À 3h du matin ils quittent tes tranchées.
Jeudi 9 septembre 1915
— Journée calme, quelques obus qui nous obligent à nous tapir dans nos gourbis. Pour ma part, je commence à me creuser une tanière dans la craie où je serai à l’abri des schrapnells. Quelle vie ! Dès qu’un sifflement se fait entendre, chacun entre dans son trou comme la souris poursuivie par te chat. Le soir, les chasseurs viennent comme la veille pour creuser la première ligne ; je suis désigné pour conduire une patrouille fixe en avant des lignes, pour couvrir les travailleurs. À 22h, la patrouille et les travailleurs sont en position ; mes trois hommes et moi sommes dans un poste d’écoute avancé pour guetter la zone située entre les deux lignes. Vers 23h deux obus éclatent dans la tranchée sans que l’on ait entendu le sifflement précurseur ; aussi
un blessé pousse des cris déchirants ; on l’emporte, suivi d’une douzaine d’hommes plus ou moins grièvement atteints. Le travail cesse ; il est évident que les boches ont repéré le boyau. Ceci s’est passé à au plus cinq mètres de l’emplacement de ma patrouille ; un de mes hommes est légèrement atteint à l’arcade sourcilière. Un adjudant de chasseurs m’apprend qu’il vient de trouver un mort dans la tranchée ; revenant quelques instants après, il me dit en avoir vu trois autres, donc en tout quatre. Hasard ou non, le tir allemand a été efficace. Le travail dans la tranchée cesse. À 3h du matin les chasseurs quittent la tranchée, emportant six morts : deux autres étaient restés enfouis sous les décombres de la tranchée éboulée. Dans le boyau il y a des morceaux de chair détachés que l’on jette derrière Je parapet. À 4h, je vais dormir, complètement exténué.
Vendredi 10 septembre 1915
— La nouvelle tranchée de première ligne, non encore suffisamment creusée, est cependant occupée. J’ai pu dormir de 5h
à 6h30 ; c’est vrai — ment peu, mais impossible de faire autrement. L’après-midi, bombardement avec obus de gros calibre ; à chaque sifflement je me réfugie dans mon trou que je continue à creuser. Nous devons être relevés cette nuit, les quatre jours étant écoulés, il tombe quelques minen lorsque la nuit est venue, ils tombent loin des lignes.
Samedi 11 septembre 1915
1h00 — Les troupes de relève arrivent ; nous mettons sac au dos et leur cédons l’endroit après avoir passé les consignes. Un ordre mal exécuté par un chef de section fait que la relève est faite dans des conditions défavorables ; heureusement les boches ne se doutent pas que nous sommes massés dans les boyaux, sans quoi ils ne manqueraient pas de nous bombarder avec résultat certain. Après une attente prolongée, nous partons enfin et suivons les interminables boyaux qui conduisent aux passerelles jetées sur la Suippe. Ensuite, c’est la marche à travers le boyau qui mène au Camp où nous arrivons à 6h, harassés ; le temps est beau, heureusement, et chacun est assez gai. Un renfort est
arrivé pendant notre absence. Nous reconstruisons nos gourbis à l’aide de quelques piquets et de toiles de tente. L’après-midi, chacun dort.
Dimanche 12 septembre 1915
— Notre artillerie bombarde un avion boche, mais sans résultat ; du bivouac, nous surveillons les évolutions de l’aéro. Nettoyage des armes et effets. Une note passe disant que dès qu’un avion serait signalé, nous devions rester sous nos abris ou nous dissimuler du mieux possible. À l’aide de trois planches posées sur deux tréteaux, des infirmiers improvisent un autel sur lequel un prêtre infirmier dispose des objets religieux qu’il sort d’une petite valise. La messe commence presque aussitôt, écoutée par le Colonel, de nombreux officiers, auxquels viennent se joindre un grand nombre d’hommes ; quelques chants en chœur, quelques paroles du prêtre, et l’office est terminé. À 13h, je conduis une corvée de ravitaillement à Mourmelon ; je rentre à 16h30, juste pour voir la Compagnie rassemblée et prête à partir pour exécuter des travaux de nuit sur le front. Je m’équipe à la hâte, ne prends même pas la peine de manger, et pars avec ma Section.